L'illustration, intitulée House of Commons, représente la Chambre des communes avant l'incendie du 16 octobre 1834 qui a presque complètement détruit le palais de Westminster. Elle est tirée de l'ouvrage Ackermann's Microcosm of London, vol. 1, 1808.
Préface
Par. 1 La Constitution du Royaume-Uni a commencé à prendre forme dans les temps les plus anciens. Ses origines remontent, selon certains, à 1215, lors de la signature de la Grande Charte par Jean sans Terre. D’autres évoquent la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie en 1066. Mais l’on pourrait tout aussi bien prendre pour point de départ les années 449 à 584, lorsque des Angles, des Saxons et des Jutes venant de Germanie y ont établi leurs premiers royaumes, selon les chroniqueurs de l’époque.
Par. 2 Pourquoi cette question présenterait-elle toujours un intérêt ? La raison est que la Constitution du Royaume-Uni ne procède pas d’une création spontanée reposant sur quelque théorie politique, qu’elle est plutôt le résultat du travail d’hommes et de femmes de pouvoir ayant cherché, au cours des siècles, à résoudre les problèmes concrets auxquels ils étaient confrontés. Ils ont procédé à tâtons, par essais et erreurs, en suivant un long parcours parsemé d’incidents de toutes sortes. C’est ainsi qu’ils ont élaboré les institutions politiques de leur pays et les règles permettant de les faire fonctionner. Si nous oublions leur contribution, la Constitution du Royaume-Uni n’apparait plus que comme un échafaudage de normes plus ou moins arbitraires. Seule l’histoire permet d’expliquer leur place dans l’ordre juridique anglais. La logique qui sous-tend la constitution de ce royaume est d’abord et avant tout une logique historique.
Par. 3 Semaine après semaine, nous ferons donc un retour en arrière, jusqu’au temps de l’émigration des Germains, pour identifier les sources du droit constitutionnel anglais. Nous poursuivrons notre voyage hebdomadaire par des arrêts aux périodes les plus critiques de l’histoire : la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie; la reprise en main du royaume par Henri II, après le règne désastreux d’Étienne; la Grande Charte de Jean sans Terre; l’émergence du Parlement sous Henri III et Édouard Ier; la guerre des Deux Roses opposant les familles de Lancastre et de York; l’apparition du Conseil privé et l’établissement de l’Église anglicane par Henri VIII; la guerre civile durant les règnes de Jacques Ier et de son fils Charles Ier; la Glorieuse Révolution qui renversa Jacques II et la reconnaissance subséquente de la souveraineté du Parlement de Westminster par Marie II et Guillaume II; la formation du royaume de Grande-Bretagne et l’affermissement de l’indépendance judiciaire pendant le règne d’Anne; l’apparition du poste de Premier ministre et la création du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande lors des règnes de George II et George III; et, enfin, la cristallisation des conventions constitutionnelles à partir du règne de Victoria. Nous pourrons ainsi observer, au fil du temps, comment les principales institutions politiques du Royaume-Uni ont pris naissance et suivre leur évolution jusqu’à ce jour.
Par. 4 Notre ambition demeure modeste. Il ne saurait en être autrement pour celui qui veut résumer 15 siècles de péripéties constitutionnelles. Les faits et gestes de certains rois ou reines ont été négligés, alors que ceux d’autres ont joui d’une attention particulière. Cela dépend de l’importance de chaque règne dans le développement des institutions politiques du royaume. Afin de rendre la lecture plus agréable, nous avons choisi de décrire sommairement les événements de chaque période, afin d’y situer les étapes majeures des changements opérés au droit public, avant d’exposer dans le détail et de manière plus systématique les règles de droit et les pratiques constitutionnelles.
Par. 5 Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait progresser la recherche; aucune nouvelle théorie n’explique quelque avancée du droit par-delà la Manche. Notre travail d’écriture, qui tiendra compte de l’état actuel des connaissances, nous l’espérons, présentera la généalogie des principales institutions publiques du Royaume-Uni. Notre intention est d’expliquer d’où proviennent le Parlement, le gouvernement de Cabinet et les cours de justice, tout comme les règles qui les régissent. Il faut dissiper le brouillard qui les entoure afin que ceux qui s’intéressent à la Constitution du Royaume-Uni puissent y voir autre chose qu’un ensemble dissonant de normes hétéroclites. On admirera également le génie du peuple anglais qui a su rénover une Constitution millénaire pour l’adapter aux besoins du monde moderne.
Par. 6 L’intérêt d’étudier la Constitution du Royaume-Uni ne s’arrête pas à ses frontières. Car ce royaume, et plus précisément l’Angleterre qui en représente le noyau historique, a été le berceau du parlementarisme, un régime politique dans lequel la survie du pouvoir exécutif dépend de la volonté du pouvoir législatif exercé au sein d’un parlement. Or, ce parlementarisme à la mode anglaise a été exporté dans de nombreux pays. Plusieurs, autrefois des colonies telles que le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, ont non seulement conservé un régime parlementaire semblable à celui de leur ancienne mère patrie, ils partagent également le roi Charles III comme chef d’État. Le rayonnement de l’Angleterre et de ses États successeurs, d’abord la Grande-Bretagne, puis le Royaume-Uni, ne s’arrête pas au parlementarisme. Dès le Moyen Âge, on y a mis sur pied un appareil judiciaire où les juges jouissaient d’une marge d’autonomie alors inconnue. Ceux-ci ont créé la common law, la commune ley dans le vieux français d’autrefois, la langue en usage devant les cours de justice anglaises jusqu’à son déclin au XIVe siècle. La common law est un système de droit élaboré à partir de leurs jugements, aujourd’hui en vigueur aux États-Unis et dans les 53 pays faisant toujours partie de l’association du Commonwealth. On lui doit notamment les idées que tout individu peut demander au juge de vérifier la légalité de son emprisonnement, par l’émission du bref d’habeas corpus cum causa, et que tous, sans exception, y compris le roi, doit se soumettre au droit du royaume, ceci en application du principe de la primauté du droit, la fameuse rule of law dans la langue de Shakespeare, qui fera ici l’objet d’une attention particulière.
Note : Pour nous, common law s’écrit au féminin. Non seulement est-ce la pratique au Canada français, pays qui a hérité de la double-tradition common law - droit civil, mais cette expression, aujourd’hui anglaise, provient du vieux français, la commune ley. Certains ont néanmoins exprimé leur désaccord : lire, notamment, P. LEGRAND Jr, « Pour le common law », (1992) 4 Revue internationale de droit comparée 941.
Par. 7 Pour des raisons d’économie de texte et de qualité du style, le genre masculin sur notre site comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.
Carte 1

Avant-propos
Par. 8 On ne peut disserter sur l’histoire de la Constitution du Royaume-Uni sans s’interroger sur la nature du droit et du droit constitutionnel. Cela semble d’autant plus nécessaire que les origines de cette constitution se perdent dans la nuit des temps, à une époque où très peu d’habitants auraient décrit leurs rapports en termes légaux. Nous emploierons le vocabulaire du positivisme juridique pour les expliquer. Ce vocabulaire, et la théorie qu’il véhicule depuis le XIXe siècle, ne sont rien de plus qu’un outil pour nous permettre de suivre l’évolution de la Constitution anglaise afin de la rendre intelligible, notre but étant de reconstituer le passé pour mieux comprendre la réalité actuelle. Cela étant compris, il n’est certes pas dans notre intention de prêter à l’homme du Moyen Âge quelque idée née de la modernité.
Par. 9 Qu’est-ce que le droit positif ? Le droit, dans son sens objectif, traduit en langue anglaise par le mot law, est un principe d’organisation de la vie en société. Il régit les activités des membres composant cette société dans leurs rapports les uns avec les autres ainsi qu’avec les choses qu’ils s’approprient, en les informant de ce qu’ils doivent faire, de ce qu’ils ne doivent pas faire, et de ce qu’ils peuvent faire, sans toutefois y être obligés.
Note : Le mot droit possède un autre sens. Il ne s’agit plus d’un ensemble de règles gouvernant une société ou un État, ce qui est le droit objectif. Il désigne plutôt des prérogatives appartenant à un individu, des prérogatives que le droit objectif d’une société ou d’un État lui reconnaît et dont cet individu peut exiger le respect. Ces prérogatives, connues en langue anglaise sous le nom de rights, permettent à leur titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose, soit dans son intérêt, soit dans celui d’autrui : droits de créance; droits de propriété; droit de grève; droit de vote; droit à l’égalité; etc. Le contexte permet aisément de distinguer si l’on parle du droit objectif (law) ou d’un droit subjectif (right).
Par. 10 Ce faisant, le droit objectif met en place un certain ordre social, on dit un ordre juridique, qui s’oppose au désordre. En effet, vivre en société en l’absence d’un droit générerait tant d’agitation et même d’anarchie que la vie deviendrait vite impossible. Là où des êtres humains cohabitent, il y a donc nécessairement du droit. L’inverse est également vrai; sans droit il ne saurait y avoir de société, si primitive soit-elle. Un gouvernement sans loi, a écrit le philosophe anglais John Locke (1632-1704), est « incompatible avec la société humaine »
J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, traduction de David Mazel, 2e éd. corrigée, Paris, GF Flammarion, 1992, p. 304.
Par. 11 Parce que les hommes ont toujours vécu de la sorte, au sein de groupes organisés, qu’il s’agisse d’une bande de nomades ou d’une nation entière occupant le territoire d’un État, il s’ensuit que l’existence du droit, au moins dans sa forme la plus rudimentaire, serait aussi ancienne que l’humanité.
Par. 12 Toute société est concernée par le respect de son droit. Soit la société dans son ensemble, soit les institutions auxquelles elle a confié cette tâche, se chargent d’en appliquer les règles, au besoin par l’usage de la force. C’est d’ailleurs principalement ce qui distingue le droit des autres règles de la vie sociale tels les éthiques laïques ou les morales religieuses, voire le simple savoir-vivre. La force, au sens d’une contrainte ou d’une menace de contrainte physique sur les personnes ou sur leurs biens, est un corollaire de l’idée de droit, sa conséquence inévitable. Elle s’avère indispensable lorsqu’il y a transgression d’une règle impérative, que ce soit la violation d’une obligation ou encore la commission d’une infraction. La force permet alors de s’assurer que la personne fautive sera sanctionnée.
H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris/Bruxelles, Bruylant/LGDJ, 1999, p. 41-43, ou encore J. AUSTIN, The Province of Jurisprudence Determined, New York, Prometheus Books, 2000, p. 24-26.
Par. 13 Parmi les différentes règles qui régissent une société, il s’en trouve qui traitent de l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, autrement dit qui concernent l’adoption, l’application et l’interprétation des lois, selon la classification imaginée par Montesquieu au XVIIIe siècle pour décrire les principaux pouvoirs associés à la puissance publique. Ces règles font partie de la Constitution de cette société; elles définissent et circonscrivent le champ du droit constitutionnel.
MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Garnier, Paris, 1777, livre 11, chap. 6, pp. 311-312.
Par. 14 Au Royaume-Uni, les pouvoirs de puissance publique sont investis dans les trois institutions les plus importantes de l’État anglais : le Parlement de Westminster, le Cabinet des ministres et la Cour suprême du Royaume-Uni. Il n’en a pas été toujours ainsi. Si l’on remonte aux origines de la Constitution anglaise, dans la Bretagne encore romaine des Ve et VIe siècle jusque dans l’Angleterre des Xe et XIe siècles, l’exercice de ces pouvoirs était fortement centralisé. Plusieurs institutions, parfois en conflit les unes avec les autres, se les partageaient selon des modalités souvent imprécises. Le droit restait confus, pour dire les choses simplement. On ne connaissait pas d’autorité publique au sens d’une administration qui a pour mission de promouvoir et de défendre l’intérêt commun. Tout relevait de la gestion des intérêts particuliers. Même le roi considérait son royaume comme un patrimoine privé qu’il pouvait diviser à volonté pour le transmettre en héritage à ses enfants ou de proches parents. Il faudra plusieurs siècles, le temps que l’autorité et le prestige de la royauté s’imposent à tous sur toutes ses terres pour que l’État anglais, confondu désormais avec la notion abstraite de Couronne, puisse naître, uni et indivisible. Étudier l’histoire de la Constitution anglaise revient par conséquent à étudier l’évolution de la royauté.
Par. 15 Les règles constitutionnelles ont pris différentes formes selon les époques. On les trouve aujourd’hui dans les lois du Parlement, la common law et les conventions constitutionnelles. Toutefois, au moment où notre étude commence, soit au début du Moyen Âge, entre les années 449 et 584, ce qu’on appelait alors la Bretagne était une terre régie exclusivement par des coutumes. Les plus anciennes règles de droit constitutionnel ont donc revêtu les habits propres aux coutumes.
Par. 16 Les coutumes étaient des pratiques ou des usages publics, suivis par la plus grande partie des habitants d’une région, que sa population avait observés de façon presque constante pendant une très longue période, au moins le temps qu’une génération d’hommes naissent et meurt. À ces facteurs matériels s’ajoutait un élément psychologique : ceux qui y étaient soumis devaient être convaincus d’obéir à une règle obligatoire. La croyance générale à cet égard était déterminante, bien que le poids de l’opinion de chacun au sein de la société puisse varier. Il fallait observer en particulier ce que pensait les personnes en autorité, celles chargées d’appliquer le droit. Comme les coutumes étaient des règles imprécises du fait qu’elles naissaient spontanément et se transmettaient oralement d’une génération à l’autre, on les codifiait parfois sous une forme écrite afin d’accroître leur autorité et de mettre fin aux incertitudes sur l’état du droit. Les règles coutumières représentaient cependant, pour l’essentiel, un droit non écrit. Sous la pression des faits économiques et sociaux, d’anciennes coutumes étaient modifiées, voire abandonnées, pendant que d’autres apparaissaient. Toutefois, cette évolution était si lente durant tout le Moyen Âge qu’elle en devenait presque imperceptible. On croyait pour cette raison à l’existence d’un droit immuable. L’innovation était socialement déconsidérée. Le réflexe courant était d’accepter sa société comme elle se présentait avec la place que chacun, seigneur, clerc, paysan et artisan, y occupait. Pour les hommes du Moyen Âge, plus une coutume était ancienne, plus elle était estimée et jugée digne de respect. Voilà pourquoi les premiers rois d’Angleterre prétendaient toujours se conformer aux vieilles coutumes de leur pays, même lorsqu’ils souhaitaient les modifier pour les adapter aux nouvelles conditions.
Par. 17 Si les plus anciennes règles de droit constitutionnel ont pris la forme de coutumes, elles n’ont pu se perpétuer en Angleterre que suite à leur mutation en règles de common law. Les débuts de la common law remontent à l’Angleterre des XIIe et XIIIe siècles, après la création, par les rois Henri Ier (règne 1100-1135), Henri II (règne 1154-1189), Richard Ier (règne 1189-1199) et Henri III (règne 1219-1272), de plusieurs cours royales parmi lesquelles se trouvaient les juges itinérants, la Cour de l’Échiquier, la Cour des plaids communs et la Cour du banc du roi. Les trois Henri et Richard avaient confié aux juges de leurs cours la responsabilité de rendre justice dans tout le royaume d’Angleterre. Il s’agissait d’une nouveauté; jusque-là, la justice du roi, qu’il dispensait personnellement, avait été réservée aux grands personnages du royaume et aux grandes causes. Pour trancher les litiges qui leur étaient soumis, les juges royaux se sont d’abord fondés sur les coutumes existantes, coutumes anglo-saxonnes ou coutumes normandes, ainsi que sur les textes législatifs décrétés par le roi et ses prédécesseurs. Lorsque les coutumes différaient d’une région à une autre, les juges ont choisi les meilleurs d’entre elles pour en étendre l’application à l’ensemble du royaume. Ils ont aussi écarté d’anciennes coutumes devenues désuètes ou injustes pour créer de nouvelles règles. Du produit de leur travail a émergé un ensemble de règles de droit et de brefs judiciaires tirées d’autant de précédents. Ces règles ont porté différents noms en différentes langues en différentes époques : on a dit, tour à tour, lex terrae, communem legem, commune ley et enfin common law. La common law s’est graduellement substituée aux anciennes coutumes pour devenir le droit commun du royaume. Les coutumes portant sur l’exercice des pouvoirs de puissance publique ont subi le même sort. Lorsqu’elles ont survécu, ces anciennes coutumes, devenues entre-temps règles de common law, font aujourd’hui partie du droit constitutionnel anglais. Les plus connues placent le roi ou la reine du Royaume-Uni à la tête des armées et lui confèrent une immunité contre toute taxation.
Par. 18 On a reconnu très tôt au Parlement le pouvoir de modifier l’ordre constitutionnel. Le Parlement est né dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Bien que ses compétences et sa procédure aient beaucoup changé depuis, sa composition se fixa dès les premières années : il rassemblait et rassemble toujours le roi ou la reine, les représentants de la noblesse appelés lords du Parlement, ainsi que les délégués des diverses communautés du royaume, élus par la population, appelés députés des communes. Les actes du Parlement ont pris le nom de statuts puis de lois. Ces statuts ou lois sont des textes votés par les lords et les communes avant leur sanction par le monarque. Ils ont remplacé les anciennes formes d’actes législatifs émanant du roi et connus sous les noms de chartes, d’assises et de constitutions, selon que le roi les adoptait seul ou après consultation avec sa noblesse ou uniquement son clergé. Rappelons l’existence de la Grande Charte de 1215, souvent considérée comme le texte fondateur du droit constitutionnel anglais. Un statu pouvait codifier le droit existant sans en changer la portée ou encore le modifier plus ou moins en profondeur. À ses débuts, et jusqu’au XXe siècle, le Parlement n’intervenait que pour corriger ce qu’il percevait être les lacunes du droit, cette common law qui était l’œuvre des cours royales de justice. Le Parlement était devenu l’institution privilégiée pour modifier le droit en vigueur, tout simplement parce que les juges se sont dits incapables d’apporter les correctifs nécessaires, une fois qu’ils avaient reconnu l’existence d’une règle de droit. L’histoire de la Constitution anglaise a été marquée par d’importants statuts du Parlement parmi lesquels se trouvent la Déclaration des droits de 1689, 1 Will. & Mar., sess. 2, c. 2, et la Loi d’établissement de 1701, 12 & 13 Will. 3, c. 2, reproduites en annexe.
Note : Ce n’est qu’en 1966 que le Comité judiciaire de la Chambre des lords, dans Practice Statement on Judicial Precedent, [1966] 1 WLR 1234, a rappelé son pouvoir qui a toujours appartenu aux cours royales, mais oublié pendant plusieurs siècles, d’écarter un précédent de common law devenu désuet ou dont l’application comportait une injustice.
Par. 19 En plus des statuts du Parlement et des règles de la common law, la Constitution anglaise comprend également des conventions constitutionnelles. Ces conventions ne font pas partie du droit; elles appartiennent à l’univers de la politique. Ce sont des arrangements, des accords conclus entre les différents acteurs de la scène politique quant à la manière dont ils se comporteront ou exerceront leurs pouvoirs, dépendant des circonstances. Comme il s’agit d’ententes de nature politique et non de règles de droit, les cours de justice ne peuvent ordonner de les respecter. Il revient plutôt aux acteurs concernés d’en assurer l’application. Même si les conventions constitutionnelles ne font pas partie du droit, leur étude demeure indispensable si l’on souhaite comprendre le fonctionnement des institution publiques anglaises. La plupart de ces conventions ont été élaborées aux XVIIIe et XIXe siècles. C’est donc une innovation assez récente, du moins à l’échelle de l’histoire constitutionnelle du pays. Deux d’entre elles, particulièrement importantes, ont permis la démocratisation du royaume : il y a la convention constitutionnelle du gouvernement responsable et celle selon laquelle le roi règne mais ne gouverne pas. Un gouvernement responsable doit conserver la confiance de la chambre élue, ce qui signifie contrôler le vote d’une majorité de députés des communes, s’il souhaite se maintenir au pouvoir. Autrement, il a l’obligation politique de remettre sa démission au souverain, ou encore de lui demander la dissolution du Parlement et la convocation d’élections. Bien qu’il possède légalement tous les pouvoirs associés à la puissance publique, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le roi doit normalement les exercer en se conformant à la volonté des élus, en l’occurrence les députés des communes et les ministres du gouvernement. C’est en ce sens que l’on a dit du monarque qu’il règne sans toutefois gouverner. On s’entend pour reconnaître, au moins depuis la fin du règne de Victoria en 1901, que le souverain britannique a le droit d’être consulté par le Premier ministre sur les politiques adoptées par son gouvernement, le droit de l’encourager, ainsi que le droit de le mettre en garde. Toute autre intervention de sa part serait considérée impolitique et pourrait menacer la survie de la monarchie.
W. BAGEHOT, The English Constitution, 2e éd., Londres, Oxford University Press, 1872, p. 67.
Par. 20 La Constitution du Royaume-Uni, l’objet de notre étude, regroupe conséquemment un ensemble de règles aux origines diverses, anciennes coutumes, chartes, assises et constitutions féodales, qui ont été progressivement remplacées par des règles de common law, des statuts du Parlement et des conventions constitutionnelles.
Table des matières
Préface : Par. 1
Avant-Propos : Par. 8
- Formation du royaume d’Angleterre : Par. 21
- Constitution anglo-saxonne des origines : Par. 54
- Constitution anglo-saxonne après l’unification politique : Par. 84
- Conquête normande : Par. 155
- Féodalité anglo-normande : Par. 206
- Constitution anglo-normande : Par. 253
- Empire angevin : Par. 346
- Constitution sous l’Empire angevin : Par. 412
- Héritiers plantagenêts de la Grande-Charte : Par. 471
- Constitution anglaise après la Grande-Charte : Par. 597
- Guerre dynastique : les Lancastres et les Yorks : Par.
- Constitution sous les derniers Plantagenêts : Par.
- Parachèvement de l’État anglais : les Tudors : Par.
- Constitution anglaise sous les Tudors : Par.
- Premiers Stuarts : la monarchie en péril : Par.
- Constitution anglaise sous les premiers Stuarts : Par.
- Derniers Stuarts : restauration et révolution : Par.
- Constitution anglaise après la Glorieuse Révolution : Par.
- Maison de Hanovre : la politique du compromis : Par.
- Constitution anglaise sous le règne de Victoria : Par.
- Derniers développements : Par.
Conclusion : le Parlement de Westminster est-il toujours souverain ? Par.
Bibliographie : Par.
Textes de loi : Par.
Tableau des rois et reines et de leurs Premiers ministres : Par.
Glossaire : Par.
Table des lois et des décisions de justice : Par.
Index des noms de personnes et des sujets : Par.
Liste des illustrations : Par.
1. Formation du royaume d’Angleterre
1.1 Peuplement des îles britanniques
Par. 21 Grâce aux fouilles archéologiques, on sait que le peuplement des îles britanniques remonte à plus de 500 000 ans. C’est alors que les premiers groupements humains sont apparus avec leurs outils de pierre taillée qui caractérisaient l’époque paléolithique. Ces premiers habitants, des semi-nomades, vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Ils ont quitté plusieurs fois leurs îles en raison des fortes variations climatiques, pour y revenir avec le redoux, une dernière fois après la glaciation qui a pris fin il y a près de 10 000 ans avant notre ère (ci-après écrit « av. n. è. »). Autour de l’an 4 000 av. n. è., durant la période néolithique, des sédentaires sont arrivés pour se mêler aux chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. Il s’agissait de modestes fermiers qui pratiquaient l’agriculture et l’élevage d’animaux aidés de leurs outils en pierre polie. On a découvert plus tard le travail du métal. Il y a d’abord eu l’âge du bronze, qui commença dans les îles vers 1 800 av. n. è., suivi de l’âge du fer, que l’on situe autour de l’an 500 av. n. è. Les dernières migrations d’importance dans les îles auraient eu lieu pendant la première moitié de l’âge du bronze. Ceux que l’on appellera les Celtes en seraient les descendants.
Par. 22 Car, d’après les très récentes découvertes des archéologues et des généticiens, ils sont de plus en plus nombreux à croire que la côte atlantique, des îles britanniques jusqu’à l’Espagne, aurait été le lieu où les peuples ont développé une langue et une culture commune, appelée la civilisation celte. Et c’est de là que leurs fils auraient migré ailleurs en Europe. Galois, Irlandais, Écossais et Bretons actuels seraient donc tous les héritiers, sinon les descendants des premiers celtes européens.
B. CUNLIFFE et J. T. KOCH (éds.), Celtic from the West : Alternative Perspectives from Archeology, Genetics, Language and Littérature, Londres, Oxbow Books, 2012.
Carte 2

Par. 23 Vers 330 ou 320 av. n. è., l’astronome grec Pythéas de Marseille, un grand voyageur et l’un des premiers à avoir laissé des traces dans l’histoire, a navigué autour de ces îles en bordure du monde connu. Il a alors évoqué la présence d’habitants répondant au nom de Prétanis. Un traité écrit entre 40 à 20 ans av. n. è., dont on a cru erronément que le célèbre Aristote en était l’auteur, a également mentionné deux grandes îles situées au-delà des colonnes d’Hercule (i.e. le Cap de Gibraltar). Leurs noms grecs se prononçaient Albion et Ierne, l’Angleterre et l’Irlande actuelles. Leurs habitants vivaient en petites tribus ou clans apparentés, souvent en conflit les uns avec les autres.
PYTHÉAS, Periodos Oceanus, IVe siècle av. n. è., traduit par C.H. Roseman sous le titre On the Ocean : Text, Translation and Commentary, Chicago. Ares Publication, 1994 ; ARISTOTE, Traité pseudo-aristotélicien du monde, traduit par J. Tricot, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1949, p. 185.
Par. 24 Jules César, proconsul de Rome, a débarqué avec ses troupes sur l’île d’Albion en 55, puis à nouveau en 54 av. n. è., sans pouvoir mener à terme son projet de conquête. Les légions romaines sont revenues en 43 de notre ère (ci-après écrit « de n. è. ») sous le règne de l’empereur Claude. Il lui a fallu quelques années de durs combats pour conquérir la partie méridionale de l’île.
Par. 25 Les Romains ont rebaptisé l’ancienne Albion du nom de Britania ou Bretagne dans notre langue. C’était la déformation latine du nom grec de ses habitants, les Prétanis, qui sont ainsi devenus les Britons ou encore les Bretons en français. Un peuple distinct, les Caledones, ou Calédoniens, l’un des peuples qui occupaient le nord de l’île, une région apparemment rude et sauvage d’après sa réputation, est demeurée hors du contrôle des Romains. Ces derniers l’ont nommé Caledonia ou Calédonie, soit plus ou moins le territoire de l’Écosse actuelle. Les descendants des tribus de Calédonie se réuniront en confédération au Ier siècle de n. è. afin de continuer la lutte contre les Romains. On les connaîtra sous le nom de Pictes, en raison de leur habitude de se tatouer la peau. La Calédonie sera désormais connue, pour quelque temps, comme étant la Pictavia ou la Pictavie en français.
Par. 26 L’autre grande île britannique, Ierne, était le pays des Érainns. Les Romains ont voulu la rebaptiser Hibernia. Cependant, l’île a conservé le nom de ses habitants, soit Éire en gaélique et Îre en anglais. On l’appelle aujourd’hui Ireland, ce qui signifie littéralement « la terre des Ires » ou Irlande en français. Et ses habitants sont connus comme étant les Irlandais.
Par. 27 La défense de la Province de Bretagne grevait lourdement le trésor romain. De trois à quatre légions étaient requises, soit dix pour cent de toute l’armé impériale. Pour contenir ces dépenses, l’empereur Hadrien a décidé la construction d’un mur de trois mètres de profondeur et de cinq mètres de hauteur qui longerait la frontière nord de sa province, afin de séparer les terres romaines de celles des Pictes. Le mur, achevé vers l’an 128 de n. è., traversait la Bretagne sur plus de 100 kilomètres, de l’embouchure du fleuve Tyne à l’Est, jusqu’à l’estuaire du Solway à l’Ouest. Les Romains ont poursuivi leur offensive et repoussé les Pictes au-delà du mur d’Hadrien. Un autre mur a été érigé autour de l’an 142 par le successeur d’Hadrien, l’empereur Antonin le Pieux. Situé à plus ou moins 80 kilomètres au nord du premier, il liait l’estuaire du Forth à l’Est, près de la ville d’Édimbourg, jusqu’à celui du fleuve Firth, sur la côte ouest de l’île.
Carte 3

Par. 28 À partir du Ve siècle, des Celtes originaires d’Irlande se sont établis en Calédonie ou Pictavie. Les Romains les ont appelés des Scots. Scot était un terme descriptif, une insulte en réalité pour désigner les Celtes gaéliques d’Irlande qui s’adonnaient au pillage des côtes bretonnes. Les Scots ont progressivement établi leur autorité sur le territoire du Nord. Ils ont fondé un royaume scot au IXe siècle, qu’ils ont naturellement baptisé Scotland, la terre des Scots, ou Écosse en français. Écossais et Irlandais partagent donc nombre de leurs ancêtres.
Carte 4

Par. 29 Pendant ce temps, l’Empire romain se désagrégeait sous la pression des peuples dits barbares. Les Wisigoths, pour l’un, peuple guerrier originaire de la Germanie, toujours les armes à la main, franchissaient régulièrement les frontières pour pratiquer leur activité favorite : les razzias. C’était une manière, pour ces forbans, d’amasser du butin, avant de se retirer sur leurs terres avec le produit de leurs rapines. Un nouveau roi élu en 395, Alaric Ier, un homme intelligent, cultivé et ambitieux, décida cependant d’un programme de pillage à une tout autre échelle : avec ses 40 000 Wisigoths, dont 8 000 guerriers, il a dépouillé tour à tour la Macédoine, la Grèce et l’Illyrie, des proies sans défense. Puis, il a regardé du côté de la riche Italie, qu’il a envahie à la fin de l’an 401. Après quelques batailles, négociations et diverses ruses, Alaric a réussi à s’emparer de la cité le 24 août 410. Le saccage de Rome, d’une durée de trois jours, comme celui du reste de la péninsule dans les mois suivants, lui a permis d’amasser un trésor. Les Wisigoths, satisfaits, quitteront l’Italie dès l’année 411 pour envahir le Sud-Ouest de la Gaule.
Par. 30 L’empereur Honorius a réagi devant la menace wisigothe en rappelant en renfort ses légions stationnées un peu partout aux marches de l’Empire. Puis, il a fait parvenir un message aux autorités locales de Bretagne, menacé par des troubles depuis quelque temps, afin de les avertir qu’elles ne devaient dorénavant compter que sur elles-mêmes pour assurer la protection de leur province. Il n’empêche, Rome était déjà condamnée. En effet, l’Empire romain d’Occident cessera d’exister lorsque le patrice Odoacre, général romain, mais fils d’un collaborateur du roi des Huns Attila, déposera en 476 Romulus Augustus, le dernier empereur. Ce fut l'acte de décès qui a été dressé au terme d'une longue agonie.
ZOZIME ou ZOSIME, Histoire nouvelle, environ 500-520 de n. è., livre sixième et index, J. Jouanna (éd.), F. Paschoud (trad.), Paris, Les Belles Lettres, 1989 ; B. LANÇON, La chute de l'Empire romain, une histoire sans fin, Paris, Perrin, 2017.
1.2 Création des royaumes anglo-saxons de l'Heptarchie
Par. 31 La lettre d’Honorius n’avait fait que confirmer ce dont les Bretons romanisés se doutaient déjà. Depuis plusieurs années, les Bretons souffraient des raids de guerriers venant de l’Est. Il s’agissait principalement d’Angles, de Saxons et de Jutes, des peuples habitant la Germanie antique, dans les régions bordant la mer du Nord, aujourd’hui l’Allemagne du Nord, le Danemark et les Pays-Bas. Les archives font état de leurs attaques répétée à partir de l’an 365.
Carte 5

Par. 32 Voyant l’état de faiblesse de la province romaine, les Pictes et Scots ont entrepris à leur tour de participer au pillage après 367. La Bretagne est devenue très vulnérable, autant sur ses côtes à l’Est que sur sa frontière nord avec la Calédonie. Entre 446 et 449, des Bretons désespérés auraient engagé des mercenaires germains pour se défendre, souvent de la même race que les premiers pillards, en leur offrant des terres en guise de paiement. Ce serait de cette façon que les premiers Angles, Saxons et Jutes seraient venus s’établir dans l’île de Bretagne. Leur nombre aurait augmenté au point de constituer une menace pour leurs hôtes bretons. Les autochtones se seraient défendus âprement contre les envahisseurs germains. Malgré leur vaillance, le recul des Bretons, tués, repoussés ou assimilés, auraient fait place aux nouveaux venus.
Par. 33 Le conditionnel s’impose. Car rien, ou presque, ne corrobore cette dernière partie du récit portant sur les interactions entre les soi-disant envahisseurs et les autochtones, sauf les écrits en latin du moine Bède le Vénérable, qui datent cependant de trois siècles après les événements. Or, Bède s’est reposé en grande partie sur la tradition orale de certaines communautés, ainsi que sur les quelques rares écrits des monastères. Et notre moine, homme d’Église plus qu’historien, s’est intéressé davantage aux progrès de sa foi qu’aux avancés des Anglo-Saxons, sa communauté d’origine. Il y a eu aussi, provenant de diverses abbayes, des anales rédigées en vieil anglais relatant l’histoire de l’île et compilées par d’autres hommes d’Église à des dates encore plus récentes, dont certaines se contredisent entre elles. Tout cela, avec pour résultat que notre connaissance des événements de la Bretagne post-romaine restait fort incomplète et surtout incertaine.
BEDE, Ecclesiastical History of England, écrite vers 731, traduction anglaise par A.M. Sellar, Londres, George Bell and Sons, 1907 ; ANONYMES, Anglo-Saxon Chronicles, environ 890-1154, Londres, Everyman Press, 1912, ci-après cité CHRONIQUES.
Par. 34 Cette période de l’histoire, le haut Moyen Âge, surnommée celui des âges obscurs, dark ages en anglais ou saeculum obscurum en latin, ressemblait à un grand trou noir. Les historiens n’y voyaient pas grand-chose en raison de la rareté des archives et des motivations de leurs quelques auteurs. Toutefois, ils ont fait de grands progrès récemment, ceci grâce à leurs collègues chercheurs généticiens qui ont examinés les données provenant de l’A.D.N. d’anciens restes humains pour les comparer à celles d’autres restes trouvés dans des sépultures sur le continent. Leurs conclusions semblent, sinon irréfutables, dans tous les cas plus certaines que celles avancées auparavant.
J. GRETZINGER et 69 autres auteurs, « The Anglo-Saxon Migration and the Formation of the Early English Gene Pool », Revue Nature, vol. 610, 6 octobre 2022, pp. 112-134.
Par. 35 Tout d’abord, on sait désormais que la Bretagne a connu une immigration importante et continue provenant de tribus originaires de Germanie. Elle aurait commencé vers la fin de la période romaine et se serait poursuivie jusqu’au milieu du VIIIe siècle. L’évolution sociale consécutive n’aurait donc pas été uniquement le résultat d’une substitution des élites, mais également celle d’une arrivée massive d’immigrants.
Par. 36 Les nouveaux venus, des Angles, des Saxons et des Jutes, se sont mélangés aux autochtones bretons de différentes manières dans différentes régions. Un métissage génétique à grande échelle s’est alors produit : en effet, d’après les chercheurs, près de 75% de la population habitant le sud et l’est de la Bretagne, entre l’an 400 et 1 000 de n. è., avaient alors des ancêtres originaires des régions continentales bordant la mer du Nord.
Par. 37 Angles, Saxons et Jutes, une fois arrivés dans l’île guidés par des chefs de guerre, des gesiths germains, se sont d’abord regroupés en petites communautés au sud et à l’est de la Bretagne. Y-a-t-il eu des violences, combats ou massacres ? Assurément ! Toutefois, les armes ont parfois été déposées pour laisser place à des négociations. De longues périodes de calme relatif, des années, voire toute une génération, auraient éventuellement suivi. Les Germains continuaient cependant de débarquer sur l’île. L’espace réservés aux seuls Bretons rétrécissait, sans pour autant se traduire par une émigration importante de leur contingent vers d’autres lieux. Mais ce qui devait arriver arriva : à terme, parce que le nombre finit toujours par l’emporter, la langue et la culture des nouveaux venus se sont imposées sur presque toute l’ancienne province romaine de Bretagne. L’île changera conséquemment de nom vers la fin du millénaire pour celui d’England, autrement dit la terre des Angles ou Angleterre en français, de manière à rappeler l’un des peuples qui l’avaient colonisée.
F. STENTON, Anglo-Saxons England, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2023.
Par. 38 La résistance des Bretons a donné naissance à la légende du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde. S’il a vraiment existé, Arthur aurait été un chef de guerre, un duce comme les Romains les appelaient. Ses chevaliers ne seraient cependant qu’invention car la chevalerie, en tant qu’ordre nobiliaire gouverné par des règles éthiques, ne prendra forme que 600 ans plus tard (voir plus loin nos paragraphes ??).
Par. 39 On ne sait pas exactement quand ou comment. On pense cependant que les Angles, les Saxons et les Jutes auraient multiplié la création de petites principautés autonomes. De nombreuses dynasties en ont émergé. Après une première entreprise de consolidation qui aurait duré un siècle et demi, de 450 à 600 environ, durant laquelle plusieurs de ces petits royaumes ont perdu leur indépendance, les Germains ont édifié sept royaumes couramment appelés l’Heptarchie . Si l’on en croit Bède le Vénérable, une source qu’il faut consulter avec prudence pour cette période, les Jutes auraient d’abord fondé le Kent. Après ce fut au tour des Saxons de créer le Sussex, le Wessex et l’Essex. Les Angles se sont pour leur part établis dans les nouveaux royaumes de Northumbrie, d’Estanglie, puis de Mercie. Il est fort possible que ces sept royaumes n’aient jamais existé avec les frontières exactes que nous leur avons attribuées. Tout changeait rapidement à cette époque. Nous savons toutefois que seulement quatre d’entre eux ont survécu jusqu’en 865 : le Wessex, la Mercie, l’Estanglie et la Northumbrie. L’Heptarchie aurait donc été transformée en Tétrarchie.
STENTON, id., p. 37.
Carte 6

Par. 40 Les Bretons ont maintenu leur domination à l’ouest et au nord de l’île, dans le pays de Galles, en Cornouailles et dans la Strathclyde. Certains Bretons ont même traversé la Manche pour venir s’établir en Gaule dans la péninsule d’Armorique, qui sera, pour cette raison, rebaptisée Bretagne au milieu du VIe siècle. Elle est donc devenue le pays des Bretons. D’ailleurs, les langues celtiques ont survécu dans toutes ces contrées, parfois tant bien que mal. Elles connaissent actuellement un renouveau dans la culture populaire. On parle des dialectes d’origine gaélique en Irlande et en Écosse, et des dialectes d’origine brittonique au pays de Galles, en Cornouailles et dans la péninsule française de Bretagne.
J. CORNETTE, Histoire de la Bretagne et des Bretons, tome 1 : des âges obscurs au règne de Louis XIV, p. 114-122.
1.3 Unification politique de l’Angleterre
Par. 41 Bien qu’appartenant à une même culture, les royaumes angles, saxons et jutes d’Angleterre se faisaient fréquemment la guerre. Il est vrai que les rois de l’Heptarchie, puis de la Tétrarchie avaient coutume de reconnaître l’ascendant de l’un d’entre eux sur plusieurs autres, mais l’unification politique de l’île semblait hors d’atteinte, jusqu’à ce que deux faits aient permis de l’envisager plus sérieusement : l’émergence d’un sentiment national et l’apparition d’un ennemi commun. Cela n'a pas été une évolution voulue et donc consciente. Toutefois, les circonstances aidant, les rois du Wessex en ont tiré le meilleur profit pour faire de l'Angleterre un pays.
W. STUBBS, The Constitutional History of England, vol 1, 5e éd., Oxford, Clarendon Press, 1891, pp. 187-188.
Par. 42 L’unification religieuse de l’Angleterre, telle que relatée par Bède, a précédé son unification politique. En l’an 597 de n. è., le pape Grégoire Ier, surnommé le Grand, a détaché un missionnaire dans l’île. Son nom était Augustin, plus tard saint Augustin de Cantorbéry. Augustin était un jeune esclave de race angle habitant Rome lorsqu’il s’est converti à la foi chrétienne. Il se révéla l’émissaire idéal pour approcher le roi Ethelbert du Kent. Comme le roi était déjà marié à une princesse chrétienne du royaume franc, sa conversion et celle de beaucoup de ses sujets ont été réalisés sans trop de difficulté. Augustin approcha également les royaumes d’Essex, d’Estanglie et de Northumbrie, mais sans succès notable dans l’immédiat. Il a établi le siège de son archidiocèse dans la capitale du royaume du Kent à Cantorbéry.
BEDE, préc. au par. 33, pp. 77-84.
Par. 43 L’évangélisation de l’Angleterre a échappé pour un temps au contrôle de Cantorbéry et de Rome au profit du monastère d’Iona. Cet établissement, situé sur une ile désolée au large des côtes de la Calédonie, l’Écosse actuelle, avait été fondé en 563 par l’Irlandais Colomba. C’est là qu’Oswald, un Angle exilé, s’est converti au christianisme avant de monter sur le trône de Northumbrie en 634. Iona a alors envoyé ses propres missionnaires avec l’appui d’Oswald, faisant du monastère celte un second foyer d’évangélisation. En plus de la Northumbrie, les missionnaires d’Iona ont prêché avec succès en Mercie et en Essex. De son côté, la papauté a renouvelé ses encouragements au siège archiépiscopal de Cantorbéry. De nouveaux efforts lui ont permis d’évangéliser le Wessex et l’Estanglie. Lors de la tenue d’un synode des évêques convoqués à Whitby en 663, le roi Oswiu de Northumbrie a transféré son allégeance spirituelle de Iona à Rome. Le premier concile de l’Église d’Angleterre unifiée se réunira enfin à Hertford 10 ans plus tard. Elle consolidera le statut de Cantorbéry comme siège de l’archidiocèse. Et son archevêque se verra conférer le titre de primat de l’Église d’Angleterre, une position qu’il occupe toujours aujourd’hui. Encore 10 ans seront nécessaires pour achever la conversion de l’Angleterre à la foi chrétienne après l’envoi de missionnaires dans le Sussex, la dernière terre d’évangélisation.
Bède, id., p. 276-281.
Par. 44 À la demande du pape Grégoire II, le Saxon Wynfrid, aussi connu comme saint Boniface, a quitté le Wessex en 716 pour évangéliser les Saxons de Germanie. Son entreprise suscita apparemment un immense enthousiasme dans toute l’Angleterre. L’aide venant de partout afflua. Boniface ne manqua pas d’encourager ce sentiment : en 738, pour donner à son mouvement d’évangélisation la plus forte adhésion possible, il a lancé un appel à tous les Anglo-Saxons les exhortant à lui venir à l’aide pour convertir leurs frères avec lesquels ils partageaient sang et os (blood and bone). Rien de tel qu’adhérer à une entreprise commune pour créer le sentiment d’appartenir à une même nation !
WILLIBALD, The Life Of Boniface, rédigé aux environ de 768, traduction anglaise par G.W. Robinson, Cambridge, Harvard University Press, 1916, p. 66-67; Boniface, cité par P. WORMALD, « Bede, the Bretwaldas and the Origins of the Gens Anglorum », dans P. Wormald (éd.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society, Oxford, Basil Blackwell, 1983, p. 122.
Par. 45 Nous voyons que pour Bede, les termes d’Angles et de Saxons pouvaient être entendus de façon large pour ainsi désigner tous les peuples venus en Bretagne depuis la Germanie. Et c’est quelques années plus tard, avec la diffusion de ses écrits, vers la fin du VIIIe ou au début du IXe siècle, mais assurément sous le règne d’Alfred le Grand (871-899), que les Saxons, les Angles et les Jutes, se sont ainsi reconnus comme des Anglo-Saxons ou, parfois et plus simplement, comme des Anglais. Et c’est toujours sous le règne du roi Alfred que l’idée d’une nation politique anglo-saxonne ou anglaise arrivera à maturité. Le lien entre ces deux évolutions semblaient s’imposer.
M. RICHTER, « Bede’s Angli : Angles or English? », (1984) vol. 3 Peritia 114, plus précisément aux pp. 112-113 ; S. FOOT, « The Making of Angelcynn : English Identity Before the Norman Conquest », Transaction of the Royal Historical Society, J., Cambridge University Press, 2009, p. 25.
Par. 46 Moins de trois siècles après leur formation, les royaumes anglo-saxons ont dû se défendre à leur tour contre les attaques de puissants guerriers : des Vikings. Ils venaient de Norvège, de Suède et du nord du Danemark. Toutefois, les Anglo-Saxons ont pris l’habitude de les appeler indistinctement Danois ou Danes en langue anglaise. Ces derniers, naviguant sur leurs drakkars, auraient fait des incursions régulières sur les côtes de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande. Les Chroniques anglo-saxonnes relatent les plus célèbres attaques portées contre les monastères de l’île de Lindisfarne et de Jarrow en Northumbrie dans les années 793 et 794. Les hommes du Nord y ont massacré leurs moines et pillé leurs richesses.
CHRONIQUES, préc. au par. 33, A.D 793-794, p. 51.
Par. 47 Les Vikings ont changé de vocation à partir du dernier tiers du IXe siècle ; sans abandonner complètement leurs anciennes habitudes de pirates, plusieurs d’entre eux se sont convertis en colons. On les a vus notamment s’établir dans le nord-ouest de la France, une partie de la Neustrie de l’ancien Empire franc. En 911, se trouvant incapable de les repousser, le roi de France Charles III, dit le Simple, a reconnu à leur chef Rollon la juridiction sur les diocèses de Rouen et d’Évreux. Rollon, qui se faisait appeler indifféremment comte ou prince, a agrandi son territoire en lui annexant les diocèses de Bayeux, de Lisieux et de Sées. Son fils Guillaume Longue Épée a poursuivi l’expansion jusqu’en 933 en capturant les diocèses de Contentin et d’Avranchin, puis les îles de Jersey, de Guernesey et de Serq. Les territoires conquis ont pris le nom de Normandie, autrement dit la terre des hommes du Nord, qui avait à peu près atteint ses frontières de province sous l’ancien régime français. Richard Ier, fils de Guillaume Longue Épée et petit-fils de Rollon, premier de la ligné des Richardides, a pris le titre de duc de Normandie en 996. Plus jeune, il avait adopté la langue locale, une langue d’oïl à base latine voisine du français. Le quatrième duc de Normandie, Guillaume II, surnommé le Bâtard puis le Conquérant, jouera à partir de 1066 un rôle déterminant dans l’évolution constitutionnelle de l’Angleterre. Son aumônier Guillaume de Poitiers et autrefois moine de Jumièges, lui a consacré une courte biographie dans laquelle il raconte son histoire et celle de sa famille depuis Rollon.
G. de POITIERS. Sa première édition en langue française a été publiée à Caen en 1826 chez le libraire Mancel par M. Guizot, sous le titre Histoire de ducs de Normandie, et suivie de la vie de Guillaume-le-Conquérant.
Par. 48 Peu avant l’époque de Rollon, vers 865, les Vikings, ou les Danois comme les Anglais les appelaient, avaient également amorcé la conquête de l’Angleterre. Leur armée a ravagé l’Estanglie, le Sud de la Northumbrie et le Nord de la Mercie, où ils se sont installés à demeure. On a appelé les régions conquises la terre du Danelaw, littéralement la terre régie par les lois des Danois. Elle couvrait près de la moitié de l’île.
Carte 7

Par. 49 Seul le Saxon Alfred le Grand, roi du Wessex de 871 à 899, a réussi à contenir les hommes du Nord. Après son succès à la bataille d’Edington en 878, il a contraint le chef Guthrum à négocier la paix et le retrait de ses troupes au-delà des frontières du Danelaw. Alfred a ainsi mis hors de danger le Wessex, le Kent et le Sud de la Mercie. Une pause de huit années a suivi avant qu’il ne capture la ville de Londres. Après ce fait d’armes, il s’est désigné comme le roi de tous les Anglo-Saxons, une prétention plus qu’une réalité, car les Danois avaient conservé leur maîtrise de la terre du Danelaw.
J. ASSER, membre du personnel de la Cour d’Alfred, Asser’s Life of King Alfred, ouvrage rédigée vers 893, traduit en langue anglaise par A.S. Cook, Boston, The Athenaum Press, 1906.
Portrait fictif d'Alfred le Grand, 1661-1662
University College, Oxford
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 50 Alfred et ses successeurs ont néanmoins conservé un avantage indéniable sur leurs opposants danois, soit celui d’être les seuls souverains de race indigène, avec la légitimité que cela comportait auprès des populations anglo-saxonnes. Être en présence d’un ennemi commun a effectivement permis d’oublier les vieilles rancunes. Il suffira donc qu’un roi du Wessex, tel Alfred ou ses successeurs, libère une terre anglaise du joug danois pour que ses habitants se rallient à sa cause. Dès lors, l’unification politique des Anglo-Saxons s’avèrera réalisable dans l’esprit de ses dirigeants.
ASSER, id., p. 47; STENTON, préc. au par. 37, p. 343.
Par. 51 La contre-offensive a commencé sous les règnes des rois Édouard l’Ancien (899-924) et Athelstan le Glorieux (924-939), les fils et petit-fils d’Alfred. Ils ont remporté victoire sur victoire et contraint les Danois à se soumettre, sans pour autant obliger les non-combattants et ceux qui rendaient les armes à quitter l’Angleterre. Athelstan a ainsi achevé la réunification de l’ancienne province romaine de Bretagne en 928. Il aurait régné sur l’ensemble des peuples anglo-saxons, du moins était-ce sa prétention. On frappa d’ailleurs des pièces de monnaie à son effigie avec l’inscription rex totius Britania : roi de toute la Bretagne. Il pourrait donc raisonnablement être considéré comme le premier roi de l’Angleterre unifiée.
STENTON, id., p. 349.
Par. 52 Les navigateurs danois étaient de retour en force avec leurs drakkars dans les années 980 et 990. À partir de 991, ils ont soutiré du roi anglo-saxon Ethelred le Malavisé (règne 978-1016) le paiement d’un tribut annuel en argent, pour lequel un impôt spécial a été levé : le danegeld. Ce tribut a calmé l’ardeur des Danois pendant une décennie, jusqu’à ce qu’un brulot ravive leur désir de combattre. C’était le 13 novembre 1002, jour de la Saint-Brice. D’après les Chroniques anglo-saxonnes, Ethelred aurait craint que les Danois établis en Angleterre ne complotent pour le tuer et s’emparer de son royaume. Le roi a alors ordonné de les massacrer, une décision qui lui a possiblement valu son surnom. Qui exactement devait mourir ? Et combien y-a-t-il eu de mort ? Impossible de le savoir. Mais l’évènement fut certainement considérable, car Svein à la Barbe Fourchue, roi du Danemark, l’invoqua pour motiver ses troupes à venger leurs frères de sang. Il a débarqué en Angleterre l’année suivante. Les attaques des guerriers vikings ont repris comme avant, peut-être avec l’ambition prochaine de pousser plus loin leur avantage.
CHRONIQUES, préc. au par. 33, A.D 1002-1003, p. 89.
Par. 53 En effet, les hommes du Nord voulaient cette fois faire mainmise sur toute l’Angleterre. Et ils ont réussi. Après que le roi Ethelred ait été contraint à l’exil en 1013, la noblesse du pays, confrontée à l’inévitable, a reconnu Svein comme le roi d’Angleterre. Celui-ci n’a malheureusement survécu que quelques mois à son triomphe. Ethelred en a profité pour réoccuper son trône. Il devait cette fois mourir, le 23 avril 1016. Une guerre civile a par la suite opposé les fils des deux rois précédents : Edmond Côte-de-Fer et Knut. Et c’est Knut, dit le Grand, fils de Svein, qui s’est imposé. Brillant stratège, homme sage quoique impitoyable, Knut le Grand a voulu apaiser les tensions et rallier l’aristocratie anglaise en épousant Emma de Normandie, la veuve d’Ethelred, qui sera également une conseillère écoutée. Un autre Saxon très influent à la cour a été Godwin, un noble désargenté à la suite de la trahison de son père lors du règne d’Ethelred, mais réhabilité par Knut qui l’a nommé comte. Le Danois conservera la Couronne d’Angleterre jusqu’à sa mort en 1035. Deux autres rois, des demi-frères, ont continué sa lignée : Harold Pied de Lièvre, fils de Knut le Grand et d’Aelgifu de Northampton, a régné de 1035 à 1040, et Knut le Hardi, fils de Knut le Grand et d’Emma de Normandie, a régné de 1040 à 1042.
CHRONIQUES, id., A.D 1035, p. 101.
Par. 54 La dynastie du Saxon Alfred le Grand a été rétablie en la personne d’Édouard, surnommé le Confesseur, qui a gouverné l’Angleterre de 1042 à 1066. Édouard était le fils du roi saxon Ethelred le Malavisé et d’Emma de Normandie, la même Emma qui épousa en secondes noces Knut le Grand. Édouard était par conséquent le demi-frère de Knut le Hardi par sa mère. Une fois ce dernier au pouvoir, Emma l’a convaincu de s’associer Édouard. Peu après, le 8 juin 1042, le Hardi mourait, laissant le chemin libre à Édouard qui a réclamé le trône avec l’appui des grands du royaume.
Arbre généalogique 1
(Svein à la Barbe Fourchue et Harold Godwinson ont été omis en raison de la brièveté de leur règne)

Par. 55 Édouard le Confesseur a été un roi faible dans la dernière partie de sa vie. Il a laissé les rênes du gouvernement entre les mains des grands seigneurs, ses comtes, les earls anglais Godwin, Waltheof, Edwin, Morcar et Oswulf. Édouard s’est conduit en homme simple, bon, pieux et droit, des qualités remarquables qui lui ont permis d’être élevé à la sainteté en 1161, tout en étant fort peu compatibles avec l’exercice du pouvoir à cette époque troublée. Édouard, mort le 5 janvier 1066, devait être l’avant-dernier roi de race saxonne. Après le court règne de dix mois d’Harold Godwinson, le fils du comte saxon Godwin, Guillaume, duc de Normandie, établira sa propre lignée en faisant la conquête de l’Angleterre en 1066.
2. Constitution anglo-saxonne des origines
2.1 Gouvernance
Par. 56 Avant de débarquer sur les côtes de l’île de Bretagne, les Angles, les Saxons et les Jutes habitant la Germanie vivaient en petites tribus sous l’autorité d’un chef semblable à un roi. Ils pratiquaient l’élevage du bétail et la chasse, mais non l’agriculture, une activité qu’ils méprisaient. Toute leur vie gravitait autour de la chasse et de leur bétail, quand la guerre ne les occupait pas. Les coutumes des peuples barbares d’Europe centrale, avant leur migration, sont enveloppées de brouillard. Ce que l’on en sait vient des écrits des intellectuels grecs et romains des deux premiers siècles de l’ère chrétienne, surtout l’Origine et le pays des Germains de Tacite, mais aussi l’Histoire naturelle de Pline et le Manuel de Géographie de Ptolémée. Bien que les mœurs et les usages des peuples de Germanie différaient d’une population à l’autre, il est néanmoins possible d’en tracer un portrait très approximatif grâce à ces auteurs.
Pour le développement suivant, lire également TODD, Malcolm, The Early Germans, 2e éd., Malden (Massachusetts), Blackwell Publishing, 2004.
Par. 57 Les hommes libres des sociétés germaniques étaient en principe égaux. Il existait néanmoins une noblesse héréditaire. Tacite a appelé ses membres des ducs ou decus en latin. Dans la langue des Saxons, on les appellera plutôt des gesiths, terme que nous continuerons d’employer par commodité. Au sein des populations germaniques, on a toujours distingué entre les personnes nées nobles et les gens du commun.
Par. 58 Chaque gesith prenait dans sa demeure de jeunes garçons qu’il nourrissait, éduquait et protégeait. Devenus adultes, ceux-ci formaient un groupe de compagnons d’armes, sa bande de guerriers, des partisans personnellement dévoués à leur seigneur. Les Romains appelait cette institution le comitatus. On dirait fosterage en anglais ou compagnonnage en français. La bande représentait la principale unité militaire et le fondement du pouvoir du seigneur au sein de la tribu. Un gesith continuait d’assurer sa prééminence en se montrant généreux. Loger ses compagnons, tenir des banquets, procurer des armes, donner des chevaux donner des harnachements, des étoffes précieuses ou des pierreries, composaient les principales manifestations de générosité. En échange, le gesith s’attendait à ce que ses guerriers le suivent en toutes choses, notamment lorsqu’il fallait mener une action de police, effectuer un pillage, voire entreprendre une conquête.
Par 59 Le gesith servait comme cadre dans l’armée de son roi. Le sort des combats dépendait souvent de sa bravoure. Il y mettait d’autant plus de conviction qu’il y voyait un avantage personnel. Voilà pourquoi le roi se conduisait envers ses gesiths comme ceux-ci le faisaient envers leurs guerriers, autrement dit en se montrant généreux. La réussite d’un roi se mesurait conséquemment au nombre de ses victoires et au butin capturé qu’il redistribuait ensuite parmi les siens pour se les attacher davantage, un comportement observé également tant chez les Vikings que chez les Francs.
Par. 60 Le gesith participait à un conseil appelé le Witenagemot, ce qui signifie l’assemblé des sages, ou plus simplement le Witan, les hommes sages. Le Witan, dont la composition restait fluctuante, se réunissait fréquemment. Si le roi exerçait une autorité quasi absolue lors d’une expédition militaire, l’accord du Witan lui était nécessaire pour gouverner en temps de paix. De la sorte, le roi associait à ses projets et à ses décisions les hommes les plus influents, ceux qui étaient responsables de mettre en œuvre les mesures élaborées en commun. Le roi et le Witan délibéraient ensemble et exclusivement sur les affaires de routine. Pour les questions plus importantes, ils débattaient des enjeux, s’entendaient sur les solutions, puis les soumettaient à tous les hommes libres, réunis en assemblée, qui les acceptaient ou les refusaient. Cette assemblée avait pour nom Thing, parfois Althing. Ses membres étaient les thingmen. Les guerriers du Thing se réunissaient périodiquement en respectant un calendrier déterminé. Après que les prêtres eurent ordonné le silence, le roi prenait d’abord la parole, puis chacun se faisait entendre selon son âge, sa noblesse, son éloquence et la gloire qu’il s’était acquise à la guerre. On persuadait par son prestige plutôt qu’en vertu de son autorité. Les thingmen montraient leur désapprobation par un murmure et leur assentiment par le bruit de leurs armes s’entrechoquant.
Par. 61 L’un des rôles du Witan était de choisir le chef ou le roi de la tribu. Parce que la vie et le bien-être de tous en dépendaient, le Witan jouissait d’une certaine liberté. Il devait se fixer sur l’un ou l’autre des membres de la famille du chef défunt. Ce pouvait être un fils, un frère, un oncle ou un cousin. L’avantage allait au fils aîné, mais le Witan n’était obligé par aucune loi de primogéniture ; il écartait souvent l’aîné pour lui préférer un autre membre de la famille régnante qui lui semblait plus sage ou meilleur général. Une fois la décision prise par le Witan, l’héritier présomptif se présentait devant l’assemblée plénière des guerriers, le Thing, qui confirmait son élection à la magistrature suprême. Mais sa position n’était jamais assurée. S’il perdait la confiance de son peuple, un roi pouvait toujours être démis de ses fonctions par le Witan.
Par. 62 Après le roi, sa famille et les membres de la noblesse, les guerriers étaient considérés comme les hommes les plus importants de la tribu. Leur profession, respectée entre toutes, avait pour vertus la loyauté, le courage et l’habileté au combat. Pour un guerrier, il n’était pas question de gagner par la sueur ce qu’il pouvait acquérir par les armes. Il méprisait le travail domestique. Tout le temps que le guerrier ne passait pas à la guerre ou à entretenir les ponts et les ouvrages de défense, il le consacrait un peu à la chasse, mais davantage à se reposer, à manger et à dormir. Sa femme, ses enfants et les autres personnes de sa maison, jugées inaptes au combat, s’occupaient de l’entretien des propriétés et de la garde du cheptel familial.
Par. 63 On trouvait également, tout au bas de l’échelle sociale, les esclaves. Étant considérés comme des objets de propriété, ils ne disposaient d’aucun droit défini. Le roi, les seigneurs, tout comme les guerriers les plus fortunés, les employaient pour accomplir les tâches au-dessous de leur condition. L’institution de l’esclavage, qui existait déjà en Bretagne au moment de l’invasion germaine, tombera en défaveur et sera socialement déconsidérée en Angleterre à partir de 1102, lorsque le concile de Londres tenu sous l’égide de l’archevêque Anselm l’a condamnée par décret ecclésiastique. Il faudra toutefois attendre le XIXe siècle pour que le Parlement de Westminster abolisse l’esclavage des gens de couleur dans tout l’Empire britannique, dans La loi pour l'abolition de l'esclavage, (1833) 3 & 4 Will. 4, c. 73.
W.R.W. STEPHENS et W. HUNT (éds.), A History of the English Church, vol. II, Londres, McMillan & Co., 1901, p. 121.
2.2 Administration de la justice
Par. 64 La justice était décentralisée comme l’était le pouvoir au sein de la société tribale. On ne trouvait pas d’organisation bureaucratique responsable de l’application du droit. Les individus les plus importants, à cet égard, étaient les chefs de clan. Un clan était un groupe de personnes apparentées, soit par les liens du sang, soit par alliance, correspondant plus ou moins à la famille élargie. Chaque chef de clan veillait à ce que les membres de sa famille obtiennent justice. Or, dans cette société san État, sans autre institution centrale que l’assemblée du Thing, l’ordre étant maintenu au moyen de représailles, de vendettas, autrement dit par des vengeances institutionnalisées. Quand un homme subissait un dommage, il incombait à son clan de le venger. Ce dernier en faisait une question d’honneur. Un meurtre, une blessure ou un vol, appelait une réponse du même ordre. On pense immédiatement à l’antique loi du Talion, cette règle qui consiste à infliger au coupable le même traitement qu’il a fait subir à sa victime. Toutefois, à la différence de cette loi, la vendetta visait non seulement l’auteur du dommage, mais également tout son clan.
Par. 65 Dans ce régime de responsabilité collective où le clan entier répondait des actes de ses membres, chacun avait intérêt à discipliner ses parents et alliés afin d’éviter de payer pour leurs erreurs, tant par ses biens que par son sang. La vendetta n’était alors pas considérée comme de la violence aveugle. Mais bien comme un acte de justice. Encore fallait-il qu’elle ait été acceptée par l’autre clan. Dans le cas contraire, une vendetta conduisait à des représailles, puis à des contre-représailles, et ainsi de suite, créant alors un cercle de violences sans fin. Ces querelles familiales étaient fréquentes, avec leur lot de souffrances pour les familles concernées et pour la tribu dans son ensemble.
Par. 66 On sait que la vengeance comme acte de justice a continué après l’invasion de la Bretagne et s’est poursuivie durant toute l’époque anglo-saxonne et même au-delà.
Par. 67 Si ses membres voulaient que la tribu survive, que ses guerriers demeurent en état de combattre et de la défendre, il leur fallait réduire la violence institutionnalisée. Un autre mode de règlement des litiges a donc été encouragé : l’octroi d’une compensation à la victime ou à son clan. Le paiement devait avoir pour effet de calmer leur désir de vengeance. Afin d’éviter que la partie lésée refuse une offre jugée insuffisante, le montant des dommages était déterminé à l’avance. Il variait selon que la victime avait été tuée, blessée plus ou moins gravement, ou encore lésée dans ses biens. On considérait également son sexe, son âge et sa condition sociale. Un gesith valait plus qu’un guerrier et une femme en état d’enfanter plus qu’une femme âgée ou infertile. Les Anglo-Saxons ont appelé ce montant le wergel ou le bot, suivant qu’il fallait compenser la mort d’un homme libre ou un dommage moins important. Parfois, on jugeait que le délinquant n’expiait pas suffisamment ses fautes en offrant une compensation à la victime ou à sa famille. Une indemnité additionnelle pouvait donc être exigée pour les fautes les plus graves. On différentia alors entre les notions de wer, la compensation, et de wite, la punition.
Par. 68 On ne distinguait pas encore entre le droit criminel, où une punition est infligée au délinquant pour une infraction contre la société, et le droit civil, où une réparation est accordée pour compenser le dommage causé à la victime par la commission d'un délit. Cette opposition apparaîtra plus ou moins au cours du Xe siècle, lorsque les rois ont montré un intérêt accru et persistant à combattre les crimes, entendus alors dans le sens d’actes violant gravement tout comportement acceptable. Leur intention était de diminuer la violence autrement que par l’exercice de la vengeance, de la vendetta, la méthode habituelle et acceptée dans le monde anglo-saxon.
HYAMS, P., « Feud and the State in Late Anglo-Saxons England », (2001) vol. 40 Journal of British Studies 1, p. 13-17.
Par. 69 À partir du règne d’Aethelred le Malavisé (règne 978-1016), quelques infractions ont été jugées si graves qu’elles ne pouvaient plus faire l’objet d’un règlement négocié privément avec les victimes. Elles étaient considérées botless, ce qui signifie irréparables. Il en était ainsi lorsqu’un homme trahissait son seigneur, tuait son ennemi pendant son sommeil, commettait un parricide ou encore un incendie volontaire. La peine pouvait être la mort, la mutilation, l’esclavage, la mise hors-la-loi ou l’exil. Il arrivait cependant que l’on substitue à ces peines une lourde amende. Comme la communauté entière pouvait s’estimer lésée par de tels actes, tous, et non seulement les victimes et leurs amis, avaient le devoir de poursuivre ces délinquants et les autres personnes qui troublaient la paix (peace-breakers). L’idée était radicale pour l’époque. Le problème, parce que de telles infractions étaient jugées irréparables, est que les victimes n’obtenaient plus rien. Elles se trouvaient dans la situation où elles ne jouissaient plus d’aucun recours. On corrigera cette situation seulement un siècle plus tard, sous le règne d’Henri Ier. Nous en reparlerons.
HYAMS, id., pp. 18 et 19; W. HOLDSWORTH, A history of English Law, vol. 2, 3e éd., Sweet and Maxwell, Londres, 1923, pp. 48-49; D.C. DOUGLAS, English Historical Documents, vol. 2 (1042-1189), 2e éd., Londres, Routledge, 1981, p. 363-367 (ci-après cité E.H.D.).
Par. 70 Une fois admis le principe de l’octroi d’une compensation, la difficulté restait de forcer le délinquant, l’auteur du dommage, à se soumettre à la juridiction d’un tribunal. Car lorsque celui-ci avait l’appui de ses proches, son intérêt le portait à refuser sa juridiction, parce qu’il pouvait croire qu’il sortirait gagnant d’une lutte contre la famille de la victime. Le délinquant n’était pas seul concerné par cette décision. La victime ou les membres de son clan devaient également être convaincus qu’il valait mieux se rendre au tribunal que d’exercer leur droit de vengeance. Aucune procédure n’obligeait, ni l’une, ni l’autre partie, à s’engager dans une telle procédure. Il fallait absolument l’accord des deux. La juridiction d’un tribunal dépendait toujours de leur consentement.
Note : Le consentement d’une personne accusée d’un acte criminel à la juridiction du tribunal qui devait le juger demeurera une exigence du droit anglais jusqu’en 1772, le moment de son abolition par la Loi sur les félonies et les actes de piratage, 12 Geo. 3, c. 20.
Par. 71 Rien, cependant, n’empêchait de faire pression pour soutirer un consentement, surtout lorsque la partie qui s’y refusait était l’auteur du dommage. Sa tribu ou son clan pouvait alors saisir ses biens ou le déclarer hors-la-loi. Plus tard, en Angleterre, les officiers du roi emprisonneront l'accusé tout en le soumettant à la torture, tant qu’il ne donnera pas son consentement. Car tous avaient intérêt à empêcher qu’une querelle de famille ne dégénère en conflit permanent.
Par. 72 Des notables élus par les thingmen se rendaient dans les cantons et les bourgs afin de rendre justice. Chacun était assisté par cent compagnons choisis dans le peuple. Ces assemblées locales, dont le rôle était autant politique que judiciaire, avaient pour nom Var-Thing et Leith-Thing. On pouvait porter leurs jugements en appel devant l’assemblée tribale du Thing. Les décisions judiciaires de ces diverses assemblées, appelées dooms, se voulaient le reflet des coutumes du pays. Les dooms contenaient la totalité du droit, non sans ressemblance avec ce qui deviendra plus tard la common law anglaise.
Par. 73 Nous venons de faire un portrait grossier et probablement idéalisé des institutions des Angles, des Saxons et des Jutes, à leur arrivée dans l’île de Bretagne. Comme vu précédemment, on a souvent qualifié la période de formation des royaumes de l’Heptarchie, entre 450 et 600, d’époque obscure de l’histoire de l’Angleterre, en raison de la pauvreté des archives. Les hypothèses et les spéculations sont conséquemment inévitables. Nous croyons cependant que l'essentiel a été dit de manière à comprendre l'évolution subséquente du droit anglo-saxon et du droit anglais.
2.3 Évolution de l’institution royale après l'arrivée des germains en Bretagne
Par. 74 Lorsqu’ils se trouvaient en Germanie, Angles, Saxons et Jutes, vivaient en petites tribus. Leurs activités principales, mentionnées plus tôt, étaient l’élevage du bétail, la chasse et la guerre. Ils n’avaient pas de villages permanents, seulement des établissements temporaires. Parce qu’ils dédaignaient le travail de la terre, celle-ci ne comptait pas parmi les biens les plus importants. La tribu pouvait toujours déménager et s’installer là où il y avait de nouvelles richesses à piller. Un bon chef était donc un bon général, courageux, habile aux métiers des armes, fidèle en toutes choses, généreux avec ses hommes comme avec son peuple.
Par. 75 Après s’être adonnés au pillage des côtes de l’île de Bretagne, plusieurs gesiths germains et leurs hommes ont choisi de s’y installer pour en faire leur demeure. Lorsque le pouvoir d’un homme se mesure à sa générosité, il doit dès lors rentabiliser sa position s’il souhaite conserver son statut. La Bretagne offrait cette possibilité au gesiths. En plus du butin habituel, ils ont certainement redistribué une partie des terres qu’ils s’étaient appropriées et en ont conservé le reste. Ces terres ont acquis une importance nouvelle à partir du moment où les Germains ont entrepris de les cultiver. Prudemment géré. Le capital amassé par les seigneurs de guerre est passé à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Les plus habiles d’entre eux ont pu s’élever au rang de roi. De nouvelles monarchies anglo-saxonnes sont ainsi apparues dans toute la Bretagne.
Par. 76 Les Angles, les Saxons et les Jutes de Bretagne se sont donc convertis à l’agriculture. Ils ont également développé leur habileté au commerce afin de se procurer les aliments manquants et les outils nécessaires à l’exploitation de leur terre. Ils construisaient plus solide et pour plus longtemps. La richesse, accrochée au sol, valait désormais la peine d’être protégée. Pressé par l’opinion, le roi s’en est chargé, car lui-seul était en position de le faire. Ses tâches étaient nombreuses. Il devait défendre les frontières d’un royaume toujours plus grand avec ses villes, ses villages, ses campagnes, ses églises et ses monastères. Le roi ne pouvait se satisfaire d’être un bon général comme au temps de ses ancêtres germains, il lui fallait aussi démontrer des qualités d’habile négociateur, de diplomate accompli, en corrompant ses ennemis si nécessaire ou en forgeant des alliances avec ses voisins lorsque l’occasion se présentait. Le roi devait également protéger ses sujets contre les désordres intérieurs. Pensons au viol, à l’incendie criminel, à la fraude et autres méfaits qui nuisaient au commerce ou aux progrès de la religion. Il s’obligera donc à garantir la paix et à superviser l’administration de la justice.
Note : Les plus anciennes lois anglo-saxonnes consignées par écrit remontent au règne du roi Ethelbert de Kent, le même qui a été converti par saint Augustin en 597. Ces lois, fondées sur la coutume, restaient fort incomplètes ; elles énuméraient seulement les sanctions pour plusieurs crimes, de l’homicide à la fornication, ainsi que la compensation prévue pour chacun (Voir L. OLIVER, The Beginnings of English Law, Toronto, University of Toronto Press, 2002, pp. 52-116 ou F.L. ATTENBOROUGH, The Laws of the Earliest English Kings, Cambridge, Cambridge University Press, 1922, pp. 4-17). Toutefois, la responsabilité d’appliquer le droit demeurait entre les mains du clan.
Par. 77 En résumé, et quoique son pouvoir ait été encore mal assuré, le roi avait accaparé les principales fonctions qui relèveront plus tard de l’État. Il demeurait cependant impuissant sans l’aide d’un nombre croissant de serviteurs, l’embryon d’une bureaucratie d’État. Répondant aux noms les plus divers, thanes ou thegns, ealdormen, earls ou reeves, ces serviteurs levaient des armées de conscrits, poliçaient les domaines du roi de même que les principales routes et autres lieux sous sa juridiction, veillaient au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires, supervisaient la construction et la réparation des infrastructures de défense, des routes, de la flotte et des ports de mer, et percevaient les taxes et les impôts indispensables au financement des nouvelles responsabilités du roi.
Par. 78 Entre 450 et 600, les pouvoirs du roi anglo-saxon se sont donc accrus en proportion de la taille de son royaume, aux dépens des premiers gesiths germains et de leurs guerriers. Le rôle des guerriers dans la gouvernance du royaume est d’ailleurs devenu presque négligeable avec la disparition de l’assemblée du Thing. Ils formaient désormais la classe des hommes libres connus sous les noms de ceorls ou churls. Quant à l’ancienne noblesse, elle a été supplantée par une aristocratie de fonction composée des principaux serviteurs de la Couronne : les thanes ou thegns. Avec le temps, le mot thane a fini par désigner toute personne d’importance, soit en raison de son emploi au service du roi, soit en raison de sa richesse. Le roi, pour sa part, ne gouvernait plus qu’avec le Witan où seuls les principaux thanes étaient appelés à siéger. Apparemment, l’Angleterre n’aurait jamais connu sur son sol une société démocratique, même limitée à l’ensemble des hommes libres comme dans la Germanie de ses ancêtres. Une fois les Anglo-Saxons christianisés, le haut clergé, soit les archevêques de Cantorbéry et d’York, les évêques et les grands abbés, ont aussi été invités à participer aux travaux du Witan. Enfin, les membres de la famille royale, désignés par le titre d’aetheling, y siégeaient également d’office.
Par. 79 Les liens entre le roi et ses thanes pouvaient de moins en moins être expliqués avec le seul vocabulaire du clientélisme, comme dans la vieille Germanie. Il faudrait plutôt évoquer la présence progressive de vassalité pour décrire dorénavant leurs rapports. La vassalité, une innovation assez récente, avait été développée en France par le maire du palais Charles Martel dans les années 730, si l’on se fie à l’apparition dans les archives du terme latin vassus, le vassal. Mais nous y reviendrons bientôt.
Par. 80 Avant l’arrivée de la vassalité, donc pour les premiers rois anglo-saxons, le vrai problème n’était pas d’accéder au pouvoir, mais de s’y maintenir. Rappelons que les populations germaines attendaient de leur roi qu’il fasse preuve de générosité. Certes, le mercenariat, les raids et les conquêtes l’aidaient à remplir ses coffres, tant qu’il y avait de nouvelles terres à piller ou à conquérir. Il s’agissait néanmoins d’une fuite en avant qui ne pouvait continuer sans fin dans le monde insulaire de la Bretagne devenue l’Angleterre. Le roi a donc dû trouver des apports d’argent frais. Ses nouvelles sources de revenus ont d’abord été l’imposition de tributs, le service militaire, le devoir d’hospitalité et l’élargissement du domaine royal.
Par. 81 Les premiers rois anglo-saxons ont agrandi leur territoire en s’appropriant les principautés voisines. Nous avons vu que cette entreprise de consolidation s’est réalisée par étapes, pour aboutir à la création des sept royaumes de l’Heptarchie. Outre le butin récolté, soit l’habituelle prise de guerre, ces nouveaux rois ont exigé des populations nouvellement soumises le paiement d’un tribut annuel, en échange de leur protection. Cela revenait à une taxe prélevée sous la menace de violence en cas d’opposition. Le calcul du montant du tribut dépendait de l’étendue du territoire conquis. L’unité de mesure servant à son calcul était la superficie de terre requise pour l’entretien d’un homme libre, avec sa famille et ses dépendants, que l’on a appelé en vieil anglais le hide. Cette superficie variait selon les régions et la qualité des terres cultivables. Elle pouvait être d'environ 600 acres. Évidemment, dès qu’un roi annexait les terres conquises à son royaume, et qu’il faisait donc de ses habitants ses sujets, il devait cesser tôt ou tard cette forme d’extorsion.
STENTON, préc. au par. 37, p. 279.
Par. 82 Le hide a servi pour les fins de taxation jusqu’au règne du roi Henri II (1154-1189). Un impôt foncier universel, le danegeld, calculé à partir du nombre de hides possédés, sera mis en place à partir de 991, lorsque le roi anglo-saxon Ethelred le Malavisé voudra acheter la paix aux Danois. Après l’échec de cette politique, et la reprise des combats suivant le massacre de la Saint-Crépin, on continuera à percevoir le même impôt sous un autre nom, le heregeld, cette fois pour défrayer les coûts d’entretien de mercenaires placés sous l’autorité du roi. Le fait que le roi anglo-saxon ait pu prélever un tel impôt, alors inconnu dans les autres royaumes d’Europe, démontrait l’achèvement d’un degré important de centralisation pour l’époque.
STENTON, id., pp. 644-646.
Par. 83 Le roi anglo-saxon a également réclamé de ses nouveaux comme de ses anciens sujets de servir dans son armée régulière. Chaque homme libre devait combattre. S’il ne se présentait pas après sa convocation, il était frappé d’une amende. L’armée du roi était appelée le fyrd, vieux terme anglais qui désignait littéralement une expédition militaire. Les thanes répondaient directement à l’appel du roi, alors que les simples hommes libres, les ceorls, accomplissaient leur service militaire sous les ordres de leur seigneur respectif. Il incombait au soldat du Moyen Âge de défrayer le coût de son équipement. Bien que les hommes libres aient été juridiquement des égaux, leur armement variait selon leur fortune. Les ceorls financièrement aisés se procuraient un cheval et son harnachement, en plus de l’armement coûteux du cavalier. Les moins bien nantis, par contre, se contentaient de servir comme fantassins, ou encore approvisionnaient l’armée en marche. Plus tard, sous le règne du roi angevin Henri II (1154-1189) et de ses fils Richard Cœur de Lion (1189-1199) et Jean sans Terre (1199-1216), les guerriers combattant à cheval constitueront la nouvelle noblesse des chevaliers, ou knights en langue anglaise.
Par. 84 Outre le service militaire, le roi exigeait des membres de l’aristocratie de le loger et de le nourrir lorsqu’il voyageait. Ce devoir d’hospitalité devenait d’autant plus nécessaire que le royaume s’agrandissait et que le roi, pour s’assurer que son autorité était respectée, devait le parcourir régulièrement. L’obligation de loger le roi s’avérait parfois lourde, car celui-ci voyageait normalement avec les membres de sa cour, ses grands thanes et ses domestiques, sans oublier les chevaux et les chiens. En contrepartie, les hôtes du roi pouvaient espérer influencer sa politique ou s’attirer ses faveurs.
Par. 85 Le roi ne dépendait pas toujours de l’hospitalité de l’aristocratie pour assurer son repas et son gite ; il se rendait également dans l’un de ses nombreux tons ou towns. Un ton était un village anglo-saxon gouverné par un seigneur, soit un thane, soit le roi lui-même. Dans ce dernier cas, le village se trouvait être un kingston. Chaque ton comprenait une résidence principale avec ses bâtiments attenants qui servaient à loger le seigneur, ainsi que des manses occupées par les villageois pour lesquels ces derniers payaient un loyer en biens ou en argent et fournissaient certains services. Un ton n’était pas vraiment la propriété du seigneur au sens où l’on comprend aujourd’hui ce mot. La rente versée par les villageois du kingston couvrait seulement les frais d’hébergement du roi et de sa suite, tandis que les services rendus par ces mêmes villageois permettaient d’entretenir les propriétés du souverain et les infrastructures du village. Dans les régions peu visitées, la rente était versée directement à son trésor au lieu de servir à son hébergement. Il s’y ajoutait les revenus de la partie du domaine directement exploitée par le roi. Un serviteur de la Couronne, du nom de reeve, ou gerefa, administrait alors le village pour le bénéfice de son maître.
3. Constitution anglo-saxonne après l’unification politique
3.1 Institutions centrales : roi et Witan
Par. 86 Les Anglo-Saxons ont précisé le fondement idéologique de la royauté par suite des progrès de leur société. Il fallait éviter les contestations sur la succession. Une fois le royaume évangélisé, plusieurs ont donc cherché l’inspiration dans la Bible. Son influence et celle de l’Église romaine sont effectivement apparues dans le cérémonial marquant l’intronisation d’un nouveau roi.
Par. 87 Oswald, l’archevêque d’York, a décrit ainsi le couronnement du roi saxon Edgard le Pacifique, le 11 mai 973, dans l’antique cité romaine de Bath. D’après Oswald, Edgard s’est avancé dans l’église guidé par deux évêques, puis s’est prosterné devant l’autel alors qu’on chantait le Te Deum. Il s’est relevé et a prononcé le serment d’usage. Edgard a rappelé qu’il avait été choisi par le peuple, une référence à l’élection rituelle autrefois pratiquée par le Witan, l’organe censé représenter la nation. Le roi a énoncé ensuite trois promesses, toujours sous serment : il maintiendrait la paix, interdirait de commettre des vols et autres méfaits, et rendrait justice avec équité et indulgence. Ces promesses ont formé l’embryon de la charte des droits du peuple anglais que tout roi devait prononcer lors de son couronnement. On reconnaissait ainsi un caractère contractuel à la royauté anglaise. Après les prières a eu lieu la consécration. L’archevêque de Canterbury, Dunstan, prêtre officiant, a demandé à Dieu de bénir son serviteur Edgard qui avait été choisi pour régner sur les Angles et les Saxons, avant de le consacrer par l’onction. L’onction consistait à oindre ou à frotter le roi avec de l’huile sainte : le chrême. Au même moment, un chœur a entamé un cantique rappelant l’onction du roi biblique Salomon par le prêtre Zadok et le prophète Nathan. L’archevêque a poursuivi en priant le Christ d’oindre le roi, comme il l’avait fait autrefois pour les prêtres, les prophètes et les martyrs. Edgard a alors reçu les symboles de son autorité : l’anneau, l’épée, la couronne, le sceptre et la baguette. Après avoir béni le roi, l’archevêque a conclu en lui demandant de conserver pour toujours le poste qu’il occupait désormais par droit d’hérédité et qui lui avait été transmis par l’autorité de Dieu. Suivaient encore des prières, la consécration de la reine, une messe et un banquet.
L.G.W. LEGG, English Coronation Records, Westminster, A. Constable, 1901, p. 13; D. HILLIAM, Crown, Orb and Sceptre; the True Stories of English Coronations, Phoenix Mill (Gloucestershire), Sutton Publishing, 2001, pp. 4-8.
Vitrail à l’abbaye de Bath illustrant le couronnement du roi Edgard le Pacifique en 973 par l’évêque Dustan

Par. 88 Les principaux éléments de ce cérémonial, un rituel central à la tradition constitutionnelle britannique, sont demeurés presque inchangés jusqu’à ce jour, comme en témoigne le récent couronnement de Charles III, le 6 mai 2023, ou de son grand-père Georges VI, le 12 mai 1937.
D. TORRANCE, The Coronation : History and Ceremonial, Londres, House of Commons Library, 29 avril 2025.
Par. 89 Venant après les promesses, mais avant la remise des symboles de la royauté, l’onction conférait au roi un caractère sacré. C’était l’onction qui faisait alors le roi. Du moins le laissait-on croire parmi les gens d'Église. Le monarque anglo-saxon était plutôt d’avis contraire. En effet, Athelstan le Glorieux, premier roi de l’Angleterre unifiée, a été consacré en 925, comme l’ont été Edgard en 973 et Ethelred en 978. Tous, conformément à la tradition germanique, ont pourtant daté leur règne du premier jour de leur élection par le Witan et non de celui de leur consécration. Pour ces rois, la consécration ne faisait que leur apporter un surplus d’autorité. Ils suivaient en cela l’exemple de l’empereur franc Charlemagne dont le règne sur l’Europe avait pris fin en 814, et qui avait toujours prétendu qu’il tenait sa Couronne uniquement de l’accord des grands de son Empire. Si l’onction avait fait le roi anglo-saxon, celui-ci aurait dû se soumettre à l’autorité de l’Église, tout comme Israël avait écouté les prophètes et les prêtres. On comprend mieux ainsi pourquoi le roi anglo-saxon a préféré devoir sa Couronne au Witan. L’autorité des grands thanes, qui l’avaient formellement élu, lui paraissait moins lourde à supporter que celle de l’évêque de Rome.
Note: Si l’Église a reconnu le pouvoir des rois au moyen de la cérémonie du sacre, ce qui leur conférait une plus grande légitimité, et conséquemment un surplus d’autorité en tant que représentant de Dieu sur terre, elle ne l’a pas fait sans contrepartie. Un roi modèle, ont jugé les évêques participant au sixième concile tenu à Paris en 829, gouvernait le peuple de Dieu avec justice et équité, ainsi que veillait à lui procurer la paix et la concorde. Sa charge comprenait l’obligation de respecter et d’appliquer les lois divines telle qu’interprétées par les prêtres. Un roi qui s’aventurait à désobéir à l’Église, et donc aux lois du Créateur, s’attirait l’épithète de tyran et perdait du coup sa dignité. Les Actes du concile sur les devoirs de rois ont été repris et développés par JONAS, évêque d’Orléans entre 818 et 843, dans un livre intitulé De institutione regia. Cet ouvrage a été traduit et commenté par Alain Dubreucq sous le titre Jonas d'Orléans, Le métier de roi (De institutione regia), Paris, Éditions Le Cerf, 1995.
Par. 90 Toutefois, plus tard, bien plus tard, quand la Couronne du roi de race angevine sera mise en péril par les barons, notamment lors du règne de Jean sans Terre (1199-1216), et même avant, pendant le long règne de son père Henri II (1154-1189), il modifiera sa posture traditionnelle en insistant sur l’idée que l’onction et non l’élection faisait le roi, cette fois en accord avec l’enseignement de l’Église. Il invoquera alors la protection de Dieu contre ses ennemis. Dieu lui ayant donné son trône, Lui seul pouvait le lui enlever. Toute personne qui se révoltait contre son roi commettait donc un sacrilège. Le roi deviendra de ce fait un personnage sacré et inviolable. Et si Richard fitz Nigel, successivement trésorier du royaume d’Angleterre en 1156 et évêque de Londres à partir de 1189, a reconnu que son maître agissait parfois arbitrairement, il a nié l’existence de quelque droit appartenant à ses sujets de le condamner ou de se révolter contre lui.
R. FITZ NIGEL, Dialogus de Scaccario, 1179, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 524.
Par. 91 La fiction du caractère sacré et surtout inviolable sera respectée jusqu’au règne d’Édouard II (1307-1327), un monarque que l’on forcera à abdiquer avant de l’assassiner dans sa cellule de prison. Après, plus aucun roi ne sera pleinement assuré de l’immunité rattachée à son caractère sacré. Richard II (règne 1377-1399), son arrière-petit-fils, connaîtra le même sort que son aïeul. Même le roi Charles Ier (règne 1625-1649), qui prétendait toujours détenir son pouvoir de Dieu et non des hommes, ne sera pas sauvé, puisqu’il mourra sur l’échafaud, la tête tranchée par la hache.
Par. 92 Afin de sauver un reliquat de la fiction originale du caractère sacré de la royauté, les tribunaux, avec le temps, vont éventuellement distinguer entre la personne physique du roi (body natural) et le poste qu’il occupe (body politic). C’est ce que l’on a appelé la doctrine des deux identités du roi. Spécieuse au départ, elle permettra néanmoins de reconnaître une personnalité juridique à l’État anglais, confondue désormais avec la notion abstraite de Couronne. Nous y reviendrons.
KANTOROWICZ, Ernst H., The King’s Two Bodies : A Study in Medieval Political Theology, Princeton, Princeton University Press, 1997.
Par. 93 Jusqu’à son déclin amorcé à la fin du règne d’Édouard II, en 1327, l’onction présentait également comme avantage de consolider une nouvelle dynastie au lignage discutable. On l’a vu une première fois en France quand Pépin le Bref, le père de Charlemagne, a délogé de son trône le dernier roi mérovingien, Childeric III, en l’an 754. Pépin exerçait la réalité du pouvoir mais ne pouvait faire valoir quelque droit à la Couronne. Le pape Étienne II ayant sollicité son aide, Pépin a été trop heureux de l’obliger, en échange d’un couronnement où il a reçu l’onction des mains du souverain pontife. Une nouvelle légitimité naissait : la race sacrée par l’onction succédait à la race du sang sacré. Plusieurs rois d’Angleterre, à commencer par Guillaume le Conquérant (règne 1066-1087), ont joué de cet avantage lors de leur couronnement afin d'asseoir leur autorité.
Par. 94 Enfin, l’onction permettait d’assurer une transition du pouvoir sans le désordre d’une querelle entre héritiers, à une époque où les règles de succession n’étaient pas encore rigoureusement fixées. Le roi, de son vivant, procédait au sacre de son fils. Il passait alors outre à la modalité de l’élection, ou du moins cherchait-il à la transformer en une simple commémoration. L’onction reçue, le fils devenait roi, quoique sans pouvoir réel, car son père conservait les rênes du gouvernement. C’est ainsi qu’Henri II fera sacrer son fils Henri le Jeune, d’abord en 1170, puis à nouveau en 1172 à cause d’un défaut de procédure ayant vicié le premier sacre. Henri le Jeune ne pourra cependant tirer bénéfice de son élévation en raison de sa mort prématurée.
W. of NEWBURGH, The History of England, 1196, chap. 25, reproduit dans E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 363-367.
Par. 95 L’exemple du sacre d’Henri le Jeune par son père ne sera pas suivi en Angleterre. Édouard Ier instaurera à la place une nouvelle pratique tout aussi convaincante : en 1301, à Lincoln, il conférera à son fils et héritier, le futur Édouard II, la dignité de prince de Galles. Édouard fut effectivement le premier d’une longue lignée à porter ce titre, non sans qu’il y ait eu quelques bris dans cette continuité. Guillaume Windsor (William), fils de Charles III, est le dernier en date; il a été créé prince de Galles par son père le 9 septembre 2022, mais sans une cérémonie comparable à la sienne tenue 53 ans plus tôt. Il n’empêche, Guillaume est devenu, par ce seul fait, mais pas avant, l’héritier présomptif (the heir-apparent) de la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Car le titre cesse d’exister dès que le prince de Galles devient roi à son tour. Il lui revient alors de le recréer en intronisant son aîné.
W. HARRISON, Description of Elizabethan England, dans Holinshed’s Chronicles, Londres, Lothrop Withington, 1577, p. 1; W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, livre 1, Oxford, Clarendon Press, 1765, réimprimé par The University of Chicago Press, Chicago, 1979, pp. 223-224.
Par. 96 Le choix du roi dans l’Angleterre unifiée ne dépendait plus réellement de son élection par le Witan. Au lieu d’une règle précise, il semble que plusieurs facteurs aient été considérés. Il y avait la volonté du roi défunt. Un roi âgé ou malade tentait toujours d’influencer sa succession en désignant un membre de sa famille, de préférence son fils aîné. Si ce choix faisait consensus, la personne indiquée héritait. Et l’élection devenait une formalité. Toutefois, il suffisait qu’un prétendant sérieux se présente pour que la désignation perde sa valeur. Même un étranger pouvait emporter le titre convoité. Tout dépendait des rapports de force sur le terrain. Le prix allait parfois à celui qui pouvait démontrer, soit par des combats, soit par l'ampleur des troupes mobilisées sur le terrain, qu’il détenait déjà la réalité du pouvoir. Le Witan reconnaissait alors le fait accompli. Son vote demeurait, ici encore, une simple formalité, ce que l’on a pu observer lors de l’avènement de Guillaume le Conquérant en 1066.
W. STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, p. 149 à 153; MAITLAND, The Constitutional History of England, Cambridge, University Press, 1908, réimpression 1919, p. 59 et 60.
Par. 97 Le Witan, en tant qu’institution, aurait donc connu un recul comme lieu de décision en matière de succession. Cela ne signifie pas que ses membres considérés individuellement, les grands thanes et les prélats, ne jouaient aucun rôle. En s’alliant à l’un ou à l’autre, en cas de contestation, ils pouvaient effectivement faire pencher la balance en faveur d’un prétendant plutôt que d’un autre.
Par. 98 Une fois passées les formalités du couronnement, tous les hommes libres du royaume, autrement dit ceux présentant quelque intérêt, avaient l’obligation de jurer fidélité au nouveau souverain. Le roi Edmond l’Ancien (règne 939-946), frère d’Athelstan le Glorieux et petit-fils d’Alfred le Grand, l’a d’ailleurs rappelé à ses sujets dans un doom, l’un de ces actes à la fois jugement et décret ayant force de loi. Le serment d’allégeance au roi s’ajoutait à celui qu’un homme prêtait à son seigneur immédiat. Advenant un conflit entre le roi et le seigneur, donc entre deux loyautés, l’homme devait suivre son roi plutôt que son seigneur. Ce serment quasi universel prêté au roi jouera un rôle non négligeable dans la création d’un royaume anglais unifié doté d’un pouvoir central fort. On doit cependant comprendre qu’il allait à l’encontre de la tradition dans le monde pré-féodal de l’Angleterre.
R. ABELS, Lordship and Military Obligation in Anglo-Saxon England, Berkeley, University of California Press, 1988, pp. 84 et 870, qui cite III Code Edmund.
Par. 99 Le serment jouait déjà un rôle important dans la société du Moyen Âge; tant le roi, lorsqu’il promettait sur les Évangiles de respecter les droits de ses sujets, que les sujets eux-mêmes, lorsqu’ils juraient en retour de demeurer fidèles à leur roi, étaient tenus de le respecter.
Par. 100 Violer son serment pouvait entraîner de lourdes pénalités, à commencer par l’excommunication du parjure par ceux qui gouvernaient l’Église, évêque, archevêque ou pape, constitués en tribunal. La personne excommuniée ne recevait plus aucun sacrement, que ce soit la communion, l’absolution ou l’extrême-onction. Puisqu’elle se trouvait exclue de la communauté des croyants, tous se voyaient déliés de leur serment de fidélité envers elle. Il lui était désormais impossible de participer à la vie de la communauté. Elle devenait, ni plus ni moins, qu’une non-personne. En somme, l’excommunication pouvait se définir comme étant ni plus ni moins qu’une mort civile. On imagine alors à quel point cela pouvait embêter l’excommunié quand celui-ci était un roi.
M. PHBT. COLLET, Traité des excommunications, Dijon, À compte d’auteur, 1658, c. 25 et 26, pp. 291-311; M. BALLARD, J.-P. GENET et M. ROUCHE, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette Supérieur, 2003, pp. 177 et 181.
Par. 101 Même sans excommunication formelle, le vassal, dont les droits avaient été gravement violés par son seigneur, pouvait lui retirer sa loyauté conformément à la procédure dite de rupture d’hommage, ou diffidatio en latin). Tout homme possédait le droit de se révolter ainsi contre un seigneur parjure, que celui-ci ait été un baron, un comte ou même le roi. Il arrivait également que ce soit le seigneur qui déclenche les hostilités lorsqu’il estimait que son vassal s’était conduit en félon. Ayant été trahi, le seigneur décidait, avec l’accord de ses autres vassaux réunis au sein de sa cour, de saisir temporairement ou de confisquer définitivement les biens du vassal fautif, en plus de l’emprisonner ou pire de l’exécuter. Évidemment, une telle sentence n’avait rien d’automatique; tout dépendait de la force relative des belligérants. Un seigneur faible, fut-il roi, se montrait parfois clément envers un riche et puissant vassal. Inversement, tout vassal hésitait avant de se révolter contre un seigneur trop bien armé. Il se montrait encore plus prudent lorsque ce seigneur était son roi.
M. BILLORÉ, « Introduction », dans M. Soria et M. Billoré (dirs.), La trahison au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, pp. 15-34; S. GOUGUENHEIM, La réforme grégorienne, de la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde, éd. revue et corrigée, Paris, TempsPrésent, 2014, pp. 24-25.
Schéma de Maïté Bilobé

Par. 102 Posséder un droit est une chose, avoir la possibilité de le faire valoir en est une autre. C’était vrai à l’époque et ce l’est encore aujourd’hui. Autrefois, surtout lorsque le roi comptait parmi les belligérants, la justice souffrait de l’absence de tribunaux indépendants dont l’autorité aurait été reconnue par tous. Un grand vassal en conflit avec son souverain ne pouvait donc compter que sur ses propres moyens et la magnanimité du roi s’il voulait l’emporter. Aujourd’hui, c’est plutôt le coût élevé et la lenteur des procédures judiciaires qui représentent les obstacles les plus sérieux pour assurer le règne du droit, la rule of law dirait-on chez les juristes d’expression anglaise.
Par. 103 Le premier devoir d’un roi d’Angleterre a toujours été de défendre son royaume contre les menaces extérieures. Il demeurait avant tout un chef de guerre, comme l’étaient ses ancêtres angles, saxons et jutes. Depuis que les hommes du Nord avaient repris les armes contre l’Angleterre sous le règne d’Ethelred le Malavisé (978-1016), le roi anglo-saxon disposait à cet effet de troupes de mercenaires financées à même l’impôt foncier du heregeld. Le roi pouvait également lever une armée de conscrits, le fyrd, dans laquelle tout homme libre combattait lorsque appelé à servir.
Part. 104 En l’absence de menaces aux frontières, le roi anglo-saxon s’occupait principalement de la sécurité intérieure. Il s’y consacra. Mais il lui fallait d’abord établir fermement et conforter son autorité. Car tout le droit et son application reposaient sur elle. Il y a eu des avancés et des échecs depuis le règne d’Ethelbert du Kent au début du VIIe siècle. Les progrès seront néanmoins indéniables. Et au cours des deux derniers siècles de la royauté anglo-saxonne, depuis l’accession au trône d’Alfred le Grand en 871 jusqu’à la conquête normande de 1066, des réformes successives réussiront à mettre en place une société plus cohérente et à peu près ordonnée.
T. LAMBERT, Law and Order in Anglo-Saxon England, Oxford, Oxford University Press, 2017.
Par. 105 Pour y arriver, le roi anglo-saxon a bénéficié de l’élargissement de la paix du roi. On doit savoir qu’au Moyen Âge, la paix était considérée comme un objet de propriété. Il s’agissait d’un droit viager qui disparaissait avec son titulaire. La paix du roi, à ses débuts, restait une paix parmi une multitude d’autres. Il y avait notamment la paix d’une église, la paix du seigneur de manoir, la paix du clan, la paix d’une guilde de marchands et autres associations professionnelles, sans oublier la paix du propriétaire de maison. En effet, la maison d’un Anglais a toujours été considérée comme une demeure inviolable, a rappelé sir Edward Coke en 1580 dans l’affaire Bettisworth’s de la Cour des plaids communs. S’attaquer à une personne dans la demeure d’un autre n’était donc pas seulement un délit perpétré contre la victime, mais également contre le propriétaire de la maison, parce qu’on avait violé sa paix.
A.H.F. LEFROY, « Ango-Saxon Period of English Law II », (1917) 26 The Yale Law Journal 388, pp. 388-389; E. COKE, The Reports of sir Edward Coke, vol. 1, Seconde partie, Londres, J. Rivington and Sons, 1777, p. 31-32; R. STORRY DEANS, The Student’s Legal History, 4e éd., Londres, Stevens & Sons, 1921, p. 6.
Par. 106 La paix du roi était peut-être une paix parmi plusieurs, mais d’une portée si considérable qu’elle ne se comparait à aucune autre. En effet, celui qui violait la paix du roi commettait un acte de désobéissance envers son souverain. Il se rendait ainsi coupable d’une félonie, ce qui faisait du roi son ennemi.
Note : Le mot félonie, dont l’usage remonte à la fin du XIIe siècle, désignait au départ tout acte de déloyauté commis par un vassal à l’encontre de son seigneur. Comme cet acte constituait un manquement à ses obligations, le seigneur n’était plus tenu de protéger ni ses biens, ni sa personne.
Par. 107 Or, le roi possédait des moyens de contrainte que ses sujets et même l’Église ne possédaient pas. Voilà pourquoi la paix du roi écrasera un jour toutes les autres paix. Au tout début, au temps où les royaumes anglo-saxons formaient l’Heptarchie, la paix du roi se limitait à ses demeures et à ses environs. Le roi l’étendait au-delà lors de son couronnement et des principales fêtes chrétiennes, Noël et Pâques notamment. Il accordait aussi sa paix à des particuliers, ses serviteurs, à titre de faveur pour garantir leur sécurité. Progressivement, le roi a voulu couvrir de sa paix les grandes artères routières, les king’s highways, ainsi que les bourgs et les animaux sauvages des forêts, de manière à protéger le commerce dont il tirait des revenus importants, tout comme la chasse, une activité prisée par la noblesse. La tendance, avant la conquête normande, était déjà d’élargir la portée de la paix du roi à l’ensemble du royaume. Tant le roi que ses sujets le souhaitaient. Pour le roi, élargir sa juridiction augmentait ses revenus tirés des amendes et confiscations liées à leur perception. Quant à ses sujets, l’avantage était d’obtenir réparation d’une autorité à laquelle on ne pouvait difficilement désobéir sans conséquences fâcheuses.
STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, pp. 160 et 206; F. POLLOCK, Oxford Lectures and other Discourses, Londres, MacMillan, 1890, pp. 65-90.
Par. 108 Malgré ces bonnes volontés, il semble que la paix du roi demeurait encore bien imparfaite en 1066, lorsque le duc Guillaume de Normandie a conquis l’Angleterre. Elle ne couvrait pas tout le royaume et tous ses habitants en tout temps pour tous les crimes. Il a fallu attendre le règne d’Édouard Ier (1272-1307) pour la voir à peu près achevée. L’ensemble des infractions reliées aux violations de la paix du roi ont constitué les fondements du droit criminel anglais. Comme le roi y avait un intérêt personnel, le droit criminel sera considéré comme faisant partie des plaids de la Couronne, ces litiges qui relèvent de la justice royale. Nous y reviendrons.
STUBBS, id., pp. 201-202.
Par. 109 Le roi possédait les revenus nécessaires pour remplir adéquatement ses missions. Nous en avons déjà énuméré les sources. Il y avait les tributs, le service militaire, le devoir d’hospitalité, l’exploitation du domaine royal et l’impôt foncier du heregeld. D’autres sources se sont ajoutées ou ont pris toute leur valeur une fois l’Angleterre unifiée. Nous verrons, dans l’ordre, la frappe des monnaies, le développement du commerce et l’administration de la justice.
Par. 110 Au VIIIe siècle, l’Angleterre a adopté un système monétaire comparable à celui ayant cours sur le continent, dans l’Empire des Francs. L’unique pièce de monnaie était le penny d’argent, introduit une première fois par le roi Offa du Wessex (règne 757-796), que l’on frappait dans un ou plusieurs hôtels privés situés dans les grands centres urbains. Cantorbéry était certainement du nombre, possiblement Londres aussi. Offa a exigé que l’on règle toute transaction par l’emploi de pièces fabriquées au pays. Aucune pièce étrangère ne devait circuler en Angleterre. Ceux qui en possédaient les faisaient fondre dans ces hôtels pour les transformer en monnaie locale. Un droit de 5% à 25% était alors exigé par le roi.
R. C. LOCKETT, « The Coinage of Offa », (1920) vol. 20 The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society 57, pp. 57-69.
Par. 111 Outre les revenus tirés de la frappe des pièces, la mise en place et le maintien d’un système monétaire sain facilitait le recouvrement des impôts et des taxes, tout en favorisant le commerce. Alfred le Grand (règne 871-899), conscient de ces avantages, s’est donné comme priorité de l’améliorer. Il a complété trois réformes avant le dixième anniversaire de son règne : le rétablissement de la pureté du métal utilisé pour la frappe de la monnaie; l’introduction d’une nouvelle pièce, le demi-penny, quoique très rare, qui s’est ajouté au penny d’argent; et l’expansion du réseau d’hôtels où l’on fabriquait ces pièces. Une ordonnance de son petit-fils Athelstan mentionne d’ailleurs à ce sujet que des pièces identiques devront être frappés dans tous les centres urbains du royaume, tant les bourgs que les ports de mer, les seuls lieux où le commerce se pratique. Et s’il arrivait qu’un monnayeur (minter en anglais) frappe de mauvaises pièces, il sera condamné à l’amputation de sa main coupable.
II Athelstan, c. 13 et 14, F.L. ATTENBOROUGH (éd.), préc. au par. 76, p. 135. Lire également M. BLACKBURN, « Alfred Coinage Reforms in Context », dans T. Reuter (éd.), Alfred the Great, Papers from the Eleventh-Centenary Conferences, Abington, Routledge, 2016, pp. 199-218, ainsi que R. NAISMITH, « The Reign of Alfred the Great », dans E. SCREEN (éd.), Medieval European Coinage, vol. 8 (Britain and Ireland, c. 400-1066), Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 165-173.
Frappe des pièces de monnaie d'un penny dans l'Angleterre anglo-saxonne
Illustration par The Royal Mint of the United Kingdom

Par. 112 En plus du penny et du demi-penny d’argent, on a aussi utilisé, mais uniquement à des fins de calcul, le shilling et la livre. Aucune pièce représentant ces valeurs n’existait; on se contentait de les inscrire sur papier afin de comptabiliser les créances et les dettes. En effet, les pièces d’un shilling et d’une livre ne furent introduites pour la première fois que sous le règne d’Henri VII (1485-1509). C'est après la conquête normande de 1066 que la valeur d’un shilling a été fixée à 12 pence (pence est le pluriel de penny) et celle d’une livre à 20 shillings ou 240 pence. Ces rapports entre les trois unités monétaires ont été maintenus jusqu’à la réforme de 1971 qui a fait disparaître le shilling et établi la valeur d’une livre à 100 pence.
THE ROYAL MINT MUSEUM, Pounds, Shillings and Pence, lu le 14 juin 2024, à https://www.royalmintmuseum.org.uk.
Par. 113 Le roi puisait également une part importante de ses revenus dans les centres urbains. Lors des premières invasions germaniques, plusieurs cités de l’ère romaine ont été détruites. Mais il en est resté, bien qu’amoindries. Les centres urbains les plus importants, après Londres, étaient Southampton, Ipswich, York et Cantorbéry. Le commerce, sans disparaître totalement, est demeuré anémique quelques siècles. Afin de favoriser sa reprise, les rois anglo-saxons et danois, dès le règne d’Offa (757-796), ont entrepris de protéger les marchands, en plus de réglementer leurs transactions. Le moyen choisi a été de concéder aux villes et ports de mer des chartes garantissant aux marchands les droits de tenir une cour de justice et d’opérer une place de marché. En contrepartie des faveurs consenties, les rois prélevaient des taxes sur les opérations commerciales; ce pouvait être un droit fixe pour la location d’un emplacement sur la place du marché, ou une redevance sur les profits réalisés durant la journée, ou encore un droit de douane sur les marchandises transportées par navire et transitant dans les ports de mer. Un officier du roi, un reeve, ou gerefa, se chargeait de prélever les montants dus. Un important commerce intérieur et extérieur s’est ainsi développé aux VIIIe et IXe siècles. Dans ses échanges avec l’étranger, l’île anglaise exportait principalement de la laine brute et importait des produits de luxe, notamment du verre, du vin et des textiles comme le drap frison et les soieries orientales.
D.D. CRANE, From Dark Earth to Domesday : Towns in Anglo-Saxon England, Thèse de doctorat, Boston College, mai 2014, pp. 74-99.
Par. 114 Une autre source importante de revenus pour la Couronne était la justice.
Par. 115 Sans être encore considéré comme étant la source de toute justice, le roi, de par sa position, exerçait néanmoins l’autorité judiciaire suprême dans son royaume. Car rendre justice faisait partie de ses prérogatives, à l’image du roi Salomon de l’Ancien Testament dont il se voulait l’émule. Toutefois, sa liberté en ce domaine était loin d’être absolue. D’une part, son serment de couronnement, évoqué plus tôt, l’obligeait à juger avec équité et indulgence. D’autre part, les coutumes, les précédents et le statut des personnes en cause, constituaient d’autres freins à son pouvoir de juger en toute liberté. Rarement le roi exerçait-il sa juridiction. Des personnages importants comme des thanes ou des prélats devaient être impliqués. Et ceux-ci ne pouvait se présenter devant lui avant d’avoir épuisé tous les autres recours et accepté d’être liées par sa décision. Alors le roi entendait leur litige au milieu d’une formation réduite de sa Cour, de son Witan. Car il se contentait, le plus souvent, de la présence du personnel de son palais et de quelques seigneurs des environs. Après avoir délibéré avec ses conseillers, le roi rendait jugement en leur présence. Il ordonnait ensuite à l’ealdorman ou au shérif local d’agir en conséquence.
STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, pp. 146-147; MAITLAND, préc. au par. 96, p. 58; H. ADAMS, « The Anglo-Saxon Courts of Law », dans H. Adams (dir.), Essays in Anglo-Saxon Law, Boston, Little, Brown and Co., 1905, pp. 25-26.
Par. 116 Apparemment, le roi n’en tirait aucun profit lorsqu’il rendait justice en personne au milieu de son Witan, sauf à l'occasion de confiscations découlant de forfaitures. Il en allait autrement pour les autres tribunaux. Dans l’Angleterre anglo-saxonne, la justice rendue dans les cours locales de shire (cour de comté) et de hundred (Cour de centaine ou de village), ses divisions territoriales, était administrée par les habitants des régions concernées, conformément aux vieilles coutumes germaniques. Toutefois, à partir du IXe siècle, le roi y a étendu sa juridiction, là comme ailleurs, en déléguant ses officiers, des shérifs et des ealdormen, afin de présider leurs travaux et de s’assurer de leur bon fonctionnement. Et peu importe le forum judiciaire, le roi prenait au passage sa part des frais de justice.
H. ADAMS, id., pp. 9-15; POLLOCK, préc. au par. 107, pp. 83-84.
Par. 117 Nous venons de voir que le roi rendait justice avec le personnel de son palais. Ce terme palais a évoqué au départ une construction réservée à quelque haut personnage. Plus tard, il a désigné non seulement la résidence du roi, mais également les personnes attachées à son service, autrement dit l’ensemble des conseillers, domestiques et guerriers de sa suite. On le traduisait alors en anglais par le mot household. Au sein du palais, de son household, on distinguait ceux qui occupaient des fonctions nobles des autres, serviteurs et guerriers, dont le statut les rapprochait de la domesticité. Seuls les premiers, les thanes, nous intéressent. Ils faisaient partie de la Cour du roi et participaient à ce titre à l’exercice du pouvoir.
Par. 118 On voyait toujours le roi anglo-saxon entouré des principaux membres de son palais. Ils l’accompagnaient dans tous ses déplacements. Ses serviteurs prenaient soin de sa garde-robe et de sa chambre à coucher, supervisaient les approvisionnements en vivres et en vins, préparaient ses repas, veillaient au soin des chevaux, en plus de lui apporter le réconfort spirituel. Cette organisation existait également dans le duché de Normandie, qui lui-même avait imité la Cour des rois de France. Si on leur donne le titre qu’ils porteront après la conquête normande de 1066, et d'ailleurs la plupart existait déjà en Normandie, il y avait le chambrier, aussi appelé le chambellan, le sénéchal, le majordome, le connétable ou parfois le marshal et le chapelain (chamberlain, steward, buttler, constable (marshall) et chaplain en anglais). Le chambellan était le préposé de la chambre du roi et de sa garde-robe. Puisque le roi conservait son trésor dans sa garde-robe, parfois même sous son lit, il en a confié la garde et la gestion à son chambellan. Celui-ci faisait donc office de ministre des finances. Le bouteiller versait le vin et s’occupait du ravitaillement de la cour en vins et en vivres. On a donné la charge des écuries au maître ou comte de l’étable, dont le titre a évolué pour devenir le connétable ou le marshal. En plus de résoudre les problèmes liés au transport des personnes et des marchandises, le connétable supervisait les parties de chasse du roi. Il deviendra l’un des principaux officiers de son armée. Un chapelain célébrait la messe, donnait les sacrements, et éclairait le roi sur les questions spirituelles.
Par. 119 Outre leurs fonctions habituelles, les chambellan, sénéchal, bouteiller, connétable et chapelain agissaient collectivement à titre de conseillers du souverain. Ils constituaient ses principaux thanes. Leur autorité et leur prestige découlaient de leurs rapports étroits avec le roi. Ensemble, avec d’autres personnages que le roi trouvait opportun d’écouter, ils formaient un conseil restreint dont les principaux rôles étaient d’aider le roi à rendre justice et à gérer son royaume, en plus de le représenter auprès des souverains étrangers. Lorsque le royaume s’est agrandi, et que les responsabilités de la Couronne ont augmenté dans les mêmes proportions, le roi a dû s’adjoindre un certain nombre de personnes affectées exclusivement à des fonctions gouvernementales. Deux branches du service, quoiqu’encore bien informes, ont été créées lors du règne du Confesseur ou le seront bientôt après la conquête par le Normand : la Trésorerie, dirigé par un trésorier, et le Secrétariat, dirigé par un secrétaire qui prendra bientôt le nom de chancelier. Ils ont formé l’embryon du futur appareil gouvernemental de l’Angleterre.
Constitutio Domus Regis, année 1136, dans E. AMT et S.D. CHURCH (éds.), The Dialogue of the Exchequer, The Disposition of the King’s Household, Oxford, Clarendon Press, 2007, pp. XXXVIII-LIX et 195-217. Lire également J.H. ROUND, « The Officers of Edward the Confessor », (1904) vol. 19 The English Historical Review 90-93; C.W. HOLLISTER, « The Origins of English Treasury », (1978) vol. 93 The English Historical Review 262-275; C.W. HOLLISTER et J.W. BALDWIN, « The Rise of Administrative Kingship : Henry I and Philip Augustus », (1978) vol. 83 The American Historical Review 867-905.
Par. 120 Le roi anglo-saxon entretenait une abondante correspondance avec ses officiers, les membres de l’aristocratie et les dignitaires étrangers. On rédigeait également en son nom de nombreux actes juridiques : des jugements, des chartes, des brefs, des traités, des testaments et des ordres de mission (dooms, charters, writs, treaties, wills et orders en anglais). Le roi ne voulait ou ne pouvait s’acquitter de toutes ces tâches. Il lui fallait l’aide d’érudits, normalement choisis parmi les clercs, pour constituer un Secrétariat. Un clerc était une personne entrée dans l’état ecclésiastique pour se consacrer au service de l’Église, généralement tonsurée, mais pas obligatoirement ordonnée prêtre. Ses membres les plus connus étaient l’archevêque, l’évêque, l’abbé, le prêtre, le moine, le chanoine, le diacre et le sous-diacre. Au Moyen Âge, ces clercs exerçaient un quasi-monopole sur la culture lettrée savante. Le roi s’est donc naturellement tourné vers eux quand il a eu besoin de secrétaires. La plus ancienne référence à un secrétaire royal remonte à 852 ; il s’agissait d’un abbé d’origine franque du nom de Félix qui a servi le roi Ethelwulf du Wessex (règne 839-958), le père d’Alfred le Grand. En 1068, peu après la conquête normande, Herfast, principal secrétaire de Guillaume Ier, prendra le titre de chancelier. Mais il n’était pas le premier ; le Confesseur aurait également nommé un chancelier. Le Secrétariat, éventuellement, changera donc de nom pour devenir la Chancellerie. Le chancelier supervisait les autres secrétaires au service du roi. Ce dernier lui a même confié la garde du grand sceau de l’Angleterre de manière à pouvoir authentifier les documents émis au nom de la Couronne. Son titulaire sera plus tard considéré comme le ministre de la justice du roi.
W. ANSON, The Law and Custom of the Constitution, vol. II, partie 1, 4e éd., Oxford, Clarendon Press, 1935, pp. 164-170. Lire aussi N. UNDERHILL, The Lord Chancellor, Lavenham (Suffolk), Terence Dalton, 1978.
Par. 121 Avec le doom, sur lequel nous reviendrons également, la charte et le bref comptaient parmi les instruments juridiques les plus importants qui émanaient du Secrétariat.
Par. 122 Le mot charte désignait généralement tout acte écrit suivant l’ancienne tradition romaine reconnaissant un titre de propriété ou un privilège, droit ou prérogative. C’était un document très élaboré, non scellé, rédigé en latin, soit sur un parchemin, soit sur un papyrus. La transaction elle-même se déroulait oralement et devant témoins. Rédiger une charte ne servait qu’à l’enregistrer. On y apposait la croix, la marque ou la signature du roi, avec celle des autres dignitaires présents. Présenter cette charte était devenu le meilleur moyen de prouver son titre de propriété ou son privilège. Le document concluait normalement en vouant à l'enfer ceux qui ne respecterait pas le droit concédé.
HOLDSWORTH, préc. au par. 69, pp. 25-31; R.C. VAN CAENEGEM, The Birth of the English Common Law, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 30.
Par. 123 Contrairement à une charte, le bref se voulait un écrit concis et authentifié par le grand sceau du roi. Son origine remonterait possiblement au règne d’Alfred le Grand (871-899). Son emploi à des fins judiciaires dans un format standardisé est définitivement avéré lors du règne d’Ethelred le Malavisé (978-1016). Il serait donc de création anglo-saxonne. Le roi s’en servait pour de nombreux usages. Un bref contenait normalement un ordre adressé à l’un de ses officiers, reeve de village, shérif, ealdorman ou earl. Rédigé dans la langue vernaculaire, donc en anglais, de manière à être lu publiquement dans les cours locales du shire ou de hundred, il contenait presque toujours la formule « I will not permit… », exprimant une menace pour ceux qui oserait contrarier la volonté du monarque. À l’occasion, le bref prouvait indirectement l’existence d’un titre de propriété quand le roi informait ses officiers d’une cession en faveur d’un tiers. On l’utilisait également pour annoncer une nomination. L’usage du bref s’est ainsi généralisé pour devenir le principal outil de communication servant à gouverner les régions.
HOLDSWORTH, id., au par. 77; CAENEGEM, id., pp. 30-31; A.G.P. FENTON, The Function of Writs in England before the Norman Conquest, Thèse de doctorat, University of Cambridge, Trinity College, août 2020, pp. 10-16.
Par. 124 Autant les historiens hésitent avant d’évoquer l’existence d’une Chancellerie sous le règne de rois anglo-saxons, autant ils atermoient devant l’usage du mot Trésorerie pour la même période. Il est vrai que les archives sont médiocres. Nous savons néanmoins que le chambellan, ce préposé à la chambre et à la garde-robe du roi, a été le principal responsable de la surveillance et de l’administration de son trésor jusqu’à la fin du Xe siècle, lorsqu’on a commencé à lever l’impôt foncier du danegeld ou du heregeld. L’entreposage et la collecte des fonds, ainsi que la tenue d’une comptabilité pour les encaisses et les débours, sans oublier les craintes pour sa sécurité, ont alors milité en faveur de la sédentarisation du trésor dans un lieu précis, de préférence bien défendu. Le Saxon Ethelred le Malavisé (règne 978-1016) ou plus sûrement le Danois Knut le Grand (règne 1016-1035) aurait décidé la création de ce nouveau service. Son choix, pour l’emplacement, a porté sur la ville de Winchester, le chef-lieu du Wessex. Tous les revenus de la Couronne y étaient emmagasinés, à l’exception d’une cassette que le roi conservait près de lui afin de défrayer ses dépenses courantes. Le responsable de la garde du trésor à Winchester a été appelé le chambellan du trésor (treasury chamberlain en anglais), un titre raccourci plus tard en celui de trésorier (treasurer en anglais).
C.W. HOLLISTER, préc. au par. 119, pp. 262-264. Henri II (règne 1154-1189) déménagera le Trésor vers 1180 dans son palais de Westminster, voisin de la cité de Londres.
Par. 125 Sous le règne du roi normand Henri Ier, vers 1110, le service de la garde du trésor prendra le nom d’Échiquier (Exchequer en anglais). L’Échiquier deviendra un véritable ministère des finances comprenant une cour spécialisée dans les questions fiscales. Au XVIIe siècle, on créera une commission pour gérer les finances du royaume avec à sa tête un Premier lord du trésor. Cette commission existe toujours. Le poste de Premier lord du trésor est normalement occupé par le Premier ministre. Toutefois, le véritable responsable des finances reste le Second lord du trésor, qui porte également le titre de Chancelier de l’Échiquier (Chancellor of the Exchequer en anglais).
Par. 126 En plus du soutien des proches conseillers de son palais, le souverain pouvait compter sur l’aide de son Witan. Le Witan des derniers rois anglo-saxons ne représentait plus le contre-pouvoir qu’il avait été chez les anciennes tribus de Germanie. Certes, une coutume ou plutôt un usage non écrit voulait que le roi le consulte avant de prendre une décision importante, mais son rôle demeurait de plus en plus protocolaire. Car pour obtenir la majorité, le roi n’avait qu’à y inviter davantage de ses alliés. Mais indépendamment de la stricte légalité, un roi aurait été présomptueux de ne faire qu’à sa tête, sans tenir aucun compte d’une grande partie des membres de son conseil, car celui-ci réunissait l’aristocratie de son royaume, les personnes les plus fortunées et les plus puissantes. Mépriser ouvertement leurs avis aurait été impolitique, voire dangereux pour la Couronne.
STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, p. 157.
Par. 127 Le roi anglo-saxon sollicitait l'opinion d'un nombre plus ou moins grand de conseillers rassemblés au sein du Witan. À l’ordinaire, une réunion du Witan ne comprenait, outre l’entourage du roi, que les seigneurs du lieu où la rencontre se tenait, soit un ou deux évêques, peut-être un abbé, quelques thanes, en plus des parties directement intéressées par les actions prises par l’assemblée. Les réunions plénières du Witan, beaucoup plus rares, réunissaient par contre tous les grands seigneurs. Celles du règne d’Athelstan le Glorieux comptaient au moins 100 participants. Elles se tenaient un peu partout, dans les villes, les villages et les lieux de chasse, mais surtout au sud de l’Angleterre, là où la population et la richesse étaient concentrées. On en faisait des événements empreints de solennité. Le roi y portait sa couronne. Une messe était célébrée.
STUBB, id., pp. 134-140.
Par. 128 Le choix de convoquer l’une ou l’autre formation du Witan dépendait des enjeux, selon qu’il fallait discuter de questions d’intérêt national ou local. La guerre, les taxes, les réformes monétaires, la succession à la Couronne, la proclamation de codes de lois et les procès des plus importants personnages du royaume étaient sûrement dignes de la plus grande attention. Le reste, notamment les cessions de terres en bookland, la création de bourgs, la nomination d’un thane et les procès de second ordre, pouvaient être décidés par un conseil restreint. Pour les sujets purement religieux, le roi se contentait de convoquer uniquement les prélats. Leurs rencontres prenaient alors le nom de synodes.
Par. 129 En raison de leur impact sur l’évolution des institutions, poursuivons sur trois pouvoirs exercés par le roi au sein de son Witan : l’exercice de la justice, l’adoption de législations, puis les concessions de terres par l’octroi d’une charte, en l’occurrence des titres de propriété appelés des booklands.
Par. 130 Aux Xe et XIe siècles, le roi n’était toujours pas un véritable législateur, d’après notre définition actuelle. On ne distinguait pas encore entre une loi, l’œuvre du législateur qui élabore et couche par écrit de nouvelles normes générales de rang supérieur, et un jugement, le travail du juge qui interprète, déclare ou applique des règles de droit existantes. C’est en raison d’une ancienne conception sur la nature du droit. En effet, pour les hommes du Moyen Âge, le droit avait été forgé dans la nuit des temps et avait continué de les régir tel quel, toujours inchangé. L’idée même que l’on pouvait créer de nouvelles règles de droit leur était étrangère. Il est vrai que le roi, lorsqu’il tranchait un litige aidé de son Witan, se contentait le plus souvent de reconnaître et d’appliquer les coutumes du pays. Mais il lui arrivait aussi de remplacer une vieille coutume devenue désuète ou dont l’application comportait une injustice. On pouvait également lui présenter un problème inédit pour lequel aucune règle n’existait. Le roi décidait alors selon ce qui lui semblait être l’équité, son sens de la justice. Une condition pour cela est qu'un individu ne saurait faire à un autre ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Alfred le Grand (règne 871-899), sans doute inspiré par l’Évangile selon saint Mathieu, verset 7-12, et les Actes des apôtres, chap. 15, explique ainsi sa pensée : « That ye will that other men do not to you, do ye not that to other men. From this one doom a man may think that he should doom every one rightly; he need keep no other doom book. Let him take heed that he doom to no man that he would not that he doom to him, if he sought doom over him »
T. BOSWORTH, The Whole Works of King Alfred the Great, vol. II, Oxford et Cambridge, J.F. Smith and Co., 1852, p. 125.
Par. 131 Un roi anglo-saxon ou danois pouvait également présenter au Witan, pour sa ratification, une codification des coutumes de son royaume, tout en profitant de l’occasion pour les corriger à la marge. La plus connue a été celle d'Alfred le Grand, parfois présenté comme le père de la common law anglaise à l'égal d'Henri II (règne règne 1154-1189). L’ont suivi Édouard l’Ancien (règne 899-924), Athelstan le Glorieux (règne 924-939), Edmond l’Ancien (règne 939-946), Edgard le Pacifique (règne 959-975), Ethelred le Malavisé (règne 978-1016) et Knut le Grand (règne 1016-1035). Sans l’avouer ouvertement, le roi se faisait donc législateur, sans pour autant prétendre procéder à quelque réforme du droit du pays. Il n’en aurait jamais eu l’intention, ni l’idée. Ses jugements ou décrets-lois rendus lors des séances du Witan continuaient d’être appelés des dooms, comme au temps de ses ancêtres germains.
F. POLLOCK, « Anglo-Saxon Law », (1893) vol. 8 The English Historical Review 239, à la p. 240.
Par. 132 Pendant les IXe et Xe siècle, donc certainement à partir du règne d’Alfred (871-899), le roi assisté de son Witan passait aussi une partie de son temps à la création de booklands. Un bookland était un titre foncier concédé oralement, puis enregistré au moyen d’une charte, ce qui explique son nom qui pourrait se traduire en français par registre foncier. Il s’agissait donc d’un titre écrit, par opposition au titre détenu en vertu de la coutume, le folkland, pour lequel aucun écrit n’existait. Même quand un autre cédait la terre, le roi participait à la création du bookland en raison des privilèges régaliens reconnus au titulaire du nouveau droit. En effet, l’heureux récipiendaire acquérait des droits de justice et les profits qui en découlaient, en plus d’une exemption qui le libérait des services normalement dus à la Couronne.
POLLOCK, id., p. 269-270.
Par. 133 Pourquoi a-t-on procédé à cette innovation ? La raison était bien sûr de mieux protéger juridiquement un titre de propriété, ainsi que d’alléger les charges habituelles qui grevaient tout droit foncier en folkland. Cela semblait aller de soi lorsque le titulaire était une communauté religieuse. Car au moment où on a imaginé ce type de propriété, le bookland devait bénéficier uniquement aux établissements religieux, afin que ses occupants puissent se consacrer exclusivement au service de Dieu. D’importants seigneurs ont toutefois voulu jouir des mêmes avantages en prétextant faussement avoir créé des monastères. L’impact sur les finances royales et les effectifs du fyrd a été tel que le roi, réalisant le danger, a réintroduit d’anciennes obligations comme le service militaire et la construction des ponts et forteresses, peu importe la nature des biens fonciers en cause.
Par. 134 Qu’ils aient été des prélats ou des thanes, ceux possédant des terres en bookland embauchaient des travailleurs pour les exploiter, dont beaucoup d’hommes libres qui les occupaient selon différentes modalités ou tenures. Cela fait que le bookland anglais du VIIIe siècle ressemblait de plus en plus au fief français, celui-là même qui caractérisait le système féodal sur le continent. Au milieu du XIe siècle, peu avant la conquête normande de 1066, une importante proportion des terres anglaises étaient désormais détenues en vertu d’un titre de bookland. La transformation féodale de l’Angleterre semblait donc en bonne voie au moment de l’arrivée de Guillaume le Conquérant sur le sol anglais.
STENTON, préc. au par. 37, pp. 306-312.
3.2 Institutions décentralisées : districts administratifs, seigneurs et cours régionales
Par. 135 L'Angleterre a été découpée en plusieurs districts administratifs. Du plus grand au plus petit, il y a eu l’earldom, le shire, le hundred, aussi appelé wenpentake dans certaines régions, et le hide.
Par. 136 La division en shires aurait commencé au Wessex sous le règne du roi Ine (688-726), le prédécesseur d’Alfred le Grand. Son code de lois de 690 mentionnait pour la première fois un nouveau palier de gouvernement, le scir, mot qui a évolué en shire. Il évoquait également la présence d’un agent de la Couronne portant le titre d’ealdorman, responsable de l’administration du shire et révocable en cas de manquement à ses devoirs. Les ealdormen comptaient parmi les grands thanes du royaume. Ils siégeaient auprès du roi dans son Witan.
Loi de Ine, c. 8 et c. 36, ATTENBOROUGH, préc. au par. 76, pp. 39, 49 et 184.
Par. 137 La division de l’Angleterre en shires a été réalisée progressivement. Elle était déjà presque achevée au moment de la conquête normande de 1066. On aurait alors dénombré 34 shires : Bedford, Berks, Buckingham, Cambridge, Cheshire, Cornwall, Derby, Devon, Dorset, Essex. Gloucester, Hamp, Hereford, Huntington, Kent, Leicester, Lincoln, Middlesex, Norfolk, Northampton, Nottingham, Oxford, Rutland, Shrop, Sommerset, Stafford, Suffolk, Surrey, Sussex, Warwick, Wilts, Worcester et York. Cinq autres seront créés avant la fin du XIIe siècle : Cumberland, Durham, Lancashire, Northumberland et Westmoreland. Enfin, le Montmouth, une terre autrefois considérée comme appartenant au pays de Galles, sera également ajoutée aux comtés anglais par une loi de 1543, portant ainsi leur nombre à 40. Ces shires continueront d’exister jusqu’en 1974 sous la forme de circonscriptions électorales représentées par des députés de la Chambre des communes du Parlement de Westminster.
An Act for certain Ordinances in the Kings Majesties Dominion and Principality of Wales, 34 & 35 Hen. 8, c. 26, dans Statutes of the Realm, vol. 3, 1816, réimpression de 1963, pp. 926-937.
Carte 8
Nous avons inclus le Montmouth, même s'il ne deviendra un shire qu'en 1543

Par. 138 L’ealdorman du IXe siècle administrait toujours un seul shire. Toutefois, Athelstan le Glorieux (règne 924-939), le souverain anglo-saxon qui a unifié l’Angleterre, n’a pas voulu augmenter leur nombre dans les mêmes proportions que la taille de son royaume. Il a préféré étendre leur juridiction à plusieurs shires. Cette concentration du pouvoir entre les mains de quelques grands administrateurs se poursuivra sous le règne du Danois Knut le Grand (1016-1035). Knut a divisé l’Angleterre en quatre régions, plus ou moins devenues des provinces : la Northumbrie, la Mercie, l’Estanglie et le Wessex, correspondant aux anciens royaumes de la Tétrarchie, puis a placé chacune, sauf le Wessex, sous la juridiction d’un nouveau et puissant aristocrate connu sous le nom d’earl ou oerl, qui vient du scandinave jarl, un comte en français. Knut a conservé pour lui le Wessex.
ATTENBOROUGH, id., p. 183. Les termes ealdorman et ealdormen perdront tout signification au XIe siècle, sauf pour désigner les édiles municipaux responsables de l’administration des bourgs.
Par. 139 Le territoire d’un earl est devenu un earldom. L’earldom regroupait en moyenne dix shires, cela peu avant la conquête par le Normand Guillaume. Les shires, pour leur part, avaient déjà été divisés bien avant en hundreds. Comme pour les shires, la division en hundreds a commencé dans le Wessex, pour être étendue plus tard au reste de l’Angleterre. Un hundred comptait normalement cent hides. Rappelons que le hide, l’unité servant au calcul de l’impôt foncier, était, à sa création, la superficie de terres requises pour répondre aux besoins d’une famille de paysans. Au Xe siècle, on a jugé qu’il fallait cinq hides évalués chacun à leur valeur courante de 600 acres pour accéder au rang de l’aristocratie des thanes. Un thane possédait donc un domaine couvrant au moins 3 000 acres, environ 12 kilomètres carrés.
POLLOCK, préc. au para. 131, p. 246.
Par. 140 Les anciens ealdormen des IXe et Xe siècles, puis les earls du XIe siècle, ont été des agents nommés par le roi pour administrer un ou plusieurs shires. Ils étaient choisis parmi les thanes de sang royal, soit des aethelings de la famille régnante ou encore des membres d’anciennes maisons désormais soumises. Le statut des ealdormen et des earlsse rapprochaient progressivement de celui d’un vice-roi. Leurs devoirs étaient à la fois de nature civile et militaire. Ils géraient de vastes régions, comparables, pour les earls du moins, aux anciens royaumes de la Tétrarchie. Leur responsabilité dans le domaine militaire consistait à lever les contingents de conscrits du fyrd qu’ils commandaient ensuite sur les champs de bataille. En matière civile, ils veillaient à l’application des lois et présidaient les cours de shire, secondé par l’évêque, une activité dont ils tiraient des revenus appréciables ; un tiers des profits des plaids des cours de justice locales shire leur était réservé. Le roi recueillait, comme toujours au passage, sa part des frais de justice et des amendes perçues, donc les deux tiers restants.
STENTON, préc. au par. 37, pp. 547-548.
Par. 141 Bien que l’on traduise en français le mot earl par celui de comte, les confondre serait une erreur. En effet, dès l’effondrement de l’Empire de Charlemagne, le comte français a réclamé et exercé sur son comté des pouvoirs quasi souverains, alors que l’earl anglo-saxon, quoique puissant dans son earldom, ne prétendait pas être davantage qu’un agent de la Couronne. D’ailleurs le roi le lui rappelait en cas de déloyauté de sa part. En outre, alors que le comte, au tournant du millénaire, transmettait son titre et sa terre à son fils aîné, l’earl occupait son poste au plaisir du roi. Il espérerait seulement que son aîné ou un autre membre de sa famille lui succède, non en invoquant un supposé droit, mais uniquement en raison de sa valeur. Certes, la tendance était là, présente sous le règne d’Édouard le Confesseur (1042-1066), d’accorder néanmoins la préférence à la famille de l’earl décédé. Mais ce n’était pas l’émergence d’un nouveau droit. Édouard ayant été un roi faible, les earls anglo-saxons, les familles Godwin, Leofric et Siward pouvaient plus facilement s’imposer.
STENTON, ibid.
Par. 142 Afin d’aider les ealdormen à administrer leur région, maintenant trop vaste pour les capacités d’un seul homme, Edgard le Pacifique (règne 959-975) et Ethelred le Malavisé (règne 978-1016) ont recruté un nouveau serviteur, un reeve, auquel ils ont confié la juridiction sur l’ensemble du territoire d’un shire. Il allait de soi qu'il serait appelé un shire-reeve, puis éventuellement un sheriff, ou shérif en français. D’un rang inférieur à l’earl, le shérif était, tout comme eux, un administrateur au service de la Couronne, donc révocable à volonté. Il acquerra éventuellement une sinistre réputation dans les siècles suivants, en partie en raison de sa fonction de percepteur d'impôt.
STENTON, id., p. 548. Pour une étude plus exhaustive, lire W.A. MORRIS, The Medieval English Sheriff to 1300, Manchester, Manchester University Press, 1927, pp. 17-41.
Par. 143 La shérif acquerra éventuellement une sinistre réputation dans les prochains siècles en raison de son rôle de percepteur d'impôt. En effet, le shérif est celui que le roi a chargé d’encaisser les loyers provenant des domaines de la Couronne et les rentes dues par les villageois des kingstons. Il prélevait les taxes sur les opérations commerciales effectuées dans les bourgs. Il retenait aussi la part du roi dans les frais de justice des cours de shire et de hundred, dont il assurait parfois l’administration. Enfin, le shérif percevait l’impôt du heregeld auprès des propriétaires fonciers.
Par. 144 Il est certain que sans les shérifs, la tâche aurait été trop lourdes pour les derniers ealdormen et earls. Plus important encore, comme le roi craignait parfois ces puissants seigneurs dont la fidélité pouvait s’avérer chancelante en temps de crise, la nomination de shérifs lui a permis de faire contrepoids. Son contrôle sur les shérifs était effectivement beaucoup plus étroit et sûr. Encore que le roi n’avait guère le choix, mais pour d’autres raisons ; en effet, les pouvoirs du shérif étaient si vastes que les occasions de le corrompre et lui de s’enrichir ne manquaient pas.
MORRIS, id., p. 13. Une loi d’Ethelred le Malavisé, qui mentionne également la position prééminente du shérif dans le shire, exigeait de lui qu’il ne rende pas jugement sans la présence de douze hommes honnêtes du comté, des thanes, qui serviraient de témoins (III Ethelred 3.1, reproduite à https://www.1066.co.nz/Mosaic%20DVD/library/laws/aethelred.htm).
Par. 145 Deux instances judiciaires, les cours de shire ou cours de comté et de cour de hundred, dominaient la vie locale. Elles avaient été mises sur pied par les hommes libres habitant ces districts administratifs, qui ont simplement reproduit ce que leurs ancêtres germains avaient fait en établissant les var-Thing et leith-Thing. La justice y était rendue par le peuple et en son nom en application des règles coutumières. Des agents du roi, earl ou shérif, comme nous l’avons déjà écrit, supervisaient cependant leurs travaux. Certes, le roi rendait également justice au sein de son Witan, mais il s’agissait d’une justice rarement exercée, parce que réservée aux plus grands personnages du royaume et aux grandes causes. Un simple thane ne pouvait cogner à sa porte pour se faire entendre, à moins qu’on lui ait auparavant refusé l’accès aux cours régulières. La Cour du roi, sous son nom latin Curia regis, est demeurée pendant longtemps un tribunal de dernier recours.
Par. 146 La Cour de hundred se réunissait une fois par mois sous la direction d’un reeve. On se rencontrait en plein champ, sous un arbre, sur une colline ou près du puits d’un village. À l’origine, tous les hommes libres du hundred étaient appelés à y siéger. Ils tranchaient les litiges de leurs voisins. Leur nombre fut ensuite réduit; douze représentants devaient être choisis. Ils étaient les doomsmen, ceux qui déclaraient les coutumes du pays, les dooms disait-on alors.
STENTON, préc. au par. 37, p. 299.
Par. 147 Le roi Édouard l’Ancien (règne 899-924) a rappelé les devoirs du shérif en ces termes : « [Traduction] C’est ma volonté que chaque reeve tienne une rencontre toutes les quatre semaines ; et qu’à cette occasion il veille à ce que tout homme puisse obtenir les bénéfices de la loi, et qu’une date soit fixée pour entendre chaque litige, date à laquelle il sera entendu et tranché. »
ATTENBOROUGH, préc. au par. 76, p. 121.
Par. 148 Ne voyons pas dans le nombre douze plus qu’une coïncidence, car ces doomsmen n’étaient pas vraiment les ancêtres du jury anglais moderne avec ses douze jurés. En effet, le rôle des doomsmen ne consistait pas à déterminer les faits d’un litige, mais plutôt à déclarer le droit applicable comme le feraient aujourd’hui nos juges. Ils étaient peut-être des paysans, mais des paysans instruits dans la science du droit, possiblement guidés par le shérif, sans pour autant être contrôlés par lui. Nous verrons bientôt que les doomsmen devaient ensuite s’en remettre au jugement de Dieu pour identifier, entre les deux parties au procès, celle qui disait la vérité et celle qui mentait. Le seul rapprochement à faire entre les doomsmen et le jury moderne serait d’y voir une justice rendue par les pairs, des gens ordinaires et non des professionnels du droit, conformément à la tradition germanique.
STENTON, préc. au par. 37, p. 299.
Par. 149 La Cour du shire siégeait plus rarement, seulement deux fois l’an. Là-aussi, à l’origine, tous les hommes libres du shire étaient appelés à participer à ses travaux, avant que l’on demande à certains d’entre eux, les doomsmen, de représenter leur communauté. À la différence de la Cour de hundred, l’earl, l’évêque, le shérif et les principaux thanes y siégeaient de plein droit. L’earl présidait normalement les séances au nom du roi. Quand ses autres fonctions ou ses goûts ou le peu d’intérêt des litiges le retenaient ailleurs, ce qui semblait fréquent, l’évêque ou le shérif le remplaçait.
STENTON, id., p. 549; F. ZINKEISEN, « The Anglo-Saxons Court of Law », (1895) vol. 10 Political Science Quarterly 132, p. 135-142.
Par. 150 Rappelons que les doomsmen étaient les juges des cours de shire et de hundred. Leur tâche, semblable au roi siégeant au sein de son Witan, consistait à identifier les coutumes du pays, soit de dire ou de déclarer le droit applicable au litige. Après avoir identifié ces coutumes, ils décidaient à qui, du plaignant ou de défendeur, incomberait le fardeau de la preuve, ainsi que la nature de la preuve exigée de lui, avant le prononcé du verdict. La partie désignée par les doomsmen se soumettait alors normalement au jugement de Dieu, car Lui seul connaissait l’âme des hommes et savait donc s’ils disaient la vérité. La difficulté, on l’aura deviné, était d’interpréter Sa pensée. Deux procédures ont été imaginées pour connaître son jugement : le serment purgatoire (wager of law ou compurgation en anglais) et l’ordalie (ordeal en anglais).
Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ces matières. Mentionnons B. LEMESLE, La main sous le fer rouge, Le jugement de Dieu au Moyen Âge, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2016, R. BARTLETT, Trial by Fire and Water, The Medieval Judicial Ordeal, Brattleboro (Vermont), 2014, et G. NEILSON, Trial by Combat, Glasgow, William Hodge & C., 1890, réimpression par Clark (New Jersey), The Lawbook Exchange, Ltd, 2000.
Par. 151 Un serment purgatoire permettait de trancher un litige en faveur d’un jureur, lorsque le fardeau de la preuve reposait sur lui. Le jureur donnait sa parole qu’il disait la vérité, la main posée sur une relique ou sur les Évangiles, en prenant Dieu à témoin de sa sincérité. Ceux qui rendaient un faux témoignage transgressaient le huitième commandement du Décalogue et devait craindre de ce fait le châtiment que Dieu lui imposerait. On tenait donc pour acquis qu’un jureur parlerait avec honnêteté.
Par. 152 Un jureur se présentait toujours avec à ses côtés des cojureurs du même lignage, des parents ou des amis, dont le nombre variait selon la qualité des plaideurs et la gravité de la cause. Ces cojureurs ne venaient pas corroborer la version des faits du jureur, l’auteur du premier serment. Ils pouvaient même tout ignorer de son litige. Leur rôle consistait plutôt à l’appuyer en garantissant son honorabilité. Lorsque toutes ces conditions étaient respectées, le jureur avait rempli son fardeau et gagnait normalement son procès. Certes, un serment purgatoire pouvait être récusé par l’autre partie, mais celle-ci devait alors déposer une accusation de parjure. Il arrivait que les doomsmen refusent le serment purgatoire d’une personne parce qu’elle était de condition inférieure, de réputation douteuse, ou que son affaire se présentait mal. Lorsqu’on ne permettait pas à une personne de se disculper par serment, il fallait s’en remettre à la procédure d’ordalie, mentionnée une première fois dans les lois d’Ine.
Lois d’Ine (règne 688 à 726), chap. 37 et 62, dans ATTENBOROUGH, préc. au par. 76, pp. 49 et 52.
Par. 153 En quoi consistait la procédure d’ordalie ? C’était une épreuve physique qu’il fallait surmonter afin de démontrer le soutien de Dieu et que sa cause était donc juste. Trois types d’ordalie se trouvaient en usage dans l’Angleterre anglo-saxonne : l’épreuve du feu ou de l’eau bouillante, l’épreuve de l’immersion dans l’eau, et enfin l’épreuve de la bouchée de pain ou de fromage.
Ordalie par le feu
Peinture par Dirk Bouts et Rogier van der Weyden, 1460, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles

Par. 154 Prenons l’exemple de l’épreuve du feu, la plus utilisée pour le lieu et l’époque étudiés. Les juges désignaient d’abord la partie au litige à qui incomberait le fardeau de prouver qu’elle disait vrai. Celle-ci devait se présenter au prêtre-officiant sur les lieux trois jours avant de se soumettre à l’épreuve, assister à la messe quotidiennement, tout en se nourrissant uniquement de pain, d’eau, de sel et d’herbes pendant cette période. Et au jour dit, une dernière messe était célébrée au cours de laquelle le litigant présentait une offrande et communiait. Puis, le litigant se soumettait à l’épreuve, non sans avoir juré au préalable, conformément à la loi, qu’il était innocent de l’accusation portée contre lui. Ensuite, pour un bref instant, il prenait de sa main un morceau de fer rougi par le feu. La main était entourée d’un bandage immédiatement après. Trois jours plus tard, les juges examinaient son état. Si la main était sur la voie de la guérison, le litigant, protégé par Dieu, avait donc dit la vérité. Mais si la main s’était infectée, Dieu avait reconnu en lui un parjure.
Chap. 23 des Lois d’Athelstan le Glorieux (règne 924-939), ATTENBOROUGH, id., p. 139.
Par. 155 Après 1066, les Normands ont introduit en Angleterre un dernier type d’Ordalie : le duel judiciaire. Les parties, soit elles-mêmes ou encore représentées par leur favori, se combattaient l’une l’autre avec les armes de leur choix. Le gagnant, il va sans dire, protégé par Dieu, était nécessairement celui dont la cause était juste. C'était vrai lors d'un combat singulier. Et ce l'était également quand des armées se faisaient face. Encore en 1485, quand Henri Tudor montera sur le trône pour devenir Henri VII d'Angleterre, après sa victoire sur Richard III, les députés des communes invoqueront le jugement de Dieu pour expliquer le fondement du droit à la Couronne du nouveau roi.
NEILSON, préc. au par. 150, p. 19; R. BARTLETT, préc. au par. 150, p. 14; Statut confirmant le titre du roi (Titulus Regis), 1 Hen. 7, c. 1, dans Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, pp. 499-500.
Duel judiciaire
Duel entre Henri de Essex et Robert de Montfort à l'Abbaye de Reading, 8 avril 1163,
peinture par Harry Morley (1881-1943)
Ce duel judiciaire a été décrit et commenté par J.B. HURREY dans The Trial by Combat of Henry of Essex and Robert de Montfort at Reading Abbey, Londres, Elliot Stock, 1919.

Par. 156 Rappelons que toutes ces procédures ne pouvaient être introduites devant une cour de justice sans le consentement des parties. Nous avons déjà mentionné, au paragraphe 68, que toute victime ou son clan possédait le droit de se venger, conformément à la vieille coutume germanique. Mais que cela provoquait parfois un cercle de violences sans fin, car la violence appelait la violence, quand les supposés auteur d'un dommage ou leur clan ne reconnaissaient pas leur responsabilité. En outre, il n'était pas toujours évident, quand on se croyait victime, de renoncer à son droit de se faire justice pour laisser un tribunal procéder à l'arbitrage. Parce que les esprits s'échauffaient après la commission d'un délit, on ne réfléchissait pas toujours aux conséquences, avant d'entreprendre une vendetta. Le roi Alfred, plus encore que ses prédécesseurs, n'avait aucune envie que cela se poursuive. Mais il réalisait que le monde anglo-saxon était brutal, et que la vengeance, comme la vendetta, en faisaient partie. Au lieu de tout simplement les interdire, il a donc cherché à les réglementer pour en minimiser la portée. Son innovation la plus intéressante a été d'exiger des victimes qu'elles offrent à leur agresseur la possibilité d'un recours aux tribunaux avant de leur faire violence, puis d'attendre sept jours sans agir lorsqu'elles pouvaient le confiner dans sa demeure, avec ou sans l'aide des agents du roi. Et si, aux termes des sept jours, l'auteur du dommage acceptait de remettre ses armes, la victime devait encore attendre trente jours sans l'attaquer, puis aviser son clan et ses amis de l'objet de sa poursuite. D'autres modalités étaient prévues en cas de difficultés.
Lois d'Alfred le Grand, c. 42, ATTENBOROUGH, préc. au par. 76, pp. 83 et 85.
4. Conquête normande
4.1 Conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie
Par. 157 Reprenons la chronologie des événements qui ont conduit Édouard le Confesseur au pouvoir. Emma de Normandie a épousé successivement deux rois d’Angleterre : Ethelred le Malavisé, le roi saxon qui a régné jusqu’en 1016, et Knut le Grand, le roi danois qui l’a combattu et dépossédé son fils Edmond Côte-de-Fer de son trône, pour régner à son tour de 1016 à 1035 (voir l’arbre généalogique des maisons du Wessex et du Danemark suivant le par. 52). Emma a d’abord enfanté Édouard avec son premier mari Ethelred, puis elle a donné naissance à Knut le Hardi pendant son second mariage avec Knut le Grand. Le Hardi a hérité de la Couronne d’Angleterre en 1040 après la mort de son demi-frère Harold, surnommé Pied de Lièvre, l’aîné de Knut le Grand né de son premier mariage. Le Hardi, dont la santé était fragile, n’a cependant régné que deux ans. La lignée de Knut le Grand étant éteinte, Édouard, le demi-frère du Hardi par sa mère Emma de Normandie, restait le seul successeur sérieux. Il est monté sur le trône en 1042 avec l’accord des grands du royaume réunis au sein du Witan anglo-saxon.
Portrait fictif d'Édouard le Confesseur
National Portrait Gallery, Wilton Diptych
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 158 Edmond Côte de Fer était le fils d’Ethelred et de sa première épouse Ælfgifu. Lorsque son demi-frère Côte de Fer avait perdu sa Couronne et sa vie, en 2016, le jeune prince Édouard a trouvé refuge en Normandie, où il a vécu 34 ans. Édouard rejoignait ainsi sa famille, puisque sa mère se trouvait être la fille de Richard Ier, duc de Normandie et fondateur de la maison des richardides. Édouard était par conséquent le petit-fils de Richard Ier, premier duc de Normandie, le neveu de Richard II, second duc de Normandie, le cousin de Robert Ier, troisième duc de Normandie, et le petit-cousin de Guillaume Ier, quatrième duc de Normandie et futur conquérant de l’Angleterre.
Par. 159 Édouard a vécu si longtemps avec sa famille normande qu’il en a presque oublié sa culture d’origine. À son arrivée sur le trône d’Angleterre, Édouard, auquel on donnera le surnom de Confesseur, connaissait effectivement peu son héritage saxon. Certains ont dit qu’il ne parlait guère la langue des Anglais. Le patois normand, une langue d’oïl proche du français, était devenue sa première langue. Il a naturellement voulu s’entourer de personnes familières, pour l’essentiel des Normands. Cela a beaucoup déplu aux grandes familles d’Angleterre, celles des earls de Northumbrie, d’Estanglie, de Mercie et du Wessex.
Par. 160 Godwin, le plus puissant earl, gouvernait le Wessex. Or, la famille de Godwin a cherché par tous les moyens d’écarter les amis normands d’Édouard pour établir son propre pouvoir à la Cour. En 1043, l’année du sacre d’Édouard dans la cathédrale de Winchester, Godwin s’est même emparé du trésor royal. Il a ainsi pu contraindre Édouard à épouser sa fille Édith de Wessex deux ans plus tard. Le clan des Normands n’a pas baissé les bras. Pendant l’été 1051, après de durs combats, Godwin et sa famille ont été exilés. Des Normands ont bien sûr occupé les sièges laissés vides. Le neveu d’Édouard du côté de sa mère, Raoul de Mantes, a été nommé earl du Herefordshire, alors que Robert, l’ancien abbé de Jumièges et confident du roi, a été intronisé pour sa part comme archevêque de Cantorbéry. D’autres Normands se sont vus confier des domaines importants dans le Devon, le Somerset, le Dorset, les Cornouailles et l’Essex.
Par. 161 Toujours au cours de l’année 1051, Robert de Jumièges, à son retour de Rome pour y recevoir son pallium des mains du pape Léon IX, mais avant d'être sacré, celui qui sera le nouvel archevêque de Cantorbéry et primat de l'Église d'Angleterre a fait un arrêt en Normandie pour rencontrer le duc Guillaume. Il l'aurait informé d'une grande nouvelle : puisque Édouard n’avait toujours pas d’héritier et qu’il venait de répudier la femme qu’on lui avait imposée, la sœur de Godwin, il aurait désigné Guillaume pour lui succéder sur le trône d'Angleterre. L'inimitié entre Édouard et Godwin rendait cela tout à fait plausible.
Par. 162 L’earl Godwin, exilé depuis un an, a effectué un retour au pays en 1052. Bien équipé en hommes et en armes, il a sommé Édouard de revenir à de meilleures dispositions. Un roi affaibli a accepté la paix proposée. Presque tous les amis normands du roi ont dû fuir. Un nouveau Witan a été convoqué pour entériner ce qui avait déjà été décidé par les vainqueurs : la famille Godwin a été réhabilité, alors que tous les Normands ont été bannis, à quelques rares exceptions près. Mais l’earl Godwin n’a pas goûté longtemps les fruits de sa victoire, car il est mort le 15 avril 1053. Son fils Harold Godwinson lui a succédé à la tête du Wessex.
Par. 163 Au cours de l’année 1064, à la fin du printemps ou au début de l'été, sans trop que l’on en connaisse la raison exacte, Harold traversa la Manche pour se rendre en Normandie. Ce serait par suite de l’invitation du duc Guillaume à son parent anglais, d’après l’archevêque Robert de Jumièges. Mais peut-être voulait-il tout simplement la libération de son frère et de son neveu tous deux tenus en otage par le duc Guillaume ! En tout état de cause, Harold a fait ses préparatifs, traversé la mer, puis débarqué sur la côte à Ponthieu où il est tombé entre les mains de Guy, le comte d’Abbeville, qui l’a retenu prisonnier. Guillaume, dès qu’il en fut informé, a vite fait d’exiger sa remise en liberté. Harold a alors vécu quelque temps à la Cour de Guillaume.
D. BATES, Guillaume le Conquérant, Paris, Flammarion, 2018, pp. 237-238 et 269.
Par. 164 À la demande pressante du Normand, Harold aurait promis d’aider son hôte à devenir roi d’Angleterre, après le décès du Confesseur. Harold pouvait difficilement refuser sans prendre le risque de l’offenser. Il aurait répété à de multiple reprises son serment de fidélité, avant de repartir pour l’Angleterre en compagnie de son neveu, mais sans son frère. On ne sait pas si cette version de l’histoire racontée par l'archevêque Guillaume de Poitiers correspond à la stricte vérité. Le conditionnel s’impose car rien ne le prouve, sauf la parole du Conquérant et de son archevêque, les principaux intéressés. Elle semble néanmoins fort probable au vu des propos ultérieurs d'Harold qui aurait affirmé avoir agi sous la contrainte. Cependant, le contenu et la signification des promesses n'ont pas été nécessairement compris de la même manière par les deux hommes.
BATES, ibid.; GUILLAUME de POITIERS ou de JUMIÈGES, préc. au par. 47, pp. 220-221.
Par. 165 Le 28 décembre 1065, Édouard est demeuré alité. On l’a conduit à son palais de Westminster. Peu avant de mourir, le 4 ou le 5 janvier, il aurait chuchoté à l’oreille d’Harold qu’il lui recommandait son épouse et son royaume. Ses dernières paroles ont été rapportées par un moine sur demande d’Édith de Wessex, la reine et défunte épouse d’Édouard, Édith de Wessex. Le dernier vœu du mourant manquait de clarté, pour dire le moins. Mais peu lui importait ! Cela a suffi à Harold fils de Godwin pour se prétendre l’héritier du défunt. Le Witan a procédé sans délai à l’élection d’Harold qui a été couronné et sacré séance tenante, probablement à Westminster.
BATES, id., p. 256; ANONYME, Vita Edwardi Regis (The Life of King Edward), année 1067, F. Barlow (trad.), Londres, Thomas Nelson and Sons Ltd., 1962, p. 79; CHRONIQUES, préc. au par. 33, année 1065, pp. 128-129.
Portrait fictif d'Harold Godwinson, dernier roi anglo-saxon
Auteur inconnu
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains
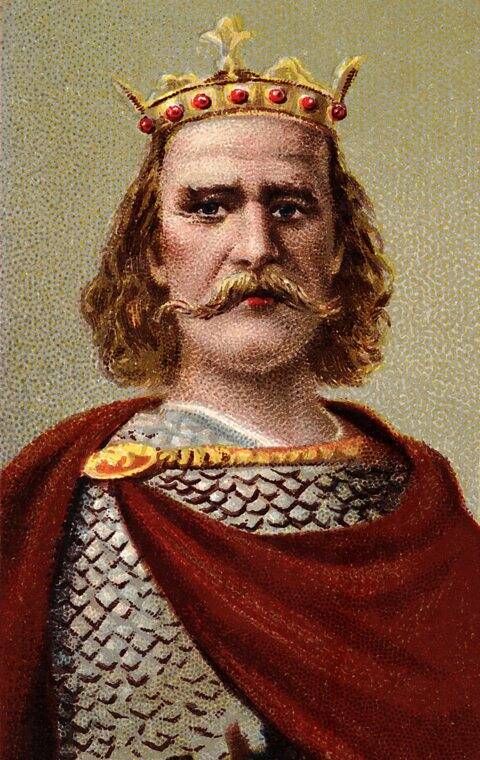
Par. 166 Guillaume de Normandie a évidemment protesté en rappelant à Harold son serment. Ce dernier lui aurait répondu qu’ayant juré sous la contrainte, son serment n’avait aucune valeur, avant d’ajouter que le roi, dans un dernier souffle, avait annulé toute autre désignation antérieure. Chacun est resté campé sur ses positions. Mais peu importait ! Ce qui comptait le plus était que tous deux avaient des arguments juridiques, moraux et populaires que leurs partisans jugeraient convaincants. Car la force des armes plutôt que la force du droit, encore incertain et terriblement complexe en matière de succession devrait trancher en faveur de l’un ou l’autre prétendant à la Couronne.
BATES, id., p. 263.
Par. 167 L’Angleterre disposait de plus d’hommes et d’argent que la Normandie. Guillaume devait donc compenser la pauvreté de ses ressources par une meilleure préparation. C’est ce à quoi il s’est employé, sans hâte excessive mais sans perte de temps. L'archevêque Guillaume de Poitiers nous en a fait le récit.
GUILLAUME de POITIERS ou de JUMIÈGES, préc. au par. 47, pp. 388-393.
Par. 168 Guillaume a d’abord voulu établir le fondement légal de son entreprise. D’après Lanfranc, abbé de Saint-Étienne de Caen et juriste réputé qui a défendu la thèse normande, le défunt roi d’Angleterre avait constitué Guillaume comme son héritier, puis aurait fait en faveur d’Harold une donation à l’article de la mort. Le premier acte était en tous points comparable un testament de type romain avec les gages et le serment qui lui donnait toute sa valeur, alors que la donation en faveur d’Harold ne possédait pas les mêmes garanties, a poursuivi Lanfranc. En outre, en raison de son ambiguïté, cette donation pouvait être interprétée comme faisant d’Harold un simple exécuteur testamentaire, a conclu le juriste. Peu importe la valeur du raisonnement de Lanfranc, il témoignait de la volonté du duc de Normandie de fonder son action sur le droit, de se poser en successeur légal d’Édouard le Confesseur. Cela lui était indispensable pour continuer la préparation de son invasion.
Par. 169 Guillaume de Normandie a également entrepris plusieurs initiatives diplomatiques. Il lui fallait des soutiens, en plus de prévenir les attaques contre son duché pendant son absence.
Par. 170 D’après l’archevêque Guillaume de Poitiers, le Normand a notamment écrit au pape Alexandre II pour lui soumettre son affaire. Il a accusé Harold de parjure, ce qui lui permettait de conférer compétence à la cour du souverain pontife pour juger sa cause. Il n’a pas manqué de lui promettre le rétablissement de l’impôt du chevage, levé autrefois par Knut le Grand au profit de Rome, puis aboli par Édouard. Il a aussi laissé entendre qu’il pourrait réformer le clergé anglo-saxon dans le sens voulu par Rome, ce à quoi s’opposait Stigand, l’archevêque de Cantorbéry. Au cours du printemps de 1066, le pape, se disant désormais convaincu du bon droit de Guillaume, aurait supposément excommunié Harold pour son parjure, diront plus tard d’autres chroniqueurs pour embellir l’histoire. Alexandre II, toujours d’après l’archevêque, a même envoyé à Guillaume un lot de reliques, en plus de la bannière de saint Pierre pour servir d’étendard à ses armées. Il l’a désigné comme son mandataire et a qualifié son entreprise d’œuvre pie.
GUILLAUME de POITIERS, id., pp. 388-389. Toutefois, certains doutent de la parole de l’archevêque Guillaume. Lire C. MORTON, « Pope Alexander II and the Norman Conquest », (Avril-Juin 1975) T. 34, Fasc. 2. Latomus 362, ainsi que BATES, préc. au par. 161, pp. 273-274.
Par. 171 Dans le même temps, Guillaume a communiqué avec les princes séculiers d’Europe. Il voulait, sinon leur alliance, du moins leur bienveillante neutralité. Il a fait à tous de belles promesses en restant vague sur le contenu de ses engagements. Indépendamment de la position arrêtée par leur propre seigneur, un nombre impressionnant d’hommes venus de Flandres, de Bretagne, d’Île-de-France, de Picardie, du Poitou, jusqu’à la Navarre et l’Aragon, se sont engagés dans l’armée de Guillaume, attirés par la solde et le butin à capturer. Des promesses mirobolantes ont été faites.
BATES, id., p. 278.
Par. 172 Le duc Guillaume devait également convaincre ses Normands de l’accompagner outre-mer, car la coutume féodale ne lui permettait pas de les y contraindre. Il fallait transporter et débarquer en bon ordre toute une armée sur l’autre rive de la Manche et se battre contre des forces probablement supérieures en nombre. Guillaume pouvait toutefois compter sur l’instinct de combattant des Normands, attirés à la fois par l’aventure, par l’honneur et par l’appât du gain. Avantage non négligeable, il a fouetté leur ardeur en plaidant que Dieu avait béni leur expédition.
Par. 173 La chance souriait décidément au duc de Normandie. Dès la fin de juillet 1066, sa flotte était prête, pendant qu’Harold Godwinson l’attendait de l’autre côté de la Manche, au sud de son île. Des vents défavorables ont cependant empêché Guillaume de lever les voiles. Août passa, septembre également. Heureux contretemps car Harold a cru que l’invasion serait reportée au printemps suivant. Il a donc renvoyé dans leur foyer les hommes de son fyrd, cette armée féodale de conscrits, en ne conservant que sa troupe d’élite. Pendant ce temps, des Vikings de Norvège ont tenté une invasion par le nord de l’Angleterre. La nouvelle a pris Harold par surprise. Comme les forces locales se sont révélées impuissantes, incapables de repousser les hommes du Nord, maintenant rendus près de la ville d’York, Harold et sa troupe les ont rejoints à marche forcée en se joignant le long de la route aux détachements du fyrd du Wessex. Harold, ce lundi 25 septembre, y a remporté une grande victoire. Deux jours plus tard, le duc Guillaume a donné l’ordre à ses navires de larguer les amarres et de voguer vers l’Angleterre. Il a débarqué peu après sur les rives du Sussex. Pas un soldat, pas une barque ennemie n’était en vue. Harold se trouvait encore loin. Guillaume a jugé bon de gagner les environs de la ville de Hastings pour s’y fortifier avec sa flotte à proximité. C’est là qu’il a préparé sa bataille contre Harold. Ce dernier, après avoir été informé de l’arrivée des Normands le 1er ou le 2 octobre, est retourné aussi rapidement sur la côte à la tête de son armée, malheureusement déjà épuisée par ses combats contre les Vikings. Des dissensions internes parmi les earls ont empêché Harold de s’approvisionner en troupes fraiches. L’armée anglaise se trouvait désormais en nombre sensiblement égal à celle de Guillaume, quoique mal pourvue en cavaliers et en soldats de métier. L’affrontement entre les deux camps a eu lieu samedi le 14 octobre 1066. Harold, fils de Godwin, dernier roi anglo-saxon d’Angleterre, a été tué. Son règne aura duré 10 mois. Guillaume, désormais le Conquérant, a remporté la victoire et la Couronne qu’il convoitait. L’Angleterre ne sera plus jamais conquise par une armée étrangère.
Bataille de Hastings, le samedi 14 octobre 1066
Tapisserie de Bayeux

Par. 174 Guillaume a réclamé les terres de la Couronne qu’il considérait son dû à titre d’héritier légitime du roi Édouard. En vertu des coutumes, Guillaume pouvait aussi s’approprier les biens de ceux qui l’avaient combattu, à commencer par l’immense patrimoine foncier du clan Godwin et de ses alliés. Car la participation à la bataille sous la bannière d'Harold en avait fait des traitres. Et toute leur famille se trouvait par le fait même déshéritée.
BATES, id., pp. 345-346.
Par. 175 Mais l’Angleterre n’était pas totalement sienne, pas encore. Au lendemain de la bataille d’Hastings, Guillaume a réorganisé son armée, puis s’est mis en marche. Il ne s’est pas rendu directement à Londres. Il a préféré suivre un parcours irrégulier passant par Douvres et Cantorbéry. Il a traversé les shires de Surrey, de Hamp, de Hereford et du Middlesex. Ses soldats ont ensuite dévasté et pillé les environs de Londres en guise d’avertissement et aussi pour asphyxier progressivement la métropole. L’archevêque Stigand a demandé à le rencontrer pour lui rendre l’hommage. Quelques jours après, l’aetheling Edgard, l’arrière-petit-fils du roi Ethelred le Malavisé et le petit-fils du roi Edmond Côte de Fer, a renoncé à la Couronne. Il est venu à la rencontre de Guillaume en compagnie des prélats et de représentants de la cité de Londres pour lui jurer fidélité. Avant de les rejoindre, Guillaume, par mesure de prudence, avait ordonné à ses hommes d’édifier un fort en bois adossé à ses remparts, du côté Est et donnant sur les rives de la Tamise, à l’emplacement exact de la future Tour de Londres, car la voie d’invasion la plus probable passait par l’estuaire de ce fleuve.
BATES, id., pp. 301-306; G.J. TURNER, « William the Conqueror's March to London in 1066 », (1912) vol. 27 The English Historical Review 209-225.
Par. 176 Guillaume s’est fait couronner roi à Westminster le 25 décembre 1066. Il a pénétré dans l’église abbatiale où Édouard le Confesseur avait été inhumé, et qui sera plusieurs fois remaniée pour devenir l’abbaye de Westminster que l’on connait aujourd’hui. Guillaume y aurait invité les thanes et les prélats anglo-saxons, de même que ses seigneurs normands. Sur l’ordre de Guillaume, on a demandé à l’assistance, en anglais puis en normand, de l’accepter pour roi. Une double et longue acclamation a suivi. Cette approbation toute formelle des participants devait remplacer la procédure d’élection à laquelle le Normand a refusé de se soumettre. Eldred, l’archevêque d’York, a ensuite présidé la cérémonie de couronnement selon l’usage. Guillaume a prononcé le serment habituel depuis Edgard le Pacifique de protéger l’Église, de gouverner avec justice et équité, d’observer les bonnes coutumes et de s’interdire la violence.
GUILLAUME de POITIERS, préc. au par. 47, pp. 415-418.
Guillaume Ier, dit le Conquérant
Statue située à Falaise (Calvados), œuvre de Louis Rochet 1851

Par. 177 Le choix de l’abbaye de Westminster par le Conquérant a marqué le début d’une longue tradition; en effet, tous les rois et toutes les reines d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, y ont été couronnés. Plusieurs en ont même fait leur lieu de sépulture afin de se rapprocher de son fondateur, Édouard le Confesseur, canonisé en 1139. Le nom de Westminster (autrefois une ville et aujourd'hui un faubourg de Londres) vient de l'abbaye. En effet, West (ouest) et Minster (monastère) signifient littéralement le monastère qui se trouve à l'ouest de Londres.
Abbaye et palais de Westminster en 1066
Reconstitution par Terry Ball et Richard Gemm,
sur le site https://www.westminster-abbey.org/

Par. 178 Bien qu’étant couronné, Guillaume ne régnait pas vraiment sur toute l’Angleterre. Il ne contrôlait que le Kent, le Sussex, l’Essex, l’Estanglie, la région de Londres et une portion de la Mercie, autrement dit le sud du pays, qui se trouvait aussi la partie la plus riche et la plus peuplée. L’Ouest, soit les Cornouailles et le Wessex, de même que le Nord, au-delà du fleuve Trent, lui échappaient encore.
4.2 Mise en place d'une nouvelle aristocratie
Par. 179 Guillaume avait beaucoup promis pour réaliser son ambition et ce prix était fort élevé. Il lui fallait maintenant payer ses dettes. Bien sûr, Guillaume avait déjà amassé un énorme capital constitué par les biens de la Couronne et par ceux de la famille Godwin. Dès les premiers jours de 1067, Guillaume n'a donc pas manqué de récompenser ses principaux lieutenants en procédant à une première donation de terres en sol anglais. Sur l’une des premières chartes où il a consigné son acte, il s’est fièrement intitulé « seigneur de Normandie et roi d’Angleterre par droit d’hérédité ».
Charter by William I, Lord of Normandy and King of England by hereditary right [?1067], H.W.C. DAVIS (éd.), Regesta Regum Anglo-Normannorum, 1066-1154, vol. 1 (Regesta Willelmi Conquestoris et Willelmi Rufi, 1066-1100), Oxford, Clarendon Press, 1913, p. 5, no. 21.
Par. 180 Le nouveau roi d’Angleterre voulait sans aucun doute que la bonne entente règne entre Anglo-saxons et Normands. Il a immédiatement promulgué un règlement de police rappelant à tous l’égalité des hommes devant Dieu et le devoir des vainqueurs de ne pas opprimer sans mesure les vaincus. Des peines graves sanctionnaient le viol, le meurtre, le vol, les rixes, l’abus de boisson et la fréquentation des prostitués. Une juridiction spéciale devait prendre connaissance de ces délits.
Lois de Guillaume le Conquérant, en français et en latin, publiées par J.E. MATZKE, avec une préface historique par Ch. Bémont, Paris, Alphonse Picard et Fils, 1899. Pour un commentaire détaillé, et critique, lire l’essai de maîtrise de S.D. SARGENT, An Examination of the Laws of William the Conqueror, Amherst, University of Massachussetts, 1976, ainsi que E.A. FREEMAN, History of the Norman Conquest, vol. 4 (The Reign of William the Conqueror), 2e éd. rév., Londres, MacMillan and Co., 1878, pp. 30-32.
Par. 181 De nombreux nobles anglo-saxons sont alors venus offrir leur soumission à Guillaume. Le roi a nommé deux earls normands, Guillaume fitz Osburn et l’évêque Odo de Bayeux, mais a maintenu dans leur poste trois earls anglo-saxons : Waltheof, Edwine et Morcar, des seigneurs du nord du pays. Deux tiers du royaume se trouvaient toujours entre leurs mains. La plupart des shérifs autochtones sont également demeurés en fonction. Aucun prélat anglo-saxon n’avait encore été déposé, incluant le puissant archevêque Stigand de Cantorbéry. Guillaume a enfin choisi de conserver auprès de lui plusieurs grands thanes du palais d’Édouard comme le prêtre Ingelbric et le chancelier Regenbald. À l'évidence, Guillaume a voulu et cherché à gouverner en amitié avec les Anglo-Saxons. Ses premières lois ont d'ailleurs prescrit des règles sévères afin de protéger ses nouveaux sujets.
The Ten Articles of William I, dans A.J. ROBERTSON (éd.), Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I, Cambridge, Cambridge University Press, 1925, ouvrage réimprimé en 2009, p. 239-243. Lire également STENTON, préc. au par. 37, pp. 399, 623 et 624.
Par. 182 La bonne entente entre les races n’a pas duré. Les troubles devaient durer plusieurs longues années. Il faut préciser que les indigènes ont souvent été méprisés, volés, violés ou tués par les compagnons du Conquérant. Beaucoup de ces actes ont été documentés. Guillaume les a jugés légitimes ou au moins excusables.
BATES, préc. au par. 163, pp. 423-424.
Par. 183 Au printemps de 1067 sont apparus dans les campagnes des bandes de hors-la-loi, des outlaws, à moitié résistants, à moitié brigands, qui se déplaçaient constamment pour échapper aux soldats de Guillaume. Les Normands les ont appelés des sauvages, mot qui traduisait en réalité leur qualité d’hommes des bois. Le petit peuple en a fait des personnages de folklore non sans ressemblance avec Robin des Bois, un héros imaginaire qui aurait habité la forêt de Sherwood quelque cent trente années plus tard, lors du règne du roi Jean. Ces outlaws anglo-saxons auraient juré de ne trouver aucun repos tant qu’il resterait un Normand sur le sol anglais. Un chroniqueur du début XIIe siècle a rappelé leur lutte contre les envahisseurs :
« [...] many plots were hatched in the kingdom of England by those who resented the unaccustomed yoke of a foreign rule. Some of them hid in woods and islands, living like outlaws and plundering and attacking those who came their way. »
Abingdon Chronicle, The abbey of Abington and its tenants at the time of the Norman Conquest, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 965.
Par. 184 Ces outlaws n’étaient pas seuls à résister à l’occupation; des révoltes ont éclaté ici et là dès 1067, puis à nouveau en 1068 et plus massivement en 1069. Guillaume a d’abord voulu rétablir la paix avec retenue, sans toutefois obtenir les résultats escomptés. Car les complots, les trahisons et les rébellions se sont poursuivis. Des troupes danoises ont contribué au désordre par leur retour en Angleterre avec des projets de conquête. Guillaume s’est dès lors trouvé confronté à un choix : soit il prenait le parti des Normands malgré leurs torts et conservait ainsi intactes les assises de son pouvoir, soit il défendait les Anglo-Saxons, certes plus victimes qu’agresseurs, mais avec la quasi-certitude de perdre ses soldats et sa Couronne. Guillaume a choisi de rester roi. Non sans hésitation, et après avoir tenté la négociation comme il en avait l’habitude, le Normand a donc entrepris de mater les régions hostiles et d’en faire des exemples. Par nécessité, et sans que Guillaume n'y prenne aucun plaisir, son règne est devenu un règne de terreur. Le changement de politique a été décidé et mis en œuvre dès 1069. Au cours de l'année suivante, Guillaume, en personne, a même poursuivi les rebelles jusqu’au nord du fleuve Humber afin de les exterminer, en détruisant tout sur son passage. Ses soldats n’ont laissé subsister ni maison, ni champ cultivé. Toute vie devait disparaître. Cela a été un véritable massacre qui a marqué la mémoire collective des Anglais, pourtant habitués aux horreurs de la guerre.
CHRONIQUES, préc. au par. 33, pp. 128-136; FREEMAN, préc. au par. 180, vol. 4 (The Reign of William the Conqueror), pp. 11, 15, 128, 145 et 233-319, surtout 287-288; BATES, préc. au par. 163, pp. 377-386.
Par. 185 Toujours en accord avec la coutume féodale qui attribuait au prince les biens abandonnés, au nom de droit de déshérence, Guillaume s’est considéré propriétaire des domaines ravagés par la guerre ou retombés en friche. À partir de 1070, il les a reclassés comme des forêts royales afin de se les réserver pour la chasse. En 1079, Guillaume a même ordonné l’évacuation du Hampshire, une région couvrant plus de 1 000 kilomètres carrés, avant de la transformer également en réserve de chasse. Non sans ironie, Guillaume l’a appelée Forêt Neuve alors que, pour la créer, soixante villages ou paroisses ont été rasés et leurs habitants expulsés. Des règles sévères furent adoptées dans le but de protéger et multiplier le gibier. Ces règles ont constitué un droit forestier créé de toutes pièces par la volonté du Conquérant. La forêt ayant été considérée jusque-là parmi les biens d’usage public, les Anglo-Saxons ont perçu la création des forêts royales comme une seconde catastrophe s’ajoutant à la domination normande.
H.R. LOYN, Anglo-Saxon England and the Norman Conquest, 2e éd., Londres, 1991, pp. 364-367; F. BARLOW, The Feudal Kingdom of England, 1042-1216, 5e éd., Abingdon, Oxon, Routledge, 1999, p. 98.
Par. 186 Le royaume semblait enfin pacifié vers la fin de l’été 1070. Bien sûr, toutes ces tueries et destructions empêcheront pour longtemps la réconciliation entre les Anglo-Saxons et les Normands. Elles ont eu toutefois l’avantage d’accroître le patrimoine du roi grâce à la confiscation des terres et autres biens de ses ennemis défaits. Guillaume savait qu’il ne règnerait plus que par la force et la terreur. Il a donc décrété un train de mesures pour mieux garantir la stabilité de son régime. Guillaume a entrepris la construction sur tout le territoire de forts en bois placés sous la garde de soldats normands, un type de construction dont l’édification était désormais considérée comme une prérogative de la Couronne. Pour éviter que quelque seigneur devienne trop puissant, le nombre d’earldoms a été immédiatement réduit et leur territoire ramené aux dimensions d’un ancien shire. Ils seront presque tous éliminés après la prochaine révolte de 1075. Pour les remplacer, les shérifs, maintenant tous des Normands, sont devenus les principaux administrateurs du roi dans les régions. Une série de nominations a également modifié la composition de l’épiscopat. Le roi a placé des hommes de confiance, encore des Normands, sur le siège des archevêchés de Cantorbéry et d’York, puis a personnellement pris part au recrutement de nouveaux évêques et abbés. À la fin du règne du Conquérant, en 1087, l’aristocratie anglo-saxonne avait été décapitée
STENTON, préc. au par. 37, p. 680.
Par. 187 Guillaume a exercé par nécessité un pouvoir presque absolu. Or, la nécessité, dans ces temps de violence, était souvent créatrice de droit. Le nouveau roi savait qu’il ne pourrait compter que sur la fidélité des Normands et autres continentaux qui avaient combattu à leurs côtés. Leur survie en pays hostile, a alors pensé Guillaume, dépendait de la généralisation d’un système féodal de tenure des terres, même à un degré plus avancé que ce qu’il connaissait dans sa Normandie. Il s’y est consacré le reste de son règne. Il lui fallait dès lors s’emparer de toutes les terres des Anglo-Saxons avant de procéder à une redistribution. Les occasions ne manquaient pas : une révolte, un décès ou un mariage permettait de les confisquer, de les séquestrer ou de les accepter à titre de gage. Guillaume en confiait ensuite la possession à des vassaux, environ 180 barons choisis principalement parmi les cadres de son armée, contre leur promesse de fournir un certain nombre de chevaliers. Il a également rétrocédé des terres à quelques seigneurs anglo-saxons restés fidèles tout en les vassalisant à leur tour. Tous les tenanciers en chef du roi, y compris les archevêques, les évêques et les abbés, car ils étaient aussi tenus au service militaire, devaient entretenir un contingent de chevaliers prêts à servir dans l’ost ou le fyrd royal. Guillaume pouvait ainsi mobiliser en tout temps une armée d’environ 5 000 chevaliers normands et autres alliés complètement équipés. C’était peu, considérant qu’ils maintenaient l’ordre dans un pays peuplé d’environs 2 000 000 d’autochtones. Plusieurs seigneurs entretenaient cependant des armées privées. Et le roi pouvait aussi compter sur des troupes de mercenaires financées par son trésor.
STENTON, id., pp. 627, 634 et 635; et C.W. HOLLISTER, « 1066 : The Feudal Revolution », (1968) vol. 73 The American Historical Review 708.
Par. 188 Guillaume craignait la cité de Londres. Et avec raison. Elle aurait pu impressionner n’importe lequel de ses contemporains : centre de commerce florissant, Londres comptait environ 20 000 habitants, ce qui en faisait la plus grande agglomération urbaine au nord de l’Italie. Paris la dépassera seulement vers l’an 1200. La stratégie de Guillaume a été d’encercler la cité de bord et d’autre de la Tamise par des ouvrages fortifiés.
Par. 189 Parmi les ouvrages qui ont laissé un souvenir durable, il y avait une tour en aval du fleuve, adossée aux murs encerclant Londres. Cette tour originale, d'abord construite en bois, sera démolie et remplacée par une solide construction en pierre, dont on est certain aujourd'hui qu'elle a été terminée entre 1068 et 1070. Les habitants la surnommeront la Tour blanche ou White Tower en anglais. Elle constituera plus tard le centre d’un vaste ensemble de plusieurs tours, remparts, portes et fossés, connus sous le nom de Tour de Londres. Ses bâtiments serviront à la fois de résidence royale et de prison. Ils constituent aujourd’hui l’un des plus célèbres musées de la capitale. On y conserve notamment les joyaux de la Couronne.
BATES, préc. au par. 163, pp. 388-389.
La Tour blanche
Photo prise en 2009

Par. 190 En amont du fleuve, à 37 kilomètres de Londres, Guillaume a fait construire une autre forteresse en bois dans la vieille cité de Windsor. Au XIIe siècle, Henri II transformera également cette forteresse en un château en pierre. Il sera modifié et agrandi par la suite pour devenir l’une des principales résidences royales. George V (règne 1910-1936) s’est rappelé Windsor lorsqu’il a voulu choisir un nouveau nom pour sa famille, au lieu de celui trop allemand de Saxe-Cobourg et Gotha qu’il tenait de son père, l’époux de la reine Victoria.
Par. 191 Guillaume avait également hérité du palais qu’Édouard le Confesseur avait fait ériger à Westminster, en bordure de la Tamise, et voisin de l’abbaye où Guillaume avait été couronné. Ce palais deviendra le centre administratif du gouvernement sous la maison de Plantagenêt aux XIIIe et XIVe siècles. Le fils du Conquérant, Guillaume II, surnommé le Roux (règne 1087-1100), lui ajoutera Westminster Hall, une vaste salle de 73 mètres de long par 20 mètres de large, le principal bâtiment ayant survécu à l’incendie qui ravagera le palais en 1834 et que l’on peut encore visiter aujourd’hui.
Note: Voir également plus haut au par. 175 un croquis représentant le palais de Westminster d'Édouard le Confesseur.
Westminster Hall intérieur et extérieur aujourd'hui
Photos prises en 2009.


Par. 192 À Gloucester, à la Noël de 1085, Guillaume a ordonné une vaste enquête afin d’établir un cadastre de toutes les propriétés foncières de son royaume, à l’exception de quelques régions dans le Nord. L’objectif principal de Guillaume était de chiffrer ses revenus de taxation foncière en fixant l’assiette du heregeld ou geld. Cette enquête, terminée à la fin de l'été ou au début de l'automne 1086, sera finalement colligée dans un ouvrage connu sous le nom de Domesday Book, ou Livre du Jugement Dernier en français, dont on ne connait pas la date exacte où il fut produit.
BATES, préc. au par. 163, pp. 552-553; Account of the Domesday inquisition by an analyst of Worcester early in the twelfth century, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 914.
Par. 193 Les experts, non sans quelque difficulté, ont évalué la valeur des terres du Domesday Book à 73 000 livres, dont la Couronne pouvait tirer chaque année quelque 22 500 livres de rente. Le Domesday Book nous apprend aussi une foule d’autres renseignements sur le dénombrement de la population, l’inventaire de leurs biens fonciers et les revenus afférents. On a pu savoir que peu de nobles anglo-saxons avaient conservé leurs terres; il ne leur restait effectivement que 5% du sol anglais. Les nouveaux propriétaires, des nobles continentaux, en avaient environ 50%, dont la moitié était entre les mains d’une douzaine de familiers de Guillaume, les nouveaux hauts barons du royaume. Ce qui revient à dire que les 168 barons restants se partageaient l’autre moitié. Quant au roi Guillaume lui-même, il possédait en propre l’héritage d’Édouard le Confesseur, les biens de la famille d’Harold Godwinson, auxquels se sont ajoutés au fil des ans d’autres domaines qu’il a saisis en raison de la forfaiture de leur maître ou de l’absence d’héritier, pour un total d’à peu près 20% des terres. Le reste, soit 25%, était occupé par les institutions religieuses. Ces douze hauts barons amis du Conquérant, avec les deux archevêques, les seize évêques et les quelques abbés, représentaient l’aristocratie du royaume. Leur revenu individuel moyen dépassait les 1 000 livres, que l'on peut comparer aux 100 livres de rente annuelle des autres 168 barons de moindre importance.
S. HARVEY, Domesday, Book of Judgment, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 210-238. On peut aussi consulter les sites internet de la B.B.C., à https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zkpm7yc#z2bsp4j, et du Hull Domesday Project, à https://www.domesdaybook.net/domesday-book/.
Superficie des terres anglaises possédées par chaque catégorie de personnes
Graphique tiré du site de la BBC sur le Domesday Book.

Par. 194 En France, chaque tenure en fief, duché ou comté, agissait comme une barrière qui empêchait le roi ou tout autre seigneur d’interférer dans les relations de ses vassaux avec leurs propres tenanciers, chevaliers ou paysans. Cela aurait été vu par le vassal comme une ingérence inacceptable dans ses affaires. Ducs et comtes français régissaient donc leur domaine (on disait également leur honneur) avec une grande liberté, en quasi-souverain. Le roi et d’autres grands seigneurs ont alors tenté, avec plus ou moins de succès, de faire prêter à leurs vassaux un hommage prééminent, appelé un hommage lige. Un tel hommage l’emportait sur tous les autres lorsqu’un tenancier s’unissait à plusieurs seigneurs. Et bien, il servira au roi d’Angleterre plus qu’à tout autre au Moyen Âge.
F. BARLOW, préc. au par. 185, p. 88.
Par. 195 En effet, lors d’une grande assemblée tenue le 1er août 1086 à Salisbury, donc peu après l’enquête du Domesday Book, le roi Guillaume a exigé de ceux qui possédaient des terres, donc plusieurs centaines de personnes, ses tenanciers en chef, mais également ses arrière-vassaux et leurs propres tenanciers, de lui prêter un serment qui en faisaient ses hommes liges : de cette manière, le pays entier, enfin celui qui comptait, s’était engagé à lui rester fidèle envers et contre tous, comme à lui porter secours face à tous ses ennemis domestiques et étrangers (both within and without England).
Laws of William the Conqueror (1086), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 431. Lire aussi STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, pp. 288-290, BATES, préc. au par. 163, p. 567, et Willelmi Articuli Retractati, Decrees and legal reforms of our lord King William the Bastard, which he established in England, formerly called Britain, ROBERTSON, préc. au par. 181, p. 245.
Par. 196 Les Chroniques anglo-saxonnes ont noté à propos du serment en cause : « [traduction] que le roi Guillaume s’est rendu ce 1er août (fête de Lammas) à Salisbury, là où le Witan l’a rejoint, et tous ceux qui possédaient des terres en Angleterre. Et peu importe leur condition, tous se sont inclinés devant lui et sont devenus ses hommes, ont juré leur foi et promis qu’ils lui demeureraient fidèles envers et contre tous les autres hommes. »
CHRONIQUES, préc. au par. 33, année 1086, p. 141. Mais pour cette version citée des Chroniques, voir B. CARRUTHERS (éd.), The Anglo-Saxon Chronicle Illustrated and Annotated, Barnsley (South Yorkshire), Coda Books Ltd., 2014, année 1086, pp. 252 et 253.
Par. 197 Cette prestation collective de serment était déjà la coutume en Angleterre au moment de l’arrivée du Conquérant sur le trône. Elle sera codifiée dans les Assises de Northampton, une législation adoptée par le roi Henri II au sein de sa Cour en 1176. Celle-ci exigera des habitants de l’Angleterre, des plus grands seigneurs aux plus humbles paysans possédant des terres, de jurer allégeance au roi, que ce soit en personne ou devant ses juges. À partir du règne de Jean sans Terre, en mai 1199, la prestation collective de serment aura lieu dorénavant lors du couronnement du nouveau roi.
STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, p. 288-290; The Assize of Northampton (1176), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, préc. au par. 69, p. 444; On king John’s coronation, 25 mai 1215, R. of WENDOVER’S, Flowers of History : The History of England from the Descent of the Saxons to A.D. 1235, vol. 2, London, Henry G. Bohn, 1849, pp. 180 à 182. Lire également M. AURELL, L'empire des Plantagenêt 1154-1224. Paris, Perrin, 2025, p. 199.
Par. 198 Guillaume a également promulgué à différentes étapes de son règne des décrets ayant force de droit dans tout le royaume, bien que ceux-ci, parfois, ne faisaient que confirmer ce qui était déjà en vigueur depuis son arrivée en Angleterre. Retenons deux règles, essentielles pour suivre l’évolution du droit. La première réaffirmait l’application universelle de la tenure féodale (pas de terre sans seigneur), le système des fiefs en vertu duquel celui qui recevait une terre du roi ou d’un baron devait lui rendre en échange certains services et aides prévus par les coutumes. En réalité, la féodalisation de l'Angleterre avait commencé dès 1067 et était à peu près complétée lors du Domesday Book, sans même le besoin d’adopter une loi, simplement par le jeu des innombrables saisies, cessions et rétrocessions. La seconde visait à rassurer les Anglo-Saxons en maintenant les lois du roi Édouard le Confesseur, avec celles que Guillaume avait déjà décrétées pour assurer le bien-être du peuple. Guillaume, en se présentant en successeur d'Édouard, et jamais en conquérant, malgré son surnom, a toujours invoqué ainsi l'ancien droit pour légitimer sa position.
Laws of William the Conqueror (1086), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 431-432. Lire aussi STUBBS, vol. 1, préc. au par. 41, pp. 282-283 et 289-290, ainsi que ROBERTSON, préc. au par. 181, pp. 247 et 252 à 275.
Par. 199 Guillaume le Conquérant est mort le 9 septembre 1087 à l’âge de 59 ans. Trois de ses fils lui ont survécu : Robert l’aîné, Guillaume, surnommé le Roux, et Henri, dit Beauclerc. Adèle sera sa seule fille.
Arbre généalogique 2

Par. 200 Robert, un ambitieux trop pressé, avait trahi son père en participant à une série d’intrigues fomentées par le roi de France Philippe Ier le Batailleur et les comtes d’Anjou et de Flandres, Foulques IV et Robert Ier. Bien que le Conquérant lui ait légué le duché de Normandie, il a désigné son second fils, le toujours fidèle Guillaume le Roux, pour lui succéder sur le trône d’Angleterre. Cette désignation et l’adhésion des grands a permis de lui assurer la Couronne. Quelques années plus tard, Robert lui a cédé la Normandie, avant son départ en croisade pour libérer la Terre Sainte. Le royaume d’Angleterre et le duché de Normandie se trouvaient donc à nouveau réunis sous une même autorité. C’est aussi durant le règne du second roi de la maison de Normandie que des seigneurs normands ont conquis le sud du pays de Galles.
BATES, préc. au par. 163, pp. 474-483 et 582.
Portrait fictif de Guillaume II dit le Roux
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 201 Guillaume le Roux ne s’est jamais marié et n’a eu aucun enfant. Il mourra atteint par une flèche le 2 août 1100, à l'âge de 40 ans, lors d’une partie de chasse en compagnie de son frère cadet Henri. Des rumeurs ont longtemps couru que le soi-disant accident avait été organisé par le frère en question. Nul n’a jamais su.
William of Walmesbury, The deeds of the kings of the English, 1135-1140, On the death of William Rufus, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 316-318.
Par. 202 La mort inattendue et subite de Guillaume le Roux ne lui aura pas laissé le temps de désigner un successeur. Un Henri Beauclerc à l’esprit vif a alors profité de l’absence de son aîné Robert, qui se trouvait très loin en croisade, pour se précipiter à Winchester et y prendre possession du trésor royal. De là, il a pris le chemin de Westminster où il a été couronné quelques jours plus tard, le 5 août 1100, dans la même abbaye que son père. Robert est arrivé trop tard du Moyen-Orient pour contester l'élection et le couronnement de son frère. Furieux, on s'en doute, Robert s'est décidé à le combattre. Capturé par Henri le 28 septembre 1106, Robert terminera ses jours en prison après 28 longues années de captivité.
Portrait fictif de Henri Ier dit Beauclerc
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 203 Pour mieux se faire accepter des grands barons, Henri Ier (règne 1100-1135) a inclus dans son serment de couronnement une charte des droits de ses sujets, d’ailleurs suivant là l’exemple de ses prédécesseurs aussi loin que le roi Edgard le Pacifique en 973, mais qui contenait davantage que les habituelle vagues promesses. D’abord, Henri a admis devoir sa Couronne au consentement des barons, reconnaissant ainsi un caractère contractuel à l’institution monarchique, un rappel aux temps mythiques où l’élection par le Witan décidait réellement de la succession. Henri s’est en outre engagé à abolir les mauvaises coutumes. Certaines portaient sur les héritages, d’autres sur l’administration des biens ecclésiastiques laissés sans maître. Le roi a également renoncé à percevoir le heregeld des chevaliers servant dans son armée. Il a en outre rompu avec la coutume du serment général de fidélité prêté au roi par tous les hommes libres. Peut-être fallait-il y voir une autre concession aux barons du royaume ! Enfin, il a promis de maintenir la paix dans tout le royaume, ce qu’il cherchera à accomplir tout au long de son règne en rendant plus accessible la justice du roi.
“The Coronation Charter” of Henry I, 5 août 1100, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 432-434.
Par. 204 Henri Ier dit Beauclerc a eu un seul fils légitime, prénommé Guillaume. Malheureusement, celui-ci a disparu le 25 novembre 1120 dans le naufrage de son navire le White Ship. Son seul autre enfant était sa fille Mathilde, dont il a accordé la main en secondes noces à Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou, du Maine et de Touraine, père du futur roi Henri II d'Angleterre. Henri Ier a exigé de ses barons qu’ils reconnaissent en Mathilde son héritière. Seulement, les seigneurs anglais ne voyaient pas d’un bon œil la perspective d’être gouvernés par une femme dont l’époux était en outre le seigneur d’Anjou, trop français à leurs yeux. Le roi le savait, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. La désignation d’un héritier, ou plutôt d’une héritière, dans ce cas, n’aura pas suffi. Après la mort de roi Beauclerc, le 1er décembre 1135, Étienne de Blois (règne 1135-1154), le fils d’Adèle, sœur d’Henri Ier, se fera couronner à l’abbaye de Westminster avec l’appui des barons du royaume. Afin de garantir leur soutien, il avait fait rédiger et proclamer deux chartes confirmant leurs droits et admis devoir sa Couronne à leur consentement, tout comme son oncle Henri Ier avant lui. Imitant encore en cela son prédécesseur, il n’a pas exigé de serment général de fidélité des hommes libres du royaume.
Charter of Stephen addresses generally (1135) et Charter of Stephen addressed generally (1136), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), pp. 434-435 et 435-436.
Portrait fictif d'Étienne
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 205 Le pauvre Étienne a connu seulement trois maigres années de relative tranquillité. Mathilde, qui n’a jamais accepté le verdict des grands, a encouragé sa famille à s’y opposer. Son époux Geoffroy Plantagenêt s’est rendu guerroyer en Normandie dès 1138, pendant que David, le roi d’Écosse et oncle de Mathilde, envahissait le nord de l’Angleterre, et que Robert de Gloucester, son demi-frère, levait l’étendard de la rébellion à l’ouest du royaume. Geoffroy a capturé la Normandie en 1144 et s’y est autoproclamé duc. Après sa mort en 1150, son fils, Henri Plantagenêt, désormais duc de Normandie, comte d’Anjou, du Maine et de Touraine, s’est présenté à son tour comme le prétendant légitime au trône d’Angleterre.
Par. 206 Henri et Étienne semblaient d’égale force. Le décès de son fils aîné Eustache, en 1153, a cependant incité le roi à négocier avec son jeune opposant. Dans le Traité de Winchester, conclu le 6 novembre, et marquant la fin de la guerre civile, les parties se sont mises d’accord pour qu’Étienne continue à régner sa vie durant, mais qu’à son décès la Couronne aille à Henri plutôt qu’au fils survivant d’Étienne, le cadet Guillaume, peu intéressé par le pouvoir.
Charter of Stephen describing the Treaty of Winchester between the King and Henry, son of the Empress Maud, at the conclusion of the civil war (November 1153), dans E.H.D., vol. 2 (1042-1189), pp. 436-440.
Par. 207 Étienne est mort le 25 octobre 1154, donc moins d’un an après la signature du traité. Il a été le seul représentant de la maison de Blois. Le fils de Mathilde est devenu comme prévu Henri II d’Angleterre (règne 1154-1189), premier roi de la maison de Plantagenêt.
5. Féodalité anglo-normande
5.1 Modèle continental de la féodalité
Par. 208 Une certaine forme de féodalité avait déjà pris racine en Angleterre, avant l’arrivée des Normands, en raison de la multiplication des terres concédées en booklands. Rappelons que le bookland était un domaine appartenant à un seigneur qu’il faisait exploiter par des paysans. Sa charte, le document constatant son titre, lui reconnaissait certains droits de puissance publique semblables au fief français, dont celui de rendre justice. Dans l’Angleterre d’Édouard le Confesseur, il se trouvait conséquemment de moins en moins d’alleux, ces terres libres de toute taxe ou service possédées en pleine propriété par des paysans qui ne relevaient d’aucun seigneur. Guillaume le Conquérant a poursuivi et accéléré cette évolution en implantant un système plus proche du modèle continental de la féodalité. Il procéda d’abord en supprimant les alleux, de sorte qu’il ne se trouvait plus de terre sans seigneur, puis uniformisa les droits et les obligations entre le seigneur et ses tenanciers. Car, avant 1066, l’Angleterre ne connaissait pas encore le service de chevalerie, ni la cérémonie de l'investiture du vassal, ni le fief, ni la présence d’un château sur chaque terre concédée en fief.
Voir supra aux pars. 130 et 132. Consultez également l’ensemble des chartes répertoriés dans la partie des E.H.D. consacrée à l’introduction du système féodal en Angleterre, id., vol. 2 (1042-1189), préc. au par. 69, pp. 960 à 981, ainsi que le livre de F. BARLOW, préc. au par. 185. Sur l’universalité du système féodal après la mort de Guillaume le Conquérant, lire W. BLACKSTONE, préc. au par. 95, pp. 59-60, de même que les motifs de lord Haldane dans Amodu Tijani v. Secretary of Southern Rhodesia, [1921] 2 AC 399.
Par. 209 Comment introduire le sujet de la féodalité ? Nous l’avons à peine effleuré. Avant tout, la féodalité était une organisation sociale fondée sur un ensemble de serments individuels, des engagements sacrés, qui chacun établissait un lien personnel très fort entre deux hommes. Sur toute l’étendue d’un royaume, le roi, les grands et petits seigneurs, jusqu’aux paysans, étaient ainsi unis les uns aux autres par un réseau de droits et de devoirs réciproques dont l’objectif principal était de garantir la sécurité de tous. La féodalité, vue sous cet angle, apparaissait donc comme un vaste système de défense réciproque. Une autre manière de la décrire, certainement en temps de paix, serait de la comparer à une entreprise d’exploitation fondée sur des contrats entre le monarque et sa noblesse laïque et ecclésiastique, aux frais des paysans et des artisans, les seules véritables forces créatrices de richesse dans le royaume.
Pyramide féodale simplifiée
Graphique tiré du site de la BBC sur la féodalité

Par. 210 Le VIIIe siècle a vu apparaître cette nouvelle société fondée sur ce que l’on a appelé le lien vassalique. Son premier exemple connu date de l’année 757 et concerne le duc Tassilon de Bavière. Éginhard, un érudit qui a servi à la Cour des rois carolingiens, en a fait le récit :
« Tassilon, duc de Bavière, s’y rendit (à Compiègne) avec les premiers de sa nation, s’y recommanda, entre les mains de Pépin, en qualité de vassal, selon la coutume franque, et jura, sur le corps de saint Denis, fidélité, non seulement au roi, mais aussi à ses fils Charles et Carloman ».
ÉGINHARD, Annales des rois Pépin, Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, environ 801, dans M. Guisot, Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France, Paris, Chez J.L.J. Brière, libraire, 1824, pp. 6 et 7.
Par. 211 Vassal, vassalique et vassalité sont des termes d’origine celte. Ils ont apparemment pénétré le latin vulgaire de la Gaule romaine où on s’en est servi pour parler d’un jeune garçon, mais aussi d’un valet, celui qu’un maître avait constamment autour de lui. On disait alors mon vassal comme on dirait aujourd’hui mon gars. Le sens s’est modifié après la chute de l’Empire romain pour désigner le membre de la garde d’une maison, puis d’un homme libre tout à fait respectable qui louait ses services à un seigneur, tout en s’unissait à lui par un contrat librement consenti. La nouvelle recrue jurait alors fidélité et obtenait en retour un bénéfice matériel ainsi que la protection de son seigneur. Le statut social du seigneur rejaillissait sur son protégé qui gagnait non seulement sa protection et le bien promis mais également considération et prestige.
M. BLOCH, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1994, pp. 223-224.
Par. 212 Charlemagne (règne 768-814) est celui qui a généralisé les pratiques vassaliques pour maintenir le contrôle de ses hommes et de son royaume, puis de son nouvel empire, un projet impossible à réaliser directement sans le lourd appareil administratif qui lui faisait défaut. Il a alors multiplié les cessions de terre pour servir de bénéfice à ceux dont il voulait s’assurer la fidélité et s’engagea à les défendre. La terre cédée par le roi à son vassal l’était cependant sous condition : en échange, le roi a exigé une aide militaire, des guerriers que le vassal devait fournir à son appel pour servir dans son armée. Il a en outre encouragé ses vassaux à créer d’autres liens de subordination avec des seigneurs de rang inférieur, autrement dit à les faire entrer dans leur propre vassalité. Tous devaient ainsi se mettre sous la protection d’un seigneur plus fort qu’eux.
J. LE GOFF, La civilisation de l'Occident médiéval, Paris, Éditions Flammarion, Champs histoire, 2008, p. 40.
Par. 213 Au début du XIe siècle apparaît le terme technique qui sera éventuellement retenu pour désigner la terre cédée en remplacement du terme bénéfice : on a dit le fief. On le trouve une première fois dans les Livres de fiefs (Libri feudorumen latin), une compilation du droit des Lombards, le peuple germanique qui a occupé l’Italie après la chute de l’Empire romain. Son usage ne se répandra cependant qu’au XIIIe siècle. Nous l’emploierons néanmoins par commodité, car il a donné naissance à un vocabulaire d’usage courant de nos jours, nommément les termes de féodalité et de féodalisme pour décrire la société d’alors.
S. REYNOLDS, Fiefs and Vassals : The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 5.
Par. 214 Si l'on résume, au sommet de cette pyramide sociale trônait donc le roi, seul propriétaire légal des terres de son royaume. Celui-ci en confiait ou en laissait une partie à ses vassaux, des tenanciers en chef, appelés barons en Angleterre, ducs ou comtes en France. Il conservait le résidu pour se constituer une réserve. La terre concédée au baron anglais en contrepartie de l’engagement pris envers son roi était une baronnie, alors qu’en France il s’agissait d’un duché ou d’un comté, selon le titre porté par le seigneur recevant la terre. L’action du roi, lorsqu’il donnait ainsi une terre à un vassal pour qu’il la tienne en fief, se nommait l’inféodation. Elle garantissait au tenancier en chef la possession de sa terre. Pour donner foi à son engagement, le roi lui promettait la protection de ses armes et celle de sa cour de justice, car être le seigneur d’une personne comportait toujours le droit de lui rendre justice. En échange, le tenancier en chef encourait des devoirs envers son roi, des prestations vassaliques, qui étaient différentes formes d’aides en espèces ou en nature.
LE GOFF, préc. au par. 212, pp. 70-72.
Par. 215 Après que le roi lui eut confié sa terre, et assuré qu'il la protègerait, le tenancier en chef lui rendait l'hommage lige et donnait sa foi. Lors de l’hommage lige, le tenancier en chef, à genoux, nu tête et sans arme, plaçait ses mains entre celles de son roi qui se trouvait assis devant lui (clair symbole de soumission qui était dès l'origine l’essence même de l'institution), et prononçait tout haut ce serment pour que tous l’entendent : « Je deviens votre homme par la terre que je tiens de vous. Je vous jure fidélité et vérité de mon vivant et jusque dans la mort. Et je jure de vous défendre contre tous. » Le tenancier en chef se relevait et le roi l’embrassait, autre symbole, cette fois d'accord et d'amitié. Puis la foi était donnée dans un second temps. Le tenancier en chef, maintenant debout, la main sur les évangiles, continuait : « Écoute moi seigneur. Je vous serai fidèle. Je le jure sur ma vie, ma personne, mes biens, mes châteaux et autres possessions terrestres. Et que Dieu et les Saintes Évangiles me viennent en aide. »
M. BLOCH, préc. au par. 209, p. 210 et 211; POLLOCK et F.W. MAITLAND, The History of English Law before the time of Edward I, vol. 1, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1903, pp. 297-298.
Par. 216 Scellé par un serment sous l’égide de l’Église, l’engagement féodal était une promesse qui ne pouvait être résiliée unilatéralement. Tout seigneur, y compris le roi, se voyait contraint par son serment au même titre que ses vassaux. Ils étaient indissolublement liés par un lien fondé sur une confiance réciproque, a mutual bound of trust dirait-on en anglais. Les droits et obligations de chacun ne pouvaient être modifiés qu’avec l’accord des deux parties ou par la mort de l’une d’entre elles, auquel cas la terre revenait en possession du seigneur qui l’avait concédée. Le titre foncier d’un vassal était conséquemment inaliénable, à moins qu’il ne reçoive la permission de son seigneur. Cela restera l'état du droit en Angleterre, au moins jusqu'à l'année 1217. Après, l'aliénation deviendra possible, à la condition que les droits du seigneur soient sauvegardés.
POLLOCK et MAITLAND, id., pp. 321 et 326-327.
Hommage féodal
Dation des mains, XIIIe siècle
Archives départementales de Perpignan

Par. 217 Quand un homme avait prêté serment devant plusieurs seigneurs, parce qu’il possédait plusieurs domaines à différents titres, il prêtait néanmoins un seul hommage lige. Le seigneur lige était celui de la terre où l’homme résidait. Il avait préséance sur les autres. Car on ne peut servir qu'un maître à la fois. Évidemment, quand un homme tenait une terre du roi, qu'il était l'un de ses barons, ou un évêque, le roi devenait de ce fait son seigneur lige. Et lui-seul avait le pouvoir de le juger.
Laws of King Henry I, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, préc. au par. 69, p. 494.
Par. 218 Parmi les aides dues au roi, certaines étaient exceptionnelles. Chaque tenancier en chef devait notamment contribuer au paiement de la rançon du roi lorsque son souverain était retenu prisonnier par une puissance étrangère. Le roi pouvait également exiger de ses tenanciers en chef une contribution pour financer une croisade en terre sainte, doter sa fille aînée lors de son mariage ou encore équiper son fils aîné lorsqu’il était fait chevalier.
POLLOCK et MAITLAND, préc. au par. 215, p. 267 (note infrapaginale 4) et pp. 349-350; LE GOFF, préc. au par. 212, p. 71. Lire également l'article 12 de la Magna Carta reproduit en annexe.
Par. 219 L’aide la plus importante était sans conteste l’aide militaire, au moins durant les deux premiers siècles suivant la conquête de 1066. Pour un tenancier en chef, elle consistait, outre sa présence dans l’armée du roi, à fournir les services d’un certain nombre de chevaliers dont le nombre variait selon l’importance de son fief. À l’appel du roi, ses barons et leurs chevaliers étaient tenus de servir dans l’ost royal pour une durée totale de 40 jours par an. Les chevaliers pouvaient aussi être mobilisés pour assurer la tenue en garnison au château du maître jusqu’à un mois durant.
LE GOFF, ibid.; POLLOCK et MAITLAND, id., p. 252-256; M. BLOCH, préc. au par. 209, pp. 310- 312.
Par. 220 Afin de fournir au roi le nombre de chevaliers prévus dans son contrat féodal, le tenancier en chef, baron, comte ou duc, pouvait soit payer directement ses guerriers, soit leur confier la possession d’une terre en fief, on disait alors les chaser, ce qui leur permettait de vivre avec leur famille et de s’équiper pour la guerre. Tout comme le roi s’était lié à ses tenanciers en chef par un engagement pris sous serment, le tenancier en chef se liait de même façon à ses propres vassaux. La terre concédée au chevalier était appelée une chevalerie ou un fief de chevalerie. Redonner ainsi la possession d’une partie d’une terre déjà reçue en fief s’appelait la sous-inféodation. En Angleterre, où cette sous-inféodation a débuté immédiatement après la conquête et les premières donations, une chevalerie devait rapporter un minimum de 20 livres de rente annuelle, somme à comparer aux revenus moyens de 100 et de 1000 livres, selon qu’on était un simple baron ou l’un des plus importants seigneurs du royaume.
BLOCH, id., p. 242; BARLOW, préc. au par. 185, p. 92.
Par. 221 Un autre service dû par le tenancier en chef à son roi, tout comme par le seigneur de rang inférieur envers son propre seigneur, était de lui rendre conseil. Chaque roi, duc, comte ou baron tenait un conseil pour administrer ses affaires et rendre justice à ses vassaux. Un roi pouvait même tenir plusieurs conseils plus ou moins élargis selon la nature et l'importance des questions à traiter. La participation au conseil, un devoir féodal, s'avérait parfois avantageux pour le vassal qui pouvait ainsi influencer la politique de son seigneur, voire s'attirer son patronage ou d'autres faveurs.
BLOCH, id., p. 312-313.
Par. 222 En France, les chevaliers devenaient les arrière-vassaux du roi, lorsque le tenancier en chef était un comte, ou encore les arrière-arrière-vassaux du roi, lorsque le tenancier en chef était un duc qui avait au-dessous de lui ses propres comtes. Le roi n’avait aucune prise sur eux, car aucun serment ne les liait. D’après le droit féodal, du moins tel qu’il se vivait sur le continent européen, un roi ne pouvait s’ingérer dans les relations entre ses tenanciers en chef et leurs vassaux. Son autorité réelle ne dépassait pas les limites de sa réserve et des comtés qu’il tenait directement. Les ducs et comtes français régissaient donc leurs terres avec une grande liberté, presqu'en souverains, en raison de cette barrière quasi infranchissable entre les différentes couches nobiliaires. La situation apparaissait cependant fort différente en Angleterre, comme nous le verrons bientôt.
BLOCH, préc. au par. 211, p. 547; Y. SASSIER, Royauté et idéologie au Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2002, p. 182.
Par. 223 Les paysans, la grande masse de la population en Angleterre, travaillaient la terre. On distinguait trois grandes catégories de paysans lors de l’enquête administrative de 1086, plus tard colligée dans le Domesday Book : environ 15% du total, des paysans libres, occupaient un lopin de terre contre le versement d’un loyer à un seigneur ; autour de 45% d’entre eux, des non libres, dont on disait qu’ils étaient les vilains (villeins en anglais), possédaient une terre en censive, le nom donné à la tenure roturière ; le reste, soit 40%, les plus pauvres d’entre les pauvres, appelés cotiers en ancien français (cottars ou bordars ou coscets en anglais), aussi des paysans non libres, possédaient peu ou pas de terre et travaillaient pour une pitance, juste le strict nécessaire à leur survie. Paysans libres, vilains et cotiers se séparaient en raison de leur statut de libre ou de non libre plutôt que par leur revenu.
R. BARTLETT, England Under the Norman and Angevin Kings, 1075-1225, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 316 et 317.
Par. 224 Le fief était la tenure du noble. Celle du simple paysan roturier et libre était donc la censive (customary tenure ou copyhold tenure en anglais). La censive se distinguait du fief sur presque tous les aspects. Régie par la coutume, elle ne procédait pas d’un engagement personnel. La terre d’un paysan lui venait en héritage de ses parents conformément à l’usage, en même temps que les servitudes économiques afférentes. Ces servitudes consistaient en des charges de travail appelées des corvées et en une redevance du nom de taille (tallage en anglais). Les corvées réclamées aux tenanciers consistaient habituellement à entretenir les routes et les bâtiments communs. Mais de nombreuses autres tâches pouvaient s’y ajouter, selon les besoins et l’imagination du seigneur. Quant à la taille, il s’agissait du loyer versé par le tenancier roturier à son seigneur. Son montant était habituellement fixé par la coutume.
BLOCH, préc. au par. 211, pp. 347-352. Et pour une description exhaustive des caractéristiques de la tenure du vilain comme de son évolution, lire POLLOCK et MAITLAND, préc. au par. 215, pp. 368-383.
Par. 225 Le roi ou ses hauts barons pouvaient enfin compter sur d'autres sources de revenu liées aux héritages et aux biens ecclésiastiques laissés sans titulaire pour les convertir en argent sonnant. Une courte présentation suffira pour l'expliquer.
Par. 226 Le roi, tout comme son baron, pouvait donc en principe récupérer son bien à la mort de son vassal pour se lier ensuite à un autre homme de son choix. Du moins c’était le cas au début du régime féodal. Mais rapidement cela ne pourra plus se faire aussi aisément, car l’aîné du défunt va s’interposer en affichant ses prétentions à l’héritage de son père. Une date charnière, en ce qui concerne la France, a été le 14 juin 877. L’empereur Charles II, dit le Chauve, qui souhaitait encourager ses vassaux à le suivre en Italie, ceci afin de protéger le pape Jean VIII menacé par des musulmans, a émis le Capitulaire de Quierzy-sur-Oise, une ordonnance impériale dans laquelle il autorisait le fils aîné de ses comtes à prendre la place de leur père décédé pendant l’expédition. Si l’ordonnance avait ainsi renforcé une pratique parmi la noblesse, ou plus précisément une volonté d’en créer une, elle ne l’avait pas encore transformé en un droit opposable au seigneur. Car tout au plus l’empereur avait-il suggéré qu’il s’agirait d’une possibilité. Il faudra attendre une centaine d’années et même davantage avant que cette possibilité ne devienne une réalité. Le droit d’hériter des honneurs (i.e. des fiefs) est devenue dès lors héréditaire en France.
BLOCH, préc. au par. 211, pp. 276-277; L. HALPHEN, « À propos du capitulaire de Quierzy-dur-Oise », (1911) Tome 106 Fasc. 2 Revue historique 286-294; É. BOURGEOIS, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877) : Étude sur l’État et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IXe siècle d’après la législation de Charles le Chauve, Paris, Librairie Hachette, 1885, p. 2.
Par. 227 Cette coutume dite de primogéniture s'étendra également à l'Angleterre. Il semble qu’elle commençait tout juste à apparaître sous Guillaume le Conquérant. On y ajoutera cependant la condition, lors du règne de son fils Guillaume le Roux (règne 1087-1100), que seul l’enfant légitime pouvait hériter, donc être né d’un homme et d’une femme unis par le mariage. Il est vrai que Guillaume entendait ainsi écarter toute prétention des fils bâtards de son frère Robert, le duc de Normandie. La coutume de primogéniture semblait enfin à peu près uniformément respectée à l'époque de Glanville, sous le règne d'Henri II, comme nous le verrons bientôt plus bas. En résumé, on a longtemps vécu dans l'incertitude la plus complète.
POLLOCK et MAITLAND, préc. au par. 215, vol. 2, 2e éd., 1898, p. 268; E.A. FREEMAN, The Reign of William Rufus and the Accession of Henry the First, vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1882, p. 280.
Par. 228 Cette condition a pu déplaire à quelques personnages haut placés. En effet, de manière à les empêcher que de puissantes familles ne réclament les fonctions d'archevêque, d'évêque ou d'abbé par droit d’hérédité, le clergé anglais, alors qu'il était réuni dans la cité de Westminster au cours de l'année 1102, a interdit aux prêtres de se marier. Et ceux qui l'étaient auparavant devaient même répudier leur épouse. Le clergé anglais n'innovait aucunement. Il ne faisait qu'adopter à son tour une réforme commencée des années auparavant en Allemagne (concile de Goslar de 1019), en Italie (concile de Pavie de 1022) et en France (concile de Bourges de 1031). La difficulté est que l'Église ne sanctionnait pas encore les fautifs. Mais cela changea à partir de 1059, quand le pape Nicolas II a annoncé qu'un prêtre prenant femme ne pourrait plus célébrer la messe en présence de fidèles. Grégoire VII, en 1074, tout en reprenant à son compte l'injonction de son prédécesseur, a ordonné l'excommunication des prêtres coupables. Enfin, les conciles œcuméniques du Latran, tenus respectivement en 1123 et 1139 dans la cité de Rome, ont également décrété l’invalidité du mariage des clercs. Ses enfants, lorsqu’il en avait, étant illégitimes en vertu du droit canon, plus aucun prélat ne pouvait désormais prétendre leur transmettre son titre et les terres qu’il avait reçues avec sa charge.
STEPHENS et HUNT, préc. au par. 63, p. 296-297; GOUGUENHEIM, préc. au par. 101, p. 195-198; 7e et 21e canons du premier concile du Latran et 6e canon du second concile du Latran, dans G. ALBERIGO (dir.), Les conciles œcuméniques, tome II (Les décrets), vol. 1 (de Nicée à Latran), Paris, Éditions du Cerf, 1994, p. 419, 425 et 435.
Par. 229 Un fils de la noblesse laïque ne réclamait l’héritage du père qu’après avoir respecté deux autres conditions. Il devait rendre l’hommage féodal au seigneur, comme son père l’avait fait avant lui, puis lui payer un droit, une sorte de taxe sur les successions du nom de relief. Le taux de la taxe est resté fluctuant pendant longtemps. Henri Ier (règne 1100-1135), tout comme le grand jurisconsulte du XIIe siècle Ranulf de Glanville, ont seulement mentionné que le taux devait être juste et raisonnable. Toutefois, Jean sans Terre, qui a abusé de cette taxe comme bien d’autres prélèvements prévus par le droit féodal, a été contraint par les Grands du royaume, lors de la signature de la Magna Carta, à fixer un taux de 100 livres pour une baronnie et de 100 shillings pour une chevalerie, ce qui correspondait en gros au quart d’une année de revenu.
FREEMAN, préc. au par. 227, pp. 289 et s.; The Coronation Charter of Henry I (5 August 1100), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, préc. au par. 69, p. 433; The exaction of reasonable aid, R. de GLANVILLE, The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England Called Glanvill, ou Traité des lois et coutumes du royaume d’Angleterre appelé Glanville, traité rédigé vers 1188, dans G.D.G. Hall (éd.), Oxford, Oxford University Press, 1965, pp. 111-112; C.H. CHAMBERS, A Treatise on Estates and Tenures, Londres, Butterworth and Son Imprimeurs, 1824, p. 189. Enfin, lire l’article 2 de la Magna Carta reproduite en annexe.
Par. 230 La coutume de primogéniture a pris naissance à la même époque en Angleterre comme sur le continent. En vertu de celle-ci, l’honneur, autrement dit le titre ancestral et le fief lui étant associé, revenait au fils ainé de la famille ou à défaut de fils à sa fille aînée. En l’absence d’un enfant, on cherchait un héritier parmi les plus proches parents : petit-fils et petite-fille, frère et sœur et leurs descendants, oncles et tantes et leurs descendants, toujours en donnant priorité aux sexe masculin sur le féminin.
GLANVILLE, id., p. 75, 76 et 79. Glanville est également l'autorité qu'il faut lire pour les paragraphes suivants.
Par. 231 L'autre source de revenu du seigneur liée aux héritages était la tutelle. Lorsque l’héritier de son vassal était un jeune homme de moins de quinze ans, un mineur à cette époque, le seigneur le mettait sous tutelle et administrait le fief à sa place ou encore nommait un baillistre (guardian en anglais). Pour se dédommager de sa peine, le seigneur conservait une part des profits de l’exploitation du domaine, jusqu’à la majorité du jeune homme.
POLLOCK et MAITLAND, vol. 1, préc. au par. 215, p. 321, vol. 2, préc. au par. 227, p. 37.
Par. 232 Si l’héritière était plutôt une jeune fille, son seigneur la donnait en mariage à un homme d’aussi haut rang. Un bon mariage, du point de vue du seigneur, permettait de créer des alliances ou de conserver les biens de l’héritage au sein de la parenté. Mais une veuve pouvait rester seule. Toutefois, si elle choisissait de se remarier, il lui fallait le consentement de son seigneur. Celui-ci veillait, bien entendu, à préserver ses intérêts avant d’accepter.
POLLOCK et MAITLAND, vol. 1, id., pp. 320.
Par. 233 Le roi ou son baillistre administrait également les biens d’un archevêché, d’un évêché ou d’une abbaye, après le décès de l’archevêque, de l’évêque ou de l’abbé, en conservant pour lui les profits du fief ecclésiastique tant qu’un remplaçant n’avait pas été nommé ou élu. Encore que l'Église lui ait parfois contesté ce droit. Jean sans Terre, ici encore, a abusé de sa prérogative en retardant indéfiniment l’arrivée de nouveaux prélats. Les grands du royaume l’ont alors obligé à plus de retenu lorsqu’ils ont inscrit le respect des droits de l'Église à l'article 1 de la Magna Carta.
5.2 Spécificité de la féodalité anglo-normande
Par. 234 Guillaume de Normandie s’est toujours présenté comme le successeur légitime d’Édouard le Confesseur et non comme le Conquérant, un surnom qu’il aurait détesté. Il n’était donc pas question de démanteler les institutions que son prédécesseur lui avait laissées, fut-ce dans les moments les plus difficiles, lorsque les révoltes des Anglo-Saxons ont menacé son pouvoir. Toutefois, Guillaume, en fin politique, a su réaliser la fusion de ces institutions avec les outils de la féodalité, ceux qu’il avait appris à maîtriser dans sa Normandie. Au Moyen-Âge, voire encore à l’époque de la Glorieuse Révolution de 1688, il fallait paraître ne rien changer même quand on voulait tout changer, d’où l’importance d’invoquer des précédents ainsi que leur ancienneté. Et Guillaume en avait sous la main en abondance ! Il pouvait effectivement puiser à la fois dans l’héritage des rois anglo-saxons et dans celui des ducs de Normandie. Guillaume a donc importé les coutumes normandes qui assuraient la pérennité de son gouvernement, tel le régime féodal de tenure des terres, tout en conservant les coutumes anglo-saxonnes qui le protègeront contre l’ambition de ses propres barons, même lorsqu’elles contredisaient le droit appliqué sur le continent, tel l’émission de brefs (writs en anglais), s’agissant d’ordres adressés sous son grand sceau à tous partout dans le royaume, et dotée d’une autorité absolue.
BLOCH, préc. au par. 211, pp. 593-595; BARLOW, préc. au par. 185, p. 91.
Par. 235 Il va sans dire que certaines initiatives de Guillaume ont pu déplaire aux uns ou aux autres. Mais les anciens seigneurs anglo-saxons n’avaient plus leur mot à dire dans la nouvelle Angleterre, surtout après les désordres de 1069-1070. Quant aux élites normandes et à leurs alliés du continent, leur survie en pays conquis exigeait la présence d’un chef rassembleur et charismatique. Et ils devaient tout au nouveau roi, tant leurs richesses que leurs titres. Comment auraient-ils pu s’opposer à lui lorsqu’il invoquait alternativement les lois de leur terre natale et celles de leur pays d’adoption ?
Note: Aux articles I et VI de la Déclaration des droits de 1689, reproduite en annexe, le Parlement insistera toujours sur l’ancienneté des droits et libertés énoncés qu’il demandait aux nouveaux souverains Guillaume et Marie de reconnaître, comme si on ne faisait que revenir à ce qui existait avant, à un passé que la Déclaration avait idéalisé, sinon inventé.
Par. 236 Rappelons la tenue de l’assemblée du 1er août 1086 à Old Sarum, près de Salisbury, où Guillaume a exigé de tous ceux qui possédaient des terres, non seulement ses tenanciers en chef, mais également ses arrière-vassaux et leurs propres tenanciers, de lui prêter un serment de fidélité.
« [Traduction] Nous décrétons que chaque homme libre doive déclarer sous serment et s'engager à être loyal envers le roi Guillaume à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, qu'il défendra ses terres et son honneur fidèlement et le défendra contre tous ses ennemis. »
Voir supra le par. 195.
Old Sarum, lieu du serment général porté au roi Guillaume en 1086
Site Web du comté de Wiltshire

Par. 237 Guillaume ne faisait que suivre le précédent créé par le roi Edmond l’Ancien en 939. Il se fondait également sur l’ancienne coutume carolingienne du serment général, qui aurait été adoptée par les Vikings au moment de leur installation en Neustrie, puis réintroduite par Guillaume quelques années avant son aventure anglaise.
Laws of Edmund, ROBERTSON, préc. au par. 181, p. 12 et 13. La tradition du serment général chez les rois et empereurs francs a été minutieusement documentée par M.C.P. ROBERT de LÉZARDIÈRE, dans Théorie des lois politiques de la monarchie française, tome 1, Paris, Chez MM. Videcoq, libraires, 1844, p. 106-107 et 469-486.
Par. 238 Pourtant, Guillaume se plaçait ainsi en dehors de l’ordre féodal habituel. En effet, l’hommage exigée, dit un hommage lige, l’attachait à tous les hommes libres du royaume par une fidélité au-dessus des autres. Le roi devenait ainsi leur seigneur direct. C’était tout à fait inhabituel. Normalement, dans les pays voisins, un arrière-vassal n’encourait aucun devoir envers d’autre personne que son seigneur direct.
BATES, préc. au par. 163, p. 567; BARLOW, préc. au par. 185, p. 88
Par. 239 Comme être le seigneur lige d’une personne comportait la prérogative ou le devoir de lui rendre justice, Guillaume pouvait dès lors trancher tous les litiges dont il souhaitait prendre connaissance, même s’il passait par-dessus l’autorité d’un baron pour juger les droits et obligations d’un chevalier, voire d’un simple paysan libre. Comme expliqué plus haut, au paragraphe 220, cela aurait été impensable en France où un tenancier en chef, qu’il ait été duc ou comte, régissait ses propres vassaux librement, sans avoir à subir d’ingérence de la part du roi. La féodalité, telle qu’elle se vivait traditionnellement, ignorait effectivement l’application centralisée du droit.
Par. 240 Il est vrai que Guillaume n’a pas abusé de sa prérogative, car son intention, en exigeant ce serment général de tous les hommes libres, était avant tout de se protéger contre d’éventuelles rébellions, toujours à craindre lorsqu’il s’absentait de son île pour se rendre en Normandie. Aucun autre effet légal du serment n’était alors recherché. Toutefois, ses successeurs en feront amplement usage pour étendre leur justice. Des cours royales créées aux VIIe et XIIIe siècles pourront ainsi élaborer un droit commun applicable à tous leurs sujets sur tout le territoire de l’Angleterre : la future common law. La France devra quant à elle attendre 1804 avant de connaître l’unification de son droit, lorsque le Code civil rédigé sous le régime du premier consul Napoléon Bonaparte entrera en vigueur. Nous y reviendrons.
BATES, id., p. 569.
Par. 241 Ce serment direct liant Guillaume le Conquérant à tous ceux qui possédaient des terres a donc empêché l’érection d’une barrière entre le roi et ses sujets. Sa capacité d’imposer un impôt foncier universel en a confirmé l’absence.
Par. 242 En effet, un autre aspect du régime anglo-normand, qui était également un anathème en féodalité continentale à la même époque, a été le pouvoir du roi Guillaume de prélever l’impôt foncier du heregeld sur tous ses sujets, suivant en cela l’exemple des rois anglo-saxons depuis Ethelred le Malavisé en 991. Le heregeld, on disait aussi plus simplement le geld, s’ajoutait à tous les autres droits, impôts et taxes combinés de l’ancien régime anglo-saxon et du régime féodal normand. Soit le meilleur des deux mondes, du point de vue de Guillaume. Alors qu’un roi, comme le souverain capétien en France, finançait essentiellement ses activités avec les revenus provenant de sa réserve et des terres comtales qu’il tenait directement. Les droits féodaux et redevances seigneuriales reçus de ses vassaux en application stricte du contrat féodal ne représentaient alors qu’une faible part de ses revenus. Malheureusement pour le Français, il ne pouvait certainement pas aller piger dans les goussets de ses arrière-vassaux et de leurs paysans en passant par-dessus l’autorité de ses tenanciers en chef pour renflouer son trésor, du moins pas avant la fin du XIIIesiècle et le règne de Philippe le Bel (1285-1314). La seule exception, prévue par le droit féodal, était la levée d’une contribution exceptionnelle afin de financer une croisade.
Voir supra les pars. 52, 82, 103, 109, 124, 143, 192 et 203. Lire également C. LOUANDRE, « Les budgets de l’ancienne France », (1874) 2 Revue des Deux Mondes 403, pp. 407-412, et plus récemment A. RIGAUDIÈRE, « L’essor de la fiscalité royale, du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe V (1328-1350) », dans A. RIGAUDIÈRE (éd.), Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Institut de la gestion publique et du développement économique, 2003, pp. 523-589.
Par. 243 Compte tenu de l’étendue de ses terres, dont la superficie avait plus que doublé après sa conquête de 1066, Guillaume de Normandie se trouvait être le souverain le plus riche d’Occident. Son pouvoir s’était accru dans les mêmes proportions. Il pouvait lever une armée imposante et acheter de nombreuses loyautés. On cherchait son amitié tout comme on craignait sa colère. Comparé à lui et à ses fils, les premiers rois français capétiens semblaient bien impuissants, presque des eunuques couronnés.
Par. 244 Certes, Guillaume a conservé la maîtrise de son royaume grâce à sa fortune et à son armée, mais également en raison de l’éclatement des possessions de ses hauts barons. C’était voulu ! Car tout comme en Normandie, leurs terres étaient disséminées un peu partout dans l’île, isolées les unes des autres. Aucun tenancier en chef ne s’est vu confié par Guillaume un vaste territoire contigu, autrement dit une large enclave le séparant des propriétés de ses voisins, où il aurait joui d’un pouvoir quasi souverain capable de marginaliser l’autorité de son roi, comme on le voyait en France.
STENTON, préc. au par. 37, p. 627-629; BARLOW, préc. au par. 185, pp. 88-90.
Par. 245 Mais alors, qu’est-ce qui a empêché Guillaume et sa descendance de régner en despotes ? Y a-t-il eu des freins pour les empêcher d’exercer une domination complète ?
Par. 246 Une monarchie féodale, dans sa version continentale ou même spécifiquement normande, n’a jamais été considérée comme le lieu d’un pouvoir absolu. Un roi ou quelque autre grand seigneur a toujours été lié à ses vassaux par les droits et les obligations que lui imposait son contrat féodal, tel que codifié par les coutumes. Aucune partie ne pouvait le violer impunément peu importe les autres circonstances. Bien sûr, Guillaume a apporté d’importants changements à l’ordre féodal de sa Normandie après l’avoir introduit en Angleterre, mais il a toujours agi en s’appuyant sur des précédents anglo-saxons, ce que les mentalités du temps étaient prêtes à accepter.
Par. 247 Il existait par ailleurs une coutume anglo-saxonne limitant les prérogatives du monarque. En effet, comme condition de son élévation à la magistrature suprême, cette coutume obligeait le roi à promulguer une charte des droits et libertés de ses sujets, dont chaque clause modérait l’exercice de son autorité. Si les obligations imposées par cette charte étaient à l’origine fort vagues et donc peu contraignantes, les rois normands Henri Ier (règne 1100-1135) et Étienne (règne 1135-1154), pour se faire accepter comme rois, ont reconnu à leurs sujets des droits et libertés beaucoup plus conséquents. Ils avouèrent même devoir leur Couronne à l’accord des prélats et hauts barons du royaume, un rappel de l’élection par le Witan, une coutume pourtant tombée en désuétude depuis l’avènement de Guillaume le Conquérant. Un tel aveu présentait cependant un danger pour eux, puisque le soutien de l’aristocratie pouvait tout autant leur être retiré et provoquer du coup leur déchéance. Henri II, premier roi de la maison de Plantagenêt (règne 1154-1189), ne s’y est pas trompé; il a retranché cette partie avant de prononcer son serment de couronnement.
Henry I’s Coronation Charter, E.H.D., vol. 1 (), éd. , préc. au par. 69, pp. 432-433; Charter of Stephen addressed generally (1136), id., p. 435; Charter of Henry II addressed generally (1154), id., pp. 439-440.
Charte de couronnement de Henri Ier
Reproduite dans un livre du XIIIe siècle rédigé pour le prieuré de la cathédrale de Cantorbéry

Par. 248 Enfin, leur situation de minoritaires a obligé les Normands et leurs alliés français à rester étroitement unis les uns aux autres par instinct de conservation, d’où la généralisation de la tenure féodale et l’établissement d’une nouvelle aristocratie qui excluait presque tous les Anglo-Saxons. Un roi, fut-il aussi puissant que le Conquérant, ne pouvait donc se l’aliéner en violant les droits qu’il lui avait concédés. Rappelons que le système féodal était principalement une organisation de défense mutuelle, ici mise en place pour se protéger contre la menace intérieure anglo-saxonne. Or, les Normands et leurs amis comptaient entre 10 000 et 12 000 personnes, peut-être 20 000 à la fin du règne de Guillaume Ier, dont environ 5 000 chevaliers équipés. C’était vraiment peu pour contrôler tout un pays. L’union et le maintien de leurs forces devenaient alors une condition de leur survie. Tant le roi que ses barons l’avaient bien compris.
STENTON, préc. au par. 37, pp. 631 et 634.
Par. 249 Et pourtant, le danger aurait été vite oublié par certains nobles, puisqu'il s’est trouvé des fils de la première génération de l’aristocratie qui se sont révoltés contre Guillaume. En effet, deux d’entre eux, Raoul, comte d’Est-Anglie depuis la mort de son père en 1068, et Roger, comte d’Hereford après le décès du sien en 1071, rejoint par Waltheof, le dernier earl anglo-saxon devenu seigneur de Northumbrie après 1072, ont pris les armes en 1075. D’où l’expression retenu par les historiens pour décrire l’évènement comme étant la Révolte des trois comtes. Leur grief, à en croire les dires du comte Roger, portait sur les ingérences des shérifs du roi sur leurs terres. Raoul, apparemment, se serait aussi senti méprisé par les actions de la Couronne. Guillaume les a rapidement défaits, puis punis sévèrement, comme il se doit lorsqu’on connaît le caractère du roi : Raoul a été privé de ses terres et exilé; Roger a passé le reste de sa vie en prison; et Waltheof a été exécuté.
BATES, préc. au par. 163, pp. 453-459.
Par. 250 La royauté anglaise était et est demeurée une monarchie constitutionnelle, en ce sens que les pouvoirs du monarque ont toujours été limités par une Constitution. Autrefois fondée sur les coutumes et la charte de couronnement, la Constitution a été remodelée depuis lors par les jugements des cours de common law, par quelques textes de lois fondamentaux, et par plusieurs conventions de nature politique. Cette apparente continuité cache cependant une importante différence entre l’ancienne Constitution et celle vigueur aujourd’hui. De fait, avant l’apparition de tribunaux indépendants de la Couronne et d’un gouvernement responsable devant les élus des communes, on ne pouvait évoquer l’existence d’un principe de primauté de la Constitution, non seulement parce que l’objectivité des juges chargés de son application n'était pas garantie, mais aussi parce que l’exécution de leurs jugements dépendait du bon vouloir du prince. Seuls les principaux acteurs politiques regroupés au sein de la haute noblesse au début, à laquelle se sont joints ensuite les membres de la petite noblesse et de la bourgeoisie, ont su obliger le roi à respecter la Constitution, soit par la force ou encore par des menaces d’employer la force. Ils vivaient dans un monde hobbesien, précurseur du positivisme juridique, où la capacité d’imposer sa volonté comptait souvent plus que tout le reste, y compris le droit existant. Invoquer l’existence d’une Constitution ou simplement du droit dans ces temps anciens où l’épée permettait de trancher les litiges n’était souvent qu’un argument dans un plus large débat pour légitimer l’emploi de la force.
Note: Dans Le Citoyen ou les fondements de la politique, Londres, 1642, traduit par S. Sorbière, Paris, Flammarion, 1982, p. 100, Thomas HOBBES a écrit qu’en « l’état naturel des hommes, une puissance assurée, et qui ne souffre point de résistance, confère le droit de régner et de commander à ceux qui ne peuvent résister : de sorte que la toute-puissance possède essentiellement et immédiatement le droit de faire tout ce que bon lui semble. »
Par. 251 Quelques rois d’Angleterre ont invoqué l’onction royale qui faisait d’eux des élus de Dieu pour se prétendre omnipotents, sinon dans les faits, du moins en droit. Toutefois, contrairement à ces rois à la mémoire défaillante, leurs sujets n’ont jamais oublié que leurs pouvoirs étaient d’origine terrestre et donc forcément limités. C’est pour l’avoir oublié qu’Édouard II (règne 1307-1327), Richard II (règne 1377-1399) et Charles Ier (règne 1625-1649) ont payé de leur vie. Quoique les rois de la maison de Normandie, les Guillaume Ier le Conquérant (règne 1066-1087), Guillaume II le Roux (règne 1087-1100) et Henri Ier Beauclerc (règne 1100-1135), aient fréquemment rappelé l’autorité que leur conférait leur position, ils ont démontré leur sagesse en conduisant les affaires du pays avec l’aide des hauts barons et prélats du royaume, exactement comme les rois anglo-saxons lorsqu’ils avaient gouverné en consultation avec leur Witan.
Par. 252 Voulues ou non dans tous leurs effets, les coutumes maintenues par Guillaume le Conquérant et les réformes qu’il a introduites ont posé les fondements de la monarchie anglaise pour les mille ans à venir.
6. Constitution anglo-normande
6.1 Institutions centrales : pouvoirs, revenus, cour du roi, administration et développement de la justice royale
Par. 253 Les règles de succession dans l’Angleterre normande ne différaient pas fondamentalement de celles de la période précédente. Il semble que la préférence allait encore au fils aîné du roi défunt, à moins que ce dernier n’ait désigné un autre membre de sa famille pour lui succéder. C’est précisément ce qui est arrivé lorsque le Conquérant a choisi son second fils, Guillaume le Roux, le futur Guillaume II, de préférence à l’aîné Robert qui s’était rebellé contre son père. Encore ce choix devait-il faire consensus parmi la noblesse. Cela étant, il a quand même laissé la Normandie à Robert. D’aucuns ont prétendu que le père n’a pas eu vraiment le choix car, d’après la coutume normande, où l’on différenciait entre les propres et les acquêts, l’héritage familial (i.e. la Normandie) devait revenir à l’aîné. Mais rien n’est moins sûr. Il semble la volonté du Conquérant ait été l'unique facteur considéré. Quant au troisième fils, Henri, il a dû se contenter de quelques domaines et de sommes d’argent.
J. Le PATOUREL, « The Norman Succession, 996-1135 », (1971) vol. 86 English Historical Review 225, p. 225-232.
Par. 254 On ne parlait plus d’élection du roi depuis le couronnement de Guillaume Ier en 1066. Toutefois, les plus puissants tenanciers en chef, qui se voyaient comme les héritiers du Witan, autrement dit les rares earls restants, les hauts barons, les archevêques, les évêques et les abbés, ont néanmoins continué d’influencer le choix de son successeur. Voilà pourquoi Henri Ier et son neveu Étienne de Blois, en 1100 et en 1135, sensibles au poids de ces grands, ont reconnu que leur élévation à la magistrature suprême avait été rendue possible grâce à leur consentement. Car c’est avec leur appui qu’Henri a su écarter son aîné Robert parti en Terre Sainte pour la croisade, et qu’Étienne l’a emporté sur sa tante Mathilde, la dernière enfant légitime d’Henri Ier que ce dernier avait pourtant désignée pour lui succéder. Désignation par le père et élection par le Witan ou son pendant normand ne suffisaient donc pas; lorsque plus d’un prétendant sérieux se présentait, la guerre devenait inévitable. Henri et Robert se sont disputé l’héritage de Guillaume II, puis Étienne de Blois et Geoffroy Plantagenêt celui d’Henri Ier.
PATOUREL, id., p. 242-250.
Pouvoirs de la Couronne
Par. 255 Le roi normand était un véritable souverain, seigneur de tous les hommes libres sur toutes les terres de son royaume, à l’exception possible des clercs qui relevaient de la juridiction des tribunaux ecclésiastiques et restaient soumis au droit canon. Il exerçait tous les pouvoirs de puissance publique : les droits de légiférer, d’appliquer les lois et de juger. Cela étant, l’autorité du roi n’était pas absolue, comme nous venons de le mentionner aux paragraphes 246 à 250. Une Constitution, aux contours informes mais omniprésente, l’empêchait d’abuser de ses pouvoirs. On en trouvait les règles dans la charte des droits et libertés consentie par le roi à ses sujets lors de son couronnement, dans le contrat féodal l’unissant à ses tenanciers en chef, tout comme dans les diverses autres coutumes portant sur l’exercice de ses prérogatives.
Note : Un bref (ordre écrit) émis par Guillaume le Conquérant, probablement en avril 1072, a retiré aux tribunaux des shires leur juridiction sur les affaires religieuses au profit des tribunaux ecclésiastiques : Writ of William I concerning spiritual and temporal courts, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 647-648.
Par. 256 Le respect de la charte de couronnement comme celui du contrat féodal étaient garantis par un serment promissoire. Or, le roi commettait un parjure s’il violait son serment. En cas de refus du roi de s’amender, ses vassaux acquéraient le droit de se révolter en s’attaquant à ses biens, à ses serviteurs et à son armée. Il semble, toutefois, que les rebelles n’aient pas eu le droit de s’en prendre physiquement au roi ou aux membres de sa famille. C’est du moins ainsi que le droit féodal sera codifié à l’article 61 de la Magna Carta de 1215.
Voir également supra au par. 100.
Par. 257 Les rois de la maison de Normandie devaient gouverner à la fois leur royaume d’Angleterre et leur duché de Normandie. Il s’est donc avéré commode de nommer une personne pour les remplacer durant leur absence, soit du royaume, soit du duché. En Angleterre, ce représentant a porté différents titres : on l’a nommé indifféremment régent, tuteur, vice-roi, ou maître-suppléant. Celui finalement retenu, sous le règne d'Henri IerBeauclerc (1100-1135), a été le titre de justicier, puis de grand justicier d’Angleterre (Justiciar et Chief justiciar en anglais). Guillaume II le Roux a été le premier à se nommer un remplaçant. Il y a eu Guillaume de Durham, puis Walkelin de Winchester et enfin Rainulf Flambard. Henri Ier, dès son arrivée sur le trône en 1100, a emprisonné Flambard à la Tour de Londres, pour le remplacer par Roger de Salisbury. Salisbury, d’abord chancelier, poste dont il démissionnera peu après, avant de revenir au gouvernement assez rapidement, sera nommé grand justicier et régent du royaume à partir des années 1120s. Nous reparlerons de ce ministre dont la contribution a été fort importante. Pour ce qui est de Guillaume le Conquérant, plus prudent ou plus méfiant que ses enfants, il avait préféré ne pas confier d’aussi grands pouvoirs à un seul homme. Ce sont deux proches qui l’ont remplacé temporairement lors de ses absences de l’Angleterre, son ami d’enfance Guillaume fils Osbern, comte de Hereford, et son demi-frère, l’évêque Odon ou Odo de Conteville ou de Bayeux. Notons, pour l’anecdote, qu’Odon a été le commanditaire de la célèbre tapisserie aujourd’hui exposé au musée de Bayeux.
BARLOW, préc. au par. 185, pp. 121 et 122; BATES, préc. au par. 163, pp. 340, 341, 346 et 483-489.
Tapisserie de Bayeux
Les trois personnages représentés, de gauche à droite, sont l'évêque Odon, le roi Guillaume et son fils Robert

Par. 258 Le roi normand, comme ses prédécesseurs anglo-saxons, a peu légiféré. L’Angleterre étant toujours un pays de coutumes, les mentalités du temps ne prédisposaient pas à l’activisme législatif. Tant le Conquérant que ses successeurs immédiats ont donc maintenu les lois d’Édouard le Confesseur, avec les quelques réformes qu’ils ont cru nécessaire d’y apporter, les plus importantes ayant été la généralisation des tenures féodales et l’introduction du droit des forêts royales.
Voir supra au par. 185.
Par. 259 D’après le vocabulaire en usage, leurs lois écrites prenaient la forme d’une charte, d’une assise ou de constitutions. Une charte était une ordonnance royale. Elle reconnaissait le titre de propriété ou les droits d’une personne ou de toute une communauté. Elle pouvait donc aussi servir à des fins de législation. Dans la forme, une charte consistait en un acte unilatéral du roi, qu’un ou plusieurs témoins authentifiaient en y apposant leur marque ou leur signature. Les chartes de couronnement et la Magna Carta de 1215 sont les exemples que nous avons déjà évoqués aux paragraphes 122 et 247. L’assise était également une ordonnance royale, mais promulguée à l’occasion d’une réunion solennelle des prélats et hauts barons réunis au sein de la Cour du roi, l’organisme successeur du Witan anglo-saxon. Les personnes présentes ne prenaient pas nécessairement une part active à l’élaboration du texte ni ne l’approuvaient formellement, mais elles étaient toujours consultées. On adoptait une assise pour des réformes législatives d’importance, lorsque la présence de plusieurs magnats semblait politiquement opportune. Henri II Plantagenêt (règne 1154-1189), qui fut certainement le premier roi d’Angleterre à se présenter en véritable législateur, a compté parmi ses réalisations l’Assise de Clarendon de 1166, traitant des tribunaux de droit commun, et l’Assise de Northampton de 1176, sur les droits de propriété. Et quand l’ordonnance du roi était promulguée lors d’un synode de ses évêques, on préférait cette fois l’emploi du terme constitutions au pluriel pour la désigner. Il y a eu notamment les Constitutions de Clarendon de 1164, par lesquelles Henri II entendait redéfinir l’étendue des juridictions respectives des tribunaux civils et ecclésiastiques en Angleterre. Celles-ci ont d’ailleurs provoqué un conflit majeur entre le roi et l’archevêque de Cantorbéry. Nous reparlerons plus loin de toutes ces lois dans les chapitres consacrés au rois angevins.
Assise de Clarendon de 1166, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 440-443; Assise de Northampton de 1176. E.H.D., id., pp. 444-445; Constitutions de Clarendon de 1164, E.H.D., id., pp. 766-770.
Par. 260 L’application des lois, jusqu’à la fin du règne de Guillaume II, dit le Roux, en 1100, concernait pour l’essentiel la levée et le commandement du fyrd anglo-saxon ou de l’ost féodal normand, ainsi que la perception de tous les impôts, taxes et redevances dues à la Couronne. Elle visait également le respect de la paix du roi. Cette paix demeurait cependant de portée limitée, car elle dépendait de la capacité du roi d’en assurer le respect. Ses moyens n’étant pas considérables, la paix du roi était encore réservée à des privilégiés, parmi lesquels se trouvaient les serviteurs de la Couronne, les Normands et autres Français, les voyageurs circulant sur les routes royales, et toutes les autres personnes auxquelles le roi avait expressément étendu sa protection. Dans sa charte de couronnement, datant de la même année 1100, Henri Ier a cependant décidé d’ajouter au poids de ses responsabilités, en matière d’application des lois pénales, lorsqu’il s’est engagé à faire respecter la paix du roi dans tout le royaume. Ses paroles ont été : « [Traduction] J’impose une stricte paix dans tout mon royaume et j’ordonne qu’elle soit désormais maintenue. »
Paragraphe 12 de Henry I’s Coronation Charter, E.H.D., id., p. 432-433.
Intronisation d’Henri Ier
Le roi tient dans sa main droite une abbaye et dans la gauche sa charte de couronnement
Historia Anglorum, de Matthieu Paris, XIIIe siècle, livre conservé à la The British Library (Royal 14 C VII).

Par. 261 En promettant sa paix à toute l'Angleterre dans l'acte qui a marqué le début de son règne, le roi Henri a voulu poser le fondement d'un véritable droit pénal national. L'une des mesures prises pour l'observer a été d'envoyer en mission des juges parcourir les shires (comtés), les hundreds (centaines) et les villes selon des itinéraires prédéterminés (circuits en anglais), avec pour tâche d'entendre et de juger les plaids de la Couronne. D’où le nom donné à ces serviteurs du roi de juges itinérants (itinerant justices). On y fait allusion dans l’Assise de Clarendon de 1166, précitée au paragraphe 259, où l’on peut lire : « [Traduction] En premier lieu le roi Henri, afin de préserver la paix, et le respect de la justice, a décrété la tenue d’enquêtes (par ses juges) dans tous les comtés et dans toutes les centaines, assistés par 12 hommes les plus respectueux des lois de la centaine ou par 4 de la ville visitée, qui tous jugeront de dire la vérité, dès qu’il se trouvera un homme de la centaine ou de la ville accusé ou sérieusement suspecté d’avoir commis un vol ou un meurtre, ou qui aurait offert l'asile à un voleur ou à un meurtrier, depuis que le roi est devenu roi. »
Par. 262 Un roi ne pouvait se rendre maître d’un royaume et y conserver sa mainmise sans s’assurer du contrôle des ouvrages fortifiés. Il fallait bien un cantonnement abritant ses garnisons, tant pour faire barrage à une invasion que pour se protéger de citoyens déloyaux. Guillaume le Conquérant a donc introduit en Angleterre la coutume normande interdisant à quiconque de construire un château ou d’en avoir la garde à moins d’obtenir au préalable son autorisation. Et si un tel château était néanmoins édifié, il pouvait être saisi sans autre formalité, soit en Angleterre, soit en Normandie, selon le cas.
Record of an Inquest taken by Robert Duke of Normandy and William II King of England, at Caen, through their bishops and barons, 18 juillet 1091, DAVIS, préc. au par. 179, document 316, p. 82; Leges Henrici Primi, 1114-1118, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 491-495.
Par. 263 Commençons par décrire ce que l’on entendait par un ouvrage fortifié, aussi appelé un château dans les archives de l’époque. Au tout début de la période normande, il s’agissait pour l’essentiel de constructions en bois assises sur une butte de terre, avec palissades et fossés. Guillaume en aurait tapissé l’Angleterre, a écrit son archevêque Guillaume de Poitiers, quoique plusieurs ont été abandonnés par la suite en raison du coût élevé de leur entretien. Il en aurait resté entre 50 et 70 au moment du Domesday Book. Et seules quelques rares forteresses avaient été rebâties en pierres avant 1087, mais vraiment très peu, peut-être seulement deux, d’ailleurs construites par le Conquérant : la Tour de Londres et Colchester. Henri Beauclerc a continué la politique de son père Guillaume. Par contre, son petit-fils Étienne de Blois (règne 1135-1154), réputé être un roi faible, a négligé de faire respecter ses droits. Il a conséquemment perdu la maîtrise du réseau de châteaux en même temps que celle du pays. Le Plantagenêt Henri II (règne 1154-1189) n’a pas commis la même erreur. Ce roi, qui avait compris que la reprise en main de son royaume passait par celle des forteresses, s’est montré intransigeant envers tous ceux qui violaient sa prérogative.
BATES, préc. au par. 163, pp. 359-362; GUILLAUME de POITIERS, préc. au par. 47, pp. 237 et 287-288; E.S. ARMITAGE, « The Early Norman Castles of England (Continued) », (1904) Vol. 19 The English Historical Review 417-455; J.H. BEELER, « Castles and Strategy in Norman and Early Angevin England », (1956) vol. 31 Speculum 581-601; F. M. STENTON, The first century of English feudalism, 1066-1166, Oxford, Clarendon Press, 1932, pp. 192-215.
Par. 264 La nomination des prélats, archevêques, évêques et abbés, étaient une autre prérogative des rois d’Angleterre. Guillaume Ier et Guillaume II procédaient à leur investiture, s’agissant de la cérémonie au cours de laquelle le prélat recevait les objets symboliques représentant sa fonction, en même temps que le domaine lui étant associé, des mains du prince qui l’avait nommé. Cette prérogative a cependant été contestée par les papes. Animé par le désir de réformer l’Église, Grégoire VII (pontificat 1073-1085) a entrepris de purifier la moralité et la spiritualité de ses serviteurs. Il en a conclu que le pouvoir séculier ne pouvait nommer les représentants du clergé. C’est ce que les historiens ont appelé la querelle des investitures. Commencée sous ce pape, elle s’est poursuivie jusqu’au pontificat de Pascal II (1099-1118). Henri Ier d’Angleterre, dit Beauclerc, troisième fils du Conquérant et second à régner après lui, a alors accepté un compromis permettant de distinguer entre la mission spirituelle du prélat et sa fonction temporelle de seigneur féodal.
Par. 265 D’après les termes de ce compromis, négocié en 1117, l’Église s’est vu reconnaître le droit d’élire les évêques et de procéder à la cérémonie de l’investiture ecclésiastique par la remise de la crosse et de l’anneau, mais le roi a conservé celui de leur octroyer leur évêché et ses revenus afférents au moyen de l’investiture civile par la remise du sceptre. La concession d’Henri Ier, plus apparente que réelle, ne l’a pas empêché de continuer à nommer les évêques, ou tout au moins à exercer un droit de veto sur leur nomination. En effet, qui aurait accepté de se faire coiffer de la mitre, en sachant que le roi vous refuserait la possession de l’évêché ? Il suffisait au roi de faire connaître l’identité de son candidat. Lorsque celui-ci était acceptable aux yeux de l’Église, les électeurs composant le collège électoral du clergé se contentaient de ratifier son choix. Une négociation s’ensuivait en cas de désaccord (les représentants du clergé avaient intérêt à s’entendre rapidement car, en vertu des coutumes, le roi conservait les revenus de l’évêché vacant). Un roi anglais pouvait ainsi consolider son pouvoir en choisissant des hommes de confiance pour occuper les principales charges ecclésiastiques.
Note: En effet, à cette époque, tout archevêque, évêque et abbé devait, en vertu du droit canon, être élu, soit par le haut clergé, par le clergé ou par les fidèles. Cette règle a été notamment énoncée dans le premier canon du concile tenu à Reims par le pape Léon IX en 1049 : « Que nul n’arrive aux charges ecclésiastiques sans l’élection du clergé et du peuple ». M. l’abbé DELARC, Un pape alsacien, essai historique sur saint Léon IX et son temps, Paris, E. Plon et Cie Imprimeur, 1876, p. 212. Sur la querelle des investitures et le compromis arrêté, lire GOUGUENHEIM, préc. au par. 101, pp. 126-127.
Par. 266 Henri II fera cependant l’erreur, en 1162, de désigner Thomas Becket comme son candidat au poste d’archevêque de Cantorbéry et primat de l’Église d’Angleterre, ce qui donnera lieu à une autre querelle restée célèbre dans les annales de l’histoire du royaume. Nous en reparlerons.
Par. 267 Un roi féodal, comme le roi de France, rendait justice en personne au milieu de sa cour composée de ses plus importants vassaux, les pairs du royaume, normalement au nombre de douze : six pairs laïcs et six pairs ecclésiastiques. Les affaires judiciaires l’occupaient peu. Il se contentait de trancher les litiges impliquant ses proches, soit les membres de son palais et ses tenanciers en chef, souvent les mêmes personnes qui l’aidaient à gouverner. Les coutumes lui interdisaient de passer par-dessus l’autorité de ses tenanciers en chef pour rendre justice à leurs vassaux.
Voir supra aux pars. 220 et 239.
Par. 268 C’était différent en Angleterre, car la justice du roi pouvait s’étendre à tous les hommes de son royaume. Il lui suffisait de faire jouer un mécanisme permettant de l’institutionnaliser. Ce mécanisme a été la délégation. Nous avons vu que, dès le règne de Guillaume II le Roux (1087-1100), celui-ci avait délégué ses pouvoirs à un représentant qui les a exercés en son absence, un homme plus tard appelé un justicier ou un grand justicier. Il y avait même eu des précédents sous le règne de son père, notamment cette fois où, en 1072, le Conquérant avait délégué son autorité judiciaire à l’évêque Geoffroy de Coutances, l’un de ses plus proches conseillers et aussi l’un des dix barons les plus riches d’Angleterre. Son activité principale auprès du roi était le règlement de litiges fonciers.
R.C. van CAENEGEM (éd.), English Lawsuits from William I to Richard I, vol. 1 (William I to Stephen), Londres, Selden Society, 1990, Regesta no 69, p. 7-11 et 14-15.
Par. 269 Le principe de la délégation étant admis, Henri Ier Beauclerc (1100-135) a délégué à son tour son droit de rendre justice à plusieurs officiers, d’autres justiciers de rang inférieur. Avant ce roi, le pouvoir du roi normand de rendre justice partout et à tous n’était qu’une idée, une simple potentialité, en raison du peu de temps dont disposait la Cour du roi. Celle-ci ne siégeait en tribunal que pour les grands personnages et les grandes causes. Tout a changé à partir du moment où le roi a délégué son pouvoir à un grand nombre de juges. La justice du roi a pu alors s’imposer. Elle finira par éclipser toutes les autres, notamment les justices rendues par les seigneurs pour leurs propres gens. Avantage non négligeable, comme la justice à cette époque était une activité rentable, elle procurera au roi des revenus additionnels qui alimenteront son trésor.
Laws of King Henry I (1100-1135), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 57 et 491-495.
Revenus de la Couronne
Par. 270 Les revenus du roi normand dépassait ceux de son prédécesseur anglo-saxon. Outre les recettes habituelles de l’ancien régime comme l’administration de la justice, la frappe de la monnaie et le prélèvement du heregeld, se sont ajoutés les droits et les redevances découlant des coutumes féodales normandes, en plus des nouveaux impôts et taxes introduits par Guillaume le Conquérant. Il n’est donc pas surprenant que celui-ci ait vite acquis la réputation d’un seigneur âpre au gain. Un chroniqueur de l’époque a écrit à propos du roi comme de ses hauts barons : « [Traduction] Le roi et les hommes les plus importants aimaient beaucoup, et même beaucoup trop, l’or et l’argent, sans se préoccuper des procédés scandaleux choisis pour se les procurer, pourvu qu’ils les obtiennent. »
CHRONIQUES, préc. au par. 33, année 1086, p. 141.
Par. 271 L’exploitation de la réserve du Conquérant, ces terres que le roi avait conservées en propre, constituait une autre source importante de revenus. Certes, les rois Édouard le Confesseur et Harold Godwinson possédaient également une réserve, mais Guillaume Ier en a multiplié la superficie en confisquant les terres de la famille d’Harold et de ses alliés, ainsi que de tous les Anglo-Saxons qui s’étaient révoltés entre 1067 et 1075. Les sommes qu’elles généraient représentaient environ le tiers des revenus du roi Guillaume. Pour les collecter, il a affermé sa réserve aux shérifs. Rappelons que l’affermage consistait à prêter un bien contre le versement d’un loyer. Les shérifs l’exploitaient comme ils l’entendaient, avec profit bien entendu, contre le versement du loyer convenu au trésor du roi. En 1086, au moment du Domesday Book, la réserve, et elle-seule, aurait rapporté à Guillaume Ier autour de 12 000 livres de rente. Son revenu total, en excluant les années où le heregeld a été levé, avoisinerait quant à lui les 20 000 livres annuellement. Cela reste des ordres de grandeur, car les données disponibles sous le Conquérant restent fort incomplètes.
J.H. RAMSEY, A History of the Revenues of the Kings of England, 1066-1399, vol. 1 (1066-1272), Oxford, Clarendon Press, 1925, pp. 1-3.
Par. 272 Entre 1087 et 1135, Guillaume II le Roux et plus encore Henri Ier Beauclerc auraient concédé des terres afin de nouer de nouvelles alliances ou de consolider les anciennes, alors que les confiscations pour forfaiture et l’acquisition de biens laissés sans maître n’auraient pas suffi à compenser ces pertes. Cela dit, les revenus de ces deux rois ont néanmoins augmenté. Pour le règne Guillaume II, tout le mérite en revient à Rainulf Flambard. D’abord chapelain, puis trésorier et principal agent des volontés du souverain, on l’a surnommé Passiflamme ou, ce qui revient au même, Rainulf la Torche Dévorante (Devouring Torch), tellement il laissait peu aux habitants après son passage. Son imagination pour faire rentrer l’argent n’avait aucunes limites. Toutes ces magouilles lui auraient permis de collecter environ 25 000 livres annuellement. La carrière de Rainulf a pris fin subitement avec la mort de son maître en 1100. Comme mentionné au paragraphe 257, Henri Ier Beauclerc l’a envoyé immédiatement en prison. Le nouveau roi, soucieux de sa réputation, a d’ailleurs promis à l’article 1 sa Charte de couronnement, précitée au paragraphe 260, de ne plus recourir à ces pratiques condamnables : « [Traduction] J’abolis toutes les coutumes diaboliques dont le royaume d’Angleterre a injustement souffert. » Cela ne veut pas dire qu’Henri s’est appauvri pour autant. On croît même que les revenus annuels de la Couronne auraient augmenté quelque peu, peut-être jusqu’à 28 000 livres. Comment ? Henri, outre le fait qu’il n’a pas vraiment respecté ses promesses, a équilibré les finances publiques en augmentant le prix des loyers de sa réserve et en exigeant des versements en argent au lieu des paiements traditionnels en nature. Et le heregeld a été levé annuellement, ce qui n’avait pas été fait sous les règnes précédents. Henri a donc laissé un royaume en excellente santé financière, moins pour sa gestion de la réserve, qui a rapporté 11 000 livres, que pour celle de son gouvernement, toujours économe et soucieux de maintenir la paix avec ses voisins.
BARLOW, préc. au par. 185, pp. 146-147.
Par. 273 L’administration d’Étienne, qui leur a suivi entre 1135 et 1154, aurait été beaucoup moins heureuse. Encore plus dépensier, affligé en outre par des guerres incessantes, et la perte d’entrées en raison de ces guerres, Étienne a encore cédé des terres de sa réserve, une perte qui s’ajoutait à celles cédées par ses fils Guillaume et Henri. Le total de ses revenus serait tombé à moins de 8 000 livres. Au début du règne de son successeur, en 1154-1155, le Plantagenêt Henri II n’a su encaisser que 3 000 livres pour la totalité de ses terres, en dépit du fait qu’il a réclamé un loyer 20% supérieur à celui de son grand-père Henri Ier Beauclerc. La réserve du Conquérant avait donc perdu environ 80% de sa valeur.
Par. 274 Heureusement pour eux, les héritiers du Conquérant disposaient de nouvelles sources de revenus qui les ont aidés à remplir leurs coffres. Cela explique les budgets de 25 000 et 28 000 livres sous Guillaume le Roux et Henri Beauclerc.
RAMSEY, préc. au par. 271, pp. 5-63.
Par. 275 Les agglomérations urbaines ont été mises à contribution. Sous les Anglo-Saxons, les bourgs, ces villes auxquelles les rois avaient octroyé une charte leur permettant d’y faire le commerce, payaient déjà une taxe sur les transactions effectuées. Guillaume Ier a décidé d’un nouvel impôt sur l’ensemble des villes en considérant leurs habitants comme des tenanciers, urbains plutôt que ruraux, à qui il incombait de payer des redevances en vertu du droit féodal. Cette aide était l’équivalent de la taille imposé aux paysans des campagnes vivant sur les terres possédées en censive. Tout comme le roi l’avait fait pour revenus provenant des domaines ruraux, il a affermé ces nouvelles taxes aux shérifs du shire où les agglomérations urbaines se trouvaient. Les citadins vivant alors dans une relative prospérité, plusieurs shérifs y ont vu l’occasion de leur extorquer des sommes exorbitantes. La plupart des villes, après s’être plaintes de ces abus, ont obtenu du roi le droit de verser un loyer fixé d’avance.
Par. 276 Mais l’aide féodale la plus importante à l’époque considérée a toujours été le service militaire associé à la chevalerie. N’oublions pas que le féodalisme, que Guillaume le Conquérant a généralisé et uniformisé en Angleterre, était d’abord une organisation de défense mutuelle. Seigneur et vassal se portaient secours l’un l’autre selon les règles fixées par les coutumes. L’une d’entre elles a reconnu le paiement d’un droit en remplacement du service militaire pour la durée normale de 40 jours par an. C’est d’ailleurs Rainulf Flambard, le ministre à la triste réputation de Guillaume II, qui aurait créé ce nouvel impôt, appelé l’écuage, permettant à ceux qui le souhaitaient de se soustraire à l’appel aux armes. Car les archives démontrent qu’il s’agissait déjà d’une pratique courante dès l’année 1100. Pour un fief de chevalerie, dont le revenu annuel moyen était évalué à 20 livres, le montant de l’écuage sera éventuellement fixé par Henri Ier à environ 30 shillings. Le service des 5 000 chevaliers du Conquérant, s’ils avaient tous été convertis en espèces, auraient donc représenté une somme de 7 500 livres. Toutefois, sous Henri II, durant l’année 1155-1156, l’écuage ne rapportait encore que 491 livres, 9 shillings et 4 pence. L’écuage augmentera considérablement par la suite, dépendant de ce qu’il en coûtait pour rémunérer un mercenaire durant les 40 jours prescrits par les coutumes, puis perdra éventuellement tout lien avec le coût réel de la solde des mercenaires avant la fin du XIIIe siècle.
RAMSEY, id., pp. 6, 59, 67, 111 et 112. Lire également C.W. Hollister, « The Significance of Scutage Rates in Eleventh- and Twelfth-Century England », (1960) vol. 75 Eng. Hist. Rev. 577, pp. 785-786.
Par. 277 Plusieurs raisons militaient en faveur de l’écuage, du point de vue de la Couronne. En effet, la fidélité des chevaliers était mise à l’épreuve en cas de conflit entre leur seigneur immédiat et le roi. Certains pouvaient en outre s’avérer de piètres combattants. Enfin, plusieurs chevaliers, financièrement en difficulté, ont malheureusement été contraints de diviser leur domaine pour en confier des parcelles à d’autres, autrement dit en sous-inféodant une partie de leur fief. Il leur restait souvent si peu de terres qu’elles ne suffisaient plus à leur subsistance, ni à l’entretien de leur équipement. Dans l’incapacité de remplir leur service militaire, ces chevaliers n’ont pas eu d’autre choix que de payer l’écuage pour ce qu’ils avaient conservé, le solde étant versé par ceux, souvent des paysans aisés, auxquels ils avaient cédé le reste de leur fief. Les rois normands et les premiers Plantagenêts, pour toutes ces raisons, trouvèrent avantageux d’encourager les paiements d’écuage au lieu du service en nature. Et plus intéressant encore, les rois, avec ces nouveaux revenus, pouvaient entretenir une armée de mercenaires, des professionnels du combat totalement dévoués à leur cause, ce qui consolidait leur position face à la noblesse. Toutefois, de manière à éviter les abus, l’article 12 de la Magna Carta de 1215 exigera du roi qu’il obtienne le consentement des hauts barons et des prélats avant toute levée de l’écuage. Car cet impôt ne devait servir qu’en temps de guerre ou de désordres intérieurs. Il n’était pas et n’a jamais été un revenu régulier de la Couronne.
Par. 278 Certaines contributions exceptionnelles prévues par les coutumes seront éventuellement confirmées par Jean sans Terre dans la Magna Carta de 1215. Comme vu précédemment, au paragraphe 218, il y avait le paiement de la rançon quand le roi était retenu prisonnier. Celui-ci pouvait aussi exiger de ses tenanciers en chef une contribution afin de doter sa fille aînée lors de son mariage ou pour équiper son fils aîné au moment où il était fait chevalier. Notons que ces premières aides seront des exceptions au principe voulant que le roi ne puisse désormais lever un nouvel impôt sans le consentement des grands du royaume (article 12 et 14).
Par. 279 La Magna Carta a enfin encadré d’autres prérogatives du souverain qui existait déjà au temps des rois normands, mais demeuraient incertaines dans leur application. Le taux des reliefs, cette taxe sur les successions, était enfin précisé (articles 2 et 3). On y trouvait également son pouvoir de tutelle en vertu duquel le roi nommait un baillistre pour administrer les biens d’un vassal décédé lorsqu’un fils encore mineur lui succédait. Il conservait au passage une part plus ou moins importante mais raisonnable des revenus jusqu’à la majorité du fils et que celui-ci prenait alors possession de son héritage (articles 3, 4 et 5). Le roi gérait également les domaines des archevêchés, des évêchés et des abbayes laissés sans titulaire. Il en conservait les profits jusqu’à l’élection d’un successeur (article 1). Tant les héritiers que l’Église faisaient part de leur mécontentement quand le roi se montrait trop gourmand ou qu’il retardait indûment l’élection. Les pertes encourues par les vassaux séculiers et ecclésiastiques enrichissaient bien sûr le trésor du roi. Les uns et les autres ont donc cherché à réglementer ces dernières prérogatives de la Couronne afin d’éviter ces abus.
Cour du roi
Par. 280 Nous venons d’inventorier la plupart des pouvoirs du roi de la maison de Normandie et les ressources financières dont il disposait pour s’acquitter de ses responsabilités. Rappelons que ce roi possédait en principe tous les pouvoirs de puissance publique : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Cependant, à l’image des autres rois d’Europe à cette époque, du moins ceux qui se montraient sages, il ne les exerçait qu’après avoir consulté les hommes les plus importants de son royaume. Un traité rédigé au XIIe siècle, sous le règne d’Henri II, le Dialogue sur l’Échiquier (Dialogus de Scaccario), souligne l’importance de leur conseil, afin que ce qui aurait été décidé ou déterminé par de si grands hommes contribue à la reconnaissance de droits inviolables. C’était à la fois une manière pour le roi de diluer sa responsabilité et d’augmenter l’acceptabilité des mesures retenues. L’assemblée ainsi réunie, dont nous avons déjà évoqué l’existence, était appelée la Cour du roi ou Curia regis en latin. Elle se voulait l’organisme successeur de l’antique Witan des seigneurs anglo-saxons.
R. FITZ NIGEL, Dialogus de Scaccario, 1179, préc. au par. 90, pp. 523-610, surtout à la pp. 525 et 533.
Par. 281 La juridiction de la Cour du roi s’étendait à tout le royaume. Cependant, ses pouvoirs et sa composition n’étaient pas strictement définis. Au contraire, ses membres, tout comme leurs attributions, variaient selon les exigences du moment et les préférences du souverain. Pendant le règne de Guillaume le Conquérant et de ses successeurs immédiats, les Guillaume le Roux, Henri Beauclerc et Étienne, la Cour est demeurée une assemblée purement consultative au service du roi, ainsi qu’un relais entre la Couronne et le reste du pays. Cette assemblée commandait néanmoins son respect. Un roi qui s’aventurait à gouverner au mépris de ses avis le faisait toujours à ses risques, ceci en raison du pouvoir des membres de la Cour considérés individuellement.
Note: Gautier Map, ou Walter Map en anglais, un juge itinérant du roi Henri II, pendant les années 1172-1173 et 1184-1185, qui participait donc aux travaux de la Cour du roi à ce titre, a insisté sur le fait que la présence à la Cour dépendait entièrement de la faveur du souverain, et que sa composition pouvait donc varier sans autre raison. Il concluait : « [Traduction] Qu’est-ce que la Cour ? Dieu seul le sait, car moi je ne le sais pas. Je sais cependant qu’elle n’est pas toujours la même, selon le moment choisi, qu’elle demeure changeante et variée dans sa composition, et sans cesse en perpétuel mouvement, sans atteindre quelque stabilité (…) Cela serait (...) juste, si nous disions de la Cour (…) qu’elle est stable dans sa mobilité. » W. MAP, De Nugis Curialium, Courtiers’ Trifles, M.R. James (éd. et trad.), édition revue par C.N.L. Brooke et R.A.B. Mynors, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 3.
Par. 282 Qui participaient normalement aux travaux de la Curia regis ? En plus de sa famille immédiate, fils et frères, le roi normand convoquait normalement ses conseillers les plus proches, soit le personnel de son palais. Au fur et à mesure de leur apparition, ils ont été le justicier, le chancelier, le trésorier, le chambellan, le bouteiller, le connétable et les juges du roi. Justicier, chancelier et juges seront les plus importants pour la suite de notre récit. Nous en reparlerons bientôt. Tous étaient les habitués de la Cour, ses membres les plus réguliers, mais sans que leur présence soit nécessaire, ni même toujours sollicitée. Le roi y ajoutait un nombre plus ou moins grand de tenanciers en chef, hauts barons et prélats, ou encore une combinaison de ces seigneurs qui tous lui devaient le service de conseil en vertu du droit féodal. Toutefois, si l’assemblée ne réunissait que des prélats, archevêques, évêques et abbés, on lui donnait alors le nom de synode. Le roi pouvait même quérir de simples barons ou des chevaliers lorsque ceux-ci possédaient suffisamment de biens ou d’influence au sein de leur communauté respective pour se révéler utiles. Sa liberté à cet égard demeurait en principe absolue. La Cour du roi comptait donc un nombre indéterminé et fluctuant de membres. Cela étant dit, on distinguait, au milieu de tous ces rassemblements, deux formations : un conseil restreint et la formation plénière de la Cour du roi.
W. HOLDSWORTH, A history of English Law, vol. 1, 7e éd., Sweet and Maxwell, Londres, 1956, p. 35.
Par. 283 Les réunions de la Cour du roi en conseil restreint étaient de loin les plus fréquentes. Outre les habitués, soit la famille et les gens de son palais qui le suivaient tout le temps, le souverain y convoquait quelques personnages importants, parfois des amis, parfois de grands seigneurs du lieu où la rencontre se tenait, prélats, comtes et hauts barons. On ignore le nombre exact de participants. Aucun quorum n’existait. On sait, par contre, que la liste des témoins signataires des chartes royales, adoptées lors des séances de la Cour, dépassait rarement dix noms. Mais il est possible que plusieurs autres conseillers aient été présents sans pour autant apposer leur signature. Outre les concessions de droits par charte, une réunion en conseil restreint se révélait le moment propice pour rendre justice, lorsque le litige était d’intérêt local ou de moindre importance. On y discutait également de questions politiques. Ce qui semble évident est que le caractère relativement discret, informel et souvent spontané de la rencontre permettait une plus grande confidentialité des débats. Cette formation de la Cour évoluera pour devenir le Conseil du roi (King’s council en anglais), l’organe principal de gouvernement entre le début du règne d’Henri III en 1216 et le dernier quart du règne d’Henri VIII en 1540.
HOLDSWORTH, id., pp. 40-41; W.A. MORRIS, « The Lesser Curia Regis Under the First Two Norman Kings of England », (1929) vol. 34 The American Historical Review 772, pp. 773-778.
Cour du roi en formation restreinte
Illustration de source inconnue.
Malgré ce qui est montré, le roi ne portait pas sa couronne à cette occasion

Par. 284 Lorsque le roi abordait des questions d’intérêt national, selon le jugement qu’il s’en faisait, par exemple un grand procès, un mariage princier, une déclaration de guerre, une réforme religieuse ou encore la levée de nouveaux impôts, il convoquait l’élite du pays pour siéger au sein de sa Cour en formation plénière. L’enquête fiscale du Domesday Book a notamment été décidée lors du conseil de la Noël de 1085 convoqué par le Conquérant. Une proportion considérable de princes, ministres de la Couronne, earls, barons, archevêques, évêques et abbés, voire parfois de simples chevaliers et paysans libres aisés, étaient alors invités. Qu’il y ait eu des absents n’avait aucune importance. Ces assemblées représentaient néanmoins toute la nation. Elles témoignaient du soutien dont le roi disposait dans tout le pays. Cette autre formation de la Cour évoluera sous les règnes d’Henri III (1216-1272), d’Édouard Ier (1272-1307) et d’Édouard II (1307-1327) pour devenir la Chambre des lords du Parlement de Westminster.
HOLDSWORTH, id., p. 39-40.
Par. 285 Guillaume le Conquérant a fait de ces grandes assemblées des événements solennels. Il a pris l’habitude de réunir ainsi sa Cour lors de grandes fêtes religieuses, soit à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Une messe était célébrée. Pour rappeler la source de son autorité et ajouter au décorum, on renouvelait la cérémonie du couronnement. C’était d’ailleurs les seules occasions où le roi portait sa couronne en public, une fois son règne commencé. Il tenait également un grand festin afin de démontrer sa générosité. Guillaume II le Roux a suivi l’exemple de son père. Henri IerBeauclerc, par contre, a abandonné le port de la couronne. Et il n’a réuni la noblesse du pays que très irrégulièrement. On aurait quand même dénombré quelque 27 assemblées du genre pendant son règne de 35 ans. Détail intéressant pour l’évolution subséquente et la future chambre des lords du Parlement, Henri Ier employait des brefs de convocation (writs of summon en anglais) pour s’assurer que la noblesse du pays serait présente en grand nombre.
Note : Après la naissance du Parlement aux XIIIe et XIVe siècles, le bref de convocation adressé personnellement au seigneur et pair du royaume sera également ce qui distinguera un membre de la Chambre des lords du député élu à la Chambre des communes. Il y a là plus qu’une coïncidence; en effet, la Chambre des lords descend en filiation directe de la formation plénière de la Cour du roi. C’est un autre sujet sur lequel nous reviendrons à la partie 10.4. Lire également BARLOW, préc. au par. 185, p. 152, ainsi que HOLDSWORTH, id., p. 32.
Par 286 Les lieux de rassemblement les plus fréquentés par le roi et ses nobles invités ont été Winchester, l’ancienne capitale du Wessex et le lieu de la garde du trésor avant l’année 1207, ainsi que Old Sarum (Dorchester), Gloucester et Westminster. Il n’y avait donc pas vraiment de lieu fixe de rencontre après la conquête de Guillaume et sous le règne de ses successeurs immédiats. Le gouvernement du roi normand suivait celui-ci dans ses déplacements. Mais cela devait changer. Les fréquentes absences des premiers Plantagenêts hors de l’Angleterre les ont incités à fixer leurs ministères en un lieu précis. Et ce fut à Westminster, dans et autour du palais royal, près de la cité Londres dont il deviendra l’un des faubourgs à partir du XIXe siècle. Henri II y a d'abord déménagé l’Échiquier dans les premières années de son règne, peut-être vers 1160, quoique pour cinquante autres années, le trésor resta à Winchester. Il fut cependant décidé par le roi Jean, en 1207, de faire suivre le trésor à Westminster, car il était risqué et peu pratique de transporter d’importantes sommes d’argent entre les deux villes à chaque session de l’Échiquier, au printemps et à l’automne, pour la vérification des comptes. Les tribunaux mis en place par Henri II, Richard Ier et Henri III, les juges itinérants, la Cour des plaids commun et la Cour du banc du roi, ont naturellement suivi le mouvement en s’installant dans le voisinage de l’Échiquier. Enfin, c’est toujours là, au Palais du roi à Westminster, que les lords spirituels et temporels et les députés réunis en Parlement éliront définitivement leur domicile à la fin du XIIIesiècle.
HOLDSWORTH, id., p. 31; H. CLOUT, Hugh, Histoire de Londres, Paris, Presses Universitaires de France, 1999. Lire surtout, concernant le choix de Westminster comme capitale administrative du royaume, T.F. TOUT, The Collected Papers of Thomas Frederick Tout, vol. 3 (Lectures), Manchester, Manchester University Press, 1934, pp. 254-267.
Par. 287 À titre de dispensateur de justice, le roi de la maison de Normandie possédait une juridiction illimitée et toute puissante, certainement en dehors de l’univers ecclésiastique. Guillaume Ier (règne 1066-1087) et Guillaume II (règne 1087-1100) entendaient normalement les litiges portés à leur attention au milieu de leur Cour. C’était une justice coram rege, donc rendue en présence du roi. Exceptionnellement, ces deux Normands ont cependant délégué les pouvoirs de leur Cour à un seul juge, un justicier ou quelque grand officier envoyé en mission. Il s’agissait toujours d’une justice royale, bien que rendue en l’absence du roi. Henri Ier (règne 1100-1135) a innové en créant des cours royales de justice autonomes. Il a ainsi demandé à son ministère des finances, appelé l’Échiquier (Scaccarium en latin), de siéger en tribunal pour juger les questions financières intéressant le trésor et a envoyé des juges parcourir le pays selon des itinéraires connus pour entendre les autres plaids de la Couronne. Nous reviendrons très bientôt sur la justice royale entendu en hors de la présence du roi.
Administration
Par. 288 Il convient maintenant de décrire plus en détails le gouvernement des rois de la maison de Normandie.
Par. 289 Le roi normand administrait son royaume avec l’aide du personnel de son palais. Un document rédigé en 1135 ou 1136, Constitutio Domus Regis, soit peu après la mort d’Henri Ier, nous en fait la liste. Nous y trouvons l’origine de plusieurs grands commis de l’État. Le palais regroupait encore tous les ministres de la Couronne, bien que quelques-uns travaillaient désormais de manière presque autonome, entourés de rares bureaucrates. Le règne des rois normands s’inscrivant dans la continuité de leurs prédécesseurs anglo-saxons, il ne faut pas s’étonner que leur personnel de conseillers soit demeuré le même, à quelques différences près. Les principaux ministres du roi comprenaient donc les sénéchaux (stewards), le majordome-en-chef (master-butler), les maîtres-chambellans (master-chamberlains), le trésorier (treasurer) et le connétable (constable), toutes des personnes dont la fonction, sinon le titre, était connu avant l’arrivée des Normands. D’autres membres du personnel à l’importance décroissante composaient également le palais du roi. Mais la grande innovation des rois normands a été la création d’un poste de justicier d’Angleterre ou de grand justicier (justiciar of England et chief justiciar en anglais), bien que le titre lui-même soit apparu plus tard, sous les Plantagenêts. Une autre différence concernait le poste de secrétaire. Si le roi anglo-saxon avait également un secrétaire principal, aidé d’assistants, celui-ci a considérablement gagné en prestige avec le roi normand. Il se faisait désormais appeler chancelier (chancellor en anglais). Afin d’éviter les répétitions, nous porterons notre attention sur les deux principales nouveautés.
« The Establishment of the King’s Household” (Constitutio Domus Regis), c. 1135 ou 1136, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 454-460.
Par. 290 Le justicier d’Angleterre ou le grand justicier (capitalis justiciarus en latin) est devenu le principal ministre du roi normand, et son remplaçant occasionnel en Angleterre, une responsabilité surtout utile lorsque le roi se rendait de l’autre côté de la Manche pour s’occuper de ses possessions françaises. Comme nous l’avons vu aux paragraphes 257 et 268, Guillaume II le Roux, dès son couronnement en 1087, été le premier à désigner un grand justicier. C'était du moins une personne exerçant les mêmes pouvoirs, à défaut d’être coiffé de ce titre. Il s’agissait de Guillaume de Saint-Carilef, évêque de Durham. Walkelin de Winchester et le tristement célèbre Rainulf Flambard ont suivi. Une fois Flambard incarcéré à la Tour de Londres, Henri Ier Beauclerc a rapidement trouvé d’autres hommes pour prendre la relève. Car si l’on en croît les archives, la fonction et le titre de grand justicier avaient été officiellement reconnus avant 1106, peut-être même au début du nouveau règne en 1100. Henri, beaucoup plus tard, nommera à ce poste Roger, l’évêque de Salisbury. Il sera grand justicier à partir des années 1120 et jusqu’à la fin du règne d’Henri en 1135, avant d’être reconduit par le roi Étienne pour quatre autres années. Intelligent, fidèle et grand travailleur, Roger de Salisbury a laissé sa marque dans l’histoire constitutionnelle de l’Angleterre en créant le département de l’Échiquier. Son pouvoir était tel que les chroniqueurs de l’époque ont dit de lui qu’il contrôlait toute l’Angleterre.
Confirmation by Henry I to the monks of St. Valery, 1106, dans C. JOHNSON (éd.), Regesta Regum Anglo-Normannorum, 1066-1154, vol. 2 (Regesta Henrici Primi, 1100-1135), Oxford, Clarendon Press, 1956, p. 62 (document numéro 797); Chroniques anglo-saxonnes, année 1123, E.H.D., vol 2 (1042-1189), préc. au par. 69, p. 198.
Par. 291 Étienne a licencié Roger de Salisbury en 1139. Rien ne lui a été vraiment reproché, en tous cas rien qui justifierait un congédiement. Ayant perdu la Normandie, Étienne n’avait plus vraiment besoin d’un second pour le remplacer dans son île. Ce sera différent pour son successeur, le Plantagenêt Henri II. Comme ses territoires s’étendaient du nord de l’Angleterre au sud de la France, Henri a dû rétablir la fonction de grand justicier à partir de 1155. Il ne pouvait effectivement se passer d’un second pour gouverner le royaume lors de ses fréquents voyages sur le continent. Après le règne de Jean sans Terre, et la perte de la Bretagne, de la Normandie, du Poitou, ainsi que du grand Anjou, la terre ancestrale des Plantagenêts, le roi Jean a de nouveau cessé ses va-et-vient entre son royaume et la France. L’Angleterre est redevenue le principal lieu de résidence de son souverain. Le besoin d’un vice-roi n’existant plus, le poste de grand justicier perdra rapidement et définitivement son utilité, jusqu’à disparaître complètement en 1234 pendant le règne d’Henri III (1216-1272).
Par. 292 Sous les rois anglo-saxons, on voyait déjà un embryon d’organisation bureaucratique œuvrant au sein du palais du roi, de son household, mais distinct du personnel responsable des soins domestiques (logement, habillement, alimentation, pratique religieuse, sécurité et transport). Cette bureaucratie naissante s’occupait des tâches de secrétariat auprès du roi et de la garde de son trésor. Elle a poursuivi son développement après la conquête de 1066. Une véritable structure gouvernementale a alors été mise en place pour gérer les finances et rendre plus accessible la justice du roi. Il faut cependant demeurer vague sur la composition et le fonctionnement de ce gouvernement constamment remodelé selon les désirs personnels du roi. Un poste de ministre pouvait rester inoccupé plusieurs années, sans difficulté apparente, une indication qu’il y avait encore peu de continuité institutionnelle.
Par. 293 Un chancelier administrait désormais le secrétariat du roi de la maison de Normandie. Ce devait d’être un clerc. Il fallait un homme d’Église pour ce poste, simplement parce que les clercs monopolisaient le savoir, dont l’écriture. Le chancelier dirigeait également la chapelle du roi et son personnel. Un dénommé Herfast (parfois écrit Arfast) aurait été le premier chancelier d’Angleterre. C’est le titre sous lequel il apparaît dans plusieurs chartes émises par Guillaume Ier entre 1068 et 1070, année où il fut élevé au poste d’évêque d’Elmham. Le plus connu des chanceliers demeure cependant Roger de Salisbury, déjà mentionné, chancelier d’Henri Ier pour les années 1101 et 1102, mais qui deviendra également son grand justicier (chief justiciar en anglais) à partir de 1120.
Pour Herfast, identifié comme chancelier, voir DAVIS, préc. au par. 179, pp. 6 (document numéro 22), 8 et 9 (numéro 28) et 12 (numéro 39); et pour Roger de Salisbury, identifié comme chancelier, voir C. JOHNSON (éd.), Regesta Regum Anglo-Normannorum, 1066-1154, vol. 2 (Regesta Henrici Primi, 1100-1135), Oxford, Clarendon Press, 1956, pp. 9 (document numéro 528), 12-13 (numéro 544), 13-14 (numéro 547), 14 (numéro 548), 14-15 (numéro 550), 17 (numéro 565), 17 (numéro 567), 22 (numéro 592), 23-25 (numéros 599 à 605), et 74 (numéro 850).
Par. 294 Plusieurs employés du secrétariat, de deux à quatre clercs, rédigeaient la correspondance privée du roi et ses documents officiels. Il y avait, parmi ces documents, des chartes (charters), des brefs (writs), des enquêtes (surveys) et des relevés de comptes (pipe rolls). Pour les authentifier, le chancelier employait l’unique sceau du roi à cette époque, le grand sceau d’Angleterre dont il avait la garde. Il conservait également dans ses bureaux les comptes établis par le trésorier et le grand justicier. Le chancelier était aidé dans son travail par un adjoint, sorte de sous-ministre appelé le maître du bureau des écritures (master of the writing office en anglais), qui supervisait le travail des secrétaires.
Par. 295 On ne saurait trop insister sur l’importance du chancelier et futur grand justicier Roger de Salisbury dans l’émergence et le développement de la common law. Après que le roi Henri Ier lui eut confié la responsabilité des finances royales en 1109, Salisbury a modernisé le service de la Trésorerie. Avant, le service de la Trésorerie se résumait pour l'essentiel à une salle où l’on conservait les deniers de la Couronne. Mais Roger, dès l’année suivante, en a fait l’appendice d’une nouvelle institution qui répondait au nom de l'Échiquier. L’Échiquier incorporait donc l’ancienne trésorerie tout en lui greffant désormais une cour de justice. C’est également sous la supervision de l’Échiquier que des juges itinérants ont commencé leurs tournées à travers le royaume. La composition et les opérations de l’organisme ont été minutieusement décrites par le trésorier Richard fitz Nigel, ou Néel ou Neal (un grand neveu de Roger de Salisbury), dans un traité monumental titré Dialogus de Saccario ou Dialogue de l’Échiquier, rédigé entre 1177 et 1179. Les prochains paragraphes en font un bref résumé.
R. fitz NIGEL, Dialogus de Saccario, 1177-1179, préc. au par. 90, pp. 523 à 610.
Par. 296 L’Échiquier s’est d’abord fixé à Winchester où le trésor du roi se trouvait déjà. Henri II le déménagera à Westminster vers les années 1160, en début de règne. Il a été le premier département physiquement détaché du palais du roi, de son household. Le Secrétariat, ou la Chancellerie comme on l’appellera plus tard, deviendra le second quelques années plus tard, sous les successeurs d'Henri. Elle est restée un département itinérant tout le XIIe siècle. Ces deux départements ou ministères, avec les juges itinérants, ont constitué le noyau de la future bureaucratie d’État de l’Angleterre.
Voir TOUT, préc. au par. 286, aux mêmes pages.
Par. 297 Deux fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel, soit en avril et en novembre, les shérifs, ces officiers responsables de la perception des impôts, taxes et redevances dus à la Couronne, étaient convoqués devant l’Échiquier pour rendre compte des sommes perçues. Pour encadrer l’opération, l’Échiquier avait été divisé en deux chambres : une chambre basse appelée l’Échiquier des recettes (Lower Exchequer en anglais), et une chambre haute appelée l’Échiquier des comptes (Upper Exchequer en anglais). À la Chambre basse, où tous les shérifs se rendaient, on encaissait les recettes, calculait les sommes reçues, puis contrôlait la qualité du métal des pièces de monnaie. Le clerc du trésorier vérifiait ces étapes, assisté de deux chevaliers. Quatre caissiers comptaient les pièces, puis un autre chevalier et un fondeur de métal répondaient de la qualité de la monnaie. Réunis dans une vaste salle, tous s’asseyaient autour d’une longue table recouverte d’un drap noir brodé d’un dessin quadrillé qui la faisait ressembler à un plateau de jeu d’échec, d’où le nom donné à l’organisme. Ils cochaient sur des tailles en bois les montants en main et les disposaient sur le drap qui servait ainsi pour le calcul. À la chambre haute, on recevait les états de compte. Le justicier du royaume en présidait les séances. Chancelier, connétable, maréchal, trésorier (à partir de 1125), deux chambellans du trésor, et d’autres hauts barons et prélats désignés par le roi siégeaient à ses côtés. Ils portaient tous le titre de barons de l’Échiquier. Une fois les comptes vérifiés, l’argent était déposé dans les coffres du trésor, pendant que des clercs s’occupaient à transcrire les relevés de compte (pipe rolls) sur des rouleaux de parchemin.
Illustration représentant l'Échiquier
Tirée d'un manuscrit du XVe siècle

Développement de la justice royale
Par. 298 La chambre haute de l’Échiquier se transformait en cour de justice en cas de litige. Lorsqu’elle jugeait qu’un shérif se trouvait en faute, elle lui imposait une amende, en plus du remboursement des sommes manquantes. On tenait des archives de ses décisions, ce qui faisait de l’Échiquier une cour d’archives. À ses débuts, la composition de la Cour de l’Échiquier recoupait en partie la Cour du roi. Voilà pourquoi elle possédait la même autorité. Il fallait obéir à ses ordres comme à ceux émis directement par le souverain. Cette quasi-identité entre les deux organismes aurait pu faire douter au départ de la présence d’une institution distincte. Seul un regard rétrospectif nous permet de situer en 1110, sous Henri Ier, la naissance d’une nouvelle cour de justice. Quant aux contemporains, ils ont sans doute réalisé le changement après quelque temps, car les deux rencontres annuelles des barons de l’Échiquier à Winchester, sans la présence du roi Henri, ne devait pas passer inaperçue.
Par. 299 Henri Ier , le Beauclerc, a été le premier roi d’Angleterre à créer des cours royales de justice autonomes. Il y a eu bien sûr la Cour de l’Échiquier qui a siégé à Winchester, puis à Westminster, dont nous venons de parler. Mais celle-ci faisait bien davantage pour s'assurer du respect du droit. À la demande du roi, elle envoyait fréquemment des juges en mission dans les shires afin d’entendre les litiges intéressant la Couronne, en mettant l’accent sur les rentrées fiscales et les plaintes contre les abus des shérifs en ce domaine, mais sans écarter les autres affaires dont nous ferons l’inventaire plus bas. Leurs pouvoirs comprenaient ceux de trancher les litiges, d’imposer des sanctions et de percevoir les amendes. Ils parcouraient le pays selon des itinéraires connus appelés des tournées (circuits en anglais), d’où leur nom de juges itinérants ou encore de juges errants (itinerant justices ou justices in eyre en anglais). Le roi Henri n’a pas mis en place de nouvelles structures pour les accueillir; il s’est plutôt servi des institutions existantes. Lors de leur passage, ces juges présidaient en effet les cours de comté et de bourg. Ils venaient donc renforcer la justice locale plutôt que la remplacer. Après quelque temps, la population a considéré leurs tournées comme une activité normale et l’occasion d’y présenter ses griefs. Les juges itinérants soumettaient faisaient ensuite rapport de leurs travaux à l’Échiquier. Notons que les tournées ne couvraient pas l’ensemble du pays et que leurs missions, quoique fréquentes, n’étaient pas encore régulières. Henri Ier venait néanmoins d’établir un précédent utile pour le futur développement de la justice du roi.
Par. 300 La justice du roi devenait ainsi subitement accessible à la petite noblesse, aux paysans aisés et aux bourgeois qui, contrairement aux grands tenanciers en chef, ne pouvaient exiger un procès devant leur souverain. Toutefois, avant d’être entendus, ces justiciables devaient préalablement obtenir l’autorisation du roi. C’est l’émission d’un bref (writ en anglais) par le Secrétariat du roi qui leur ouvrait la porte. Il va sans dire que le bref n’était pas gratuit. L’une des motivations d’Henri Beauclerc, outre l’affirmation de son autorité dans les régions du pays, consistait à accroître ses revenus. Cette incursion du roi dans le monde judiciaire a été fort bien reçue par la population en général.
Par. 301 Le bref, avons-nous écrit plus tôt, se voulait un écrit concis authentifié par le grand sceau du roi. Il servait principalement comme outil de communication et de contrôle. Ses nombreux usages allaient de l’annonce d’une nomination ou d’une cession de terres à la convocation d’une assemblée. Dans le monde judiciaire, le bref contenait toujours un ordre adressé à un officier de la Couronne ou quelqu’autre individu, ou groupe d’individus, exigeant qu’une action précise soit accomplie. Il reprenait la formule « I will not permit », exprimant une menace contre ceux qui seraient tentés de désobéir au roi, car refuser de suivre l’un de ses ordres constituait alors une infraction pénale. Deux brefs judiciaires ont été créés avant la fin du régime des rois normands : le bref de droit ou breve de recto (writ of right), ce qui signifie « rétablit la justice », et le bref precipe quod redat, qui se traduit par « reçoit ce qu’il devrait te rendre ». Voyons les conditions qui ont favorisé leur apparition.
Par. 302 Au cours du premier siècle suivant la conquête normande, de nombreux tribunaux demeuraient sous le contrôle de particuliers, des tenanciers en chef, comtes, barons, ou évêques, organiquement en dehors de l’appareil judiciaire de l’État et donc du contrôle direct du roi. Il pouvait s’agir d’une cour d’honneur appartenant à tout seigneur féodal, ou d’une cour locale comme la cour de hundred dont un seigneur s’était emparé. C’est avec prudence que le roi normand s’est d’abord ingéré dans la justice administrée par ses tenanciers en chef. Il a commencé lorsqu’un seigneur refusait l’accès de sa cour à un plaignant. Ne disposant pas d’autre voie de recours, le particulier lésé se tournait vers le roi. Celui-ci émettait alors un bref de droit ou breve de recto à l’intention du shérif du comté lui ordonnant de voir à ce que justice soit rendue par la cour du seigneur ou de hundred, à défaut de quoi un officier du roi, ou une autre personne nommée dans ce bref, le ferait à sa place. Le bref praecipe quod reddat représentait une intervention encore plus agressive et directe. Le plaignant était cette fois un particulier qui croyait avoir été injustement dépossédé de sa terre ou qui avait une créance impayée. Peu importait qu’il ait ou non subi une injustice. Si son reproche s’avérait apparemment fondé, le roi émettait un bref, toujours adressé au shérif du comté, afin qu’il rencontre le défenseur pour exiger de lui qu’il rende la possession de la terre en litige ou paye sa dette, sinon de se présenter devant le roi ou ses juges afin de justifier son refus d’obéir à l’ordre donné. Pour ménager les susceptibilités des seigneurs, le roi n’exigeait donc pas la comparution immédiate du défendeur devant sa cour, mais seulement au cas où il désobéirait à l’ordre contenu dans le bref. On présumait donc au départ de la justesse de la cause du plaignant.
Sur le bref de droit, voir M.M. BIGELOW, History of Procedure in England, from the Norman Conquest, (The Normand Period, 1066-1204), Londres, McMillan and Co., 1880, pp. 159-165. Sur le bref precipe quod reddat, voir aussi BIGELOW, id., pp. 83-84.
Par. 303 C’est ainsi, durant le règne d’Henri Ier, que des brefs standardisés sont devenus très progressivement un outil d’emploi dans l’administration de la justice. Sous Henri II, on en augmentera le nombre et la diversité pour en faire une procédure courante dans les litiges civils, plutôt qu’une procédure d’exception.
Par. 304 Les cour royales de justice, en réalité des cours locales régulières supervisées par des juges itinérants, entendaient donc les plaids de la Couronne, des affaires civiles, mais aussi des affaires pénales. C’est dans un traité intitulé les Lois du roi Henri Ier (Leges Henrici Primi) rédigé entre 1114 et 1118, qu’on a mentionné une très courte liste de litiges pouvant leur être soumis, autrement dit ceux pour lesquels le bureau du chancelier s’était reconnu compétent pour émettre des brefs leur donnant accès. D’autres vont s’ajouter lors du règne de son petit-fils le Plantagenêt Henri II (1154-1189).
Leges Henrici Primi, 1114-1118, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 491-495.
Par. 305 D’après ce traité, les juges itinérants d’Henri Beauclerc entendaient certainement les litiges fonciers entre un seigneur et ses tenanciers, en plus de ce qui intéressait directement l’Échiquier, à savoir les rentrées fiscales. Et s’il était interdit de contester un jugement rendu par une cour royale de justice, le traité précisait cependant qu’il était permis d’en appeler d’un jugement rendu par une autre cour, afin de porter le litige devant la justice du roi, notamment un juge itinérant. Il fallait alors plaider un jugement injuste, un refus de rendre justice ou une interprétation erronée des lois du roi. C'est alors que la chancellerie émettait un bref de droit (writ of right), dont nous venons d'évoquer l'existence.
« No man may dispute the judgment of the king’s court, but it shall be permitted to men who have knowledge of the plea to appeal against the judgment of other courts. » Id., art. XXXI, p. 494.
Par. 306 Mais ce traité des lois d’Henri Ier ne disait pas tout. On sait également, grâce aux 336 affaires répertoriées dans des relevés de compte (pipe rolls) provenant de l’Échiquier pour la seule année 1130, que la juridiction des juges royaux s’étendait à de nombreux autres types de litige. On y voit, par exemple, des causes de meurtre, de vol, de viol, de voies de fait, de fraude, de contrefaçon, de bris de la paix du roi en général, ainsi que les châtiments prévus. Tout cela, ignoré autrefois par de nombreux historiens en raison de la nature fiscale de l’Échiquier, indique pourtant que l’engagement pris par le roi Henri dans sa charte de couronnement de faire régner la paix n’était pas une vaine promesse. On pouvait également en conclure que les juges itinérants d’Henri sont ceux qui ont commencé à forger un droit commun pour l'ensemble du royaume d’Angleterre, les véritables initiateurs la future common law.
S.L. MOOERS, « A Reevaluation of Royal Justice under Henry I of England », (1988) vol. 93 The American Historical Review 340, surtout les pp. 343 et 344. Lire également W.T. REEDY, « The origins of the General Eyre in the Reign of Henry I », (1966) vol. 41 Speculum 688-724.
Relevé de compte de l'Échiquier (pipe roll)
Archives nationales de Kew, document répertorié dans le Groupe E, Classe 372, Pièce 80.

Par. 307 Revenons sur la catégorie de plaids portant sur les manquements à la justice, pour lesquels la chancellerie pouvait émettre le bref de droit ou breve de recto (writ of right). Les cours royales pouvaient donc réviser en appel tout jugement rendu par les autres cours de justice, entendre un litige lorsque ces dernières refusaient de le faire, ou encore contrôler l’exercice de leur juridiction en cas d’interprétation erronée des lois du roi. De nombreux tenanciers de rang inférieur, malheureux d’avoir été dépossédées de leur terre, ont ainsi obtenu que des juges royaux examinent leur plainte, même lorsqu’elle relevait de la juridiction de la cour de leur seigneur immédiat. C’était même la routine. C’est dire que l’on trouve déjà dans les lois du roi Beauclerc un premier fondement au pouvoir de surveillance et de contrôle des cours royales sur les juridictions inférieures, le principe qui sous-tend tout le droit administratif moderne, et qui donnera éventuellement naissance aux brefs de prérogative tels le certiorari, la prohibition, le quo warranto et surtout le célèbre habeas corpus.
Par. 308 La juridiction des cours royales reposait sur l’ancienne prérogative du roi d’Angleterre de garder la paix et sur le serment général de fidélité au roi prêté par tous les hommes libres. Il est vrai qu’Henri Ier n’a pas exigé le même serment, contrairement à son frère Guillaume II et à son père Guillaume Ier, mais cela ne semble pas avoir gêné ses juges qui ont veillé à ce que la justice soit rendue, aussi bien dans les affaires civiles que criminelles. Nous y reviendrons.
6.2 Institutions locales : comtés palatins, comtes, barons, chevaliers, shérifs et cours de justice
Par. 309 Pour l’essentiel, le découpage administratif de l’Angleterre sous le règne des rois anglo-saxons est resté inchangé après l’arrivé de Guillaume de Normandie. Il y avait toujours, du plus grand au plus petit, le shire, qui sera plus tard connu alternativement comme un comté quand un comte y sera nommé, le hunfred ou wenpentake, et le hide.
Voir la carte des shires anglais au paragraphe 137.
Comtés palatins
Par. 310 Le Conquérant a cependant abandonné la division en earldoms dès 1066. Certes, il en a recréé quelques-uns, mais en changeant leur nature. De fief d’un très grand seigneur, l’earldom a été transformé en simple marche, autrement dit en district militaire établi sur l’une des frontières du pays afin de le défendre contre les menaces extérieures. Ces menaces venaient d’Écosse, du pays de Galles, et au-delà des mers de Flandre et du Danemark. On a appelé ces nouveaux districts des comtés palatins, bien que le qualificatif palatin ne sera employé couramment qu’à partir d’Henri II (règne 1154-1189). L’adjectif palatin signifiait simplement que le comté dépendait du palais du roi.
Par. 311 À la fin du règne de Guillaume Ier, en 1087, on dénombrait cinq comtés palatins : Durham, face à l’Écosse, Cheshire et Shrewsbury, contre le pays de Galles, Kent, dont les ports de mer étaient tournés vers la Flandre et le Danemark, et Richmond, situé à l’ouest de Londres. Richmond faisait figure d’exception, car il n’occupait aucune position militaire stratégique sur une frontière terrestre ou maritime. On trouvait à la tête de chaque comté palatin un seigneur qui pouvait être tout aussi bien un évêque qu’un comte. Dans son comté, des principautés quasi-indépendantes, ce seigneur possédait d’aussi grands pouvoirs que ceux du roi, sauf pour l’allégeance qu’il devait à son maître et souverain. Sa position le faisait donc ressembler au duc ou au comte français dont la liberté d’action était à peu près complète.
HOLDSWOTH, vol. 1, préc. au par. 282, pp. 108 et 109. Pour une étude plus détaillée et surtout critique quant à un usage aussi précoce du qualificatif palatin, lire J.W. ALEXANDER, « The Alleged Palatinates of Norman England », (1981) vol. 56 Speculum 17-27.
Par. 312 Les seigneurs palatins des frontières comptaient parmi les principaux membres de l’aristocratie anglo-normande. Celle-ci comprenait également des clercs, archevêques, évêques et abbés, et des laïcs, comtes, barons et chevaliers. Avant d’en traiter plus avant, il convient de définir ce qui sépare ces deux catégories de seigneurs.
Par. 313 Rappelons qu’un fief était une terre concédée par un seigneur à un homme, désormais reconnu comme étant son vassal, contre la promesse de ce dernier qu’il lui resterait fidèle et l’aiderait, par des contributions en argent ou en nature, conformément aux coutumes du pays. A départ, le fief n’était que viager; la terre revenait donc au seigneur qui l’avait concédée à la mort de son vassal. Il arrivait cependant qu’un seigneur reconnaisse dans le fils de son vassal un digne successeur. Au début du XIe siècle, soit quelques dizaines d’années avant que Guillaume ne mérite son surnom de Conquérant, la coutume avait reconnu la transmission héréditaire de tous les fiefs laïcs contre le paiement d’un droit de mutation, appelé un relief. Nous avons déjà évoqué cette pratique au paragraphe 229 parmi les nouvelles sources de revenus de la Couronne. En Angleterre, les articles 2 et 3 de la Magna Carta de Jean sans Terre fixera le taux du relief à 100 livres pour une baronnie et à 100 shillings pour une chevalerie.
Par. 314 Les fiefs ecclésiastiques, contrairement aux fiefs laïcs, ne se transmettait pas par héritage. Ils ne donnaient donc pas lieu à l’imposition d’un relief. En effet, et nous l’avons noté au paragraphe 228, les enfants d’un prélat, qu’il ait été archevêque, évêque ou abbé, ne jouissait d’aucun droit sur les biens administrés par leur père défunt. Ces biens revenaient en possession du roi et seigneur direct qui les administrait jusqu’au choix de son successeur. On voulait ainsi empêcher que de puissantes familles n’accaparent une plus grande part de la richesse du royaume et ne deviennent de la sorte par trop puissantes. C'était d’ailleurs l'un des objectifs poursuivis par l'interdiction du mariage des clercs, certainement dans l’esprit des participants au concile de l'Église d'Angleterre tenu à Westminster en 1102. Le roi, en plus de contenir la puissance de son aristocratie, y trouvait également un intérêt encore plus immédiat puisqu’il pouvait dès lors nommer de nouveaux prélats, en choisissant des postulants plus méritoires et surtout plus reconnaissants, parce qu’ils lui devraient tout.
STEPHENS et HUNT, préc. au par. 63, p. 296-297.
Comtes, barons et chevaliers
Par. 315 Il y avait bien quelques comtes dans l’entourage de Guillaume le Conquérant. Mais si l’on exclut les seigneurs palatins, tous devaient leur titre à des possessions françaises ou normandes. Ses enfants Guillaume le Roux et Henri Beauclerc ont créé de nouvelles maisons comtales anglaises, en procédant cependant avec parcimonie. Lorsqu’ils faisaient d’un homme un comte, ils lui donnaient le nom de l’un des quelque 40 shires du royaume, transformant ainsi ces shires en comtés. Les sept premiers comtes, ceux de Le Roux et Beauclerc, dont l’existence peut être prouvé à la fin de leur règne en 1135, ont été associés aux shires de Buckingham, Chester, Gloucester, Huntington, Leicester, Surrey, Warwick et York. Toutefois, Étienne, afin de fortifier son parti dans sa lutte contre Mathilde et son fils Henri Plantagenêt, en a nommé de nombreux autres avant son décès en 1154 : Cornwall, Derby, Devon, Essex, Hereford, Hertford, Lincoln, Norfolk, Northampton, Oxford, Pembroke, Richmond, Salisbury, Sussex, Worcester et York se sont ainsi ajoutés à la liste des shires transformés en comtés. Étienne aurait été si prodigue qu’un contemporain, Robert de Torigni, l’abbé du Mont-Saint-Michel, a rapporté qu’il avait imprudemment dilapidé presque tous les revenus de l’Échiquier.
T.K. KEEFE, « King Henry II and the Earls : The Pipe Roll Evidence », (1981) vol. 13 Albion : A Quarterly Journal Concerned with British Studies 191, pp. 192-193; R. HOWLETT (éd.), Chronicles of the Reigns Stephen , Henry II , and Richard I, vol. 4 (Chronicle of Robert of Torigni), R. Howlett éd., Londres, 1889, pp. 183-185.
Par. 316 Les pouvoirs ou avantages accompagnant la qualité de comte n’étaient pas encore bien définis au temps de Guillaume le Roux et d’Henri Beauclerc. Ils ont été précisés sous le règne d’Étienne (1135-1154) qui leur a accordé le tiers denier du comté, ce qui correspondait au tiers des revenus des plaids des cours locales de shire et de hundred. C’était tout ce que le comte avait en commun avec la division administrative dont il portait désormais le nom. Son titre étant héréditaire, il était transmis automatiquement dès son décès à l’aîné de la famille, en donnant priorité aux fils sur les filles.
Par. 317 Le titre de baron a été introduit en Angleterre par Guillaume le Conquérant. Au début, il désignait exclusivement les vassaux directs du roi, ses tenanciers en chef. Recevoir une terre du roi, peu importe sa taille et sa valeur, faisait donc automatiquement du récipiendaire un baron. Cela dit, comme il a été mentionné au paragraphe 193, rappelons que les tenanciers en chef, s’ils étaient tous des barons, n’avaient pas tous le même statut. Sous le règne du Conquérant, quelques hauts barons, peut-être une dizaine de barones majores, contrôlaient 25% des terres du royaume, alors que les 168 barons restants, les barones minores, se partageaient un autre 25%. Le revenu annuel moyen des premiers était conséquent, soit de 11 à 14 fois supérieur à celui des seconds. Sur le strict plan juridique, un baron restait un baron, mais il existait comme une frontière invisible entre les deux classes de barons qui empêchait de les confondre.
Voir l’illustration au paragraphe 193. Les expressions barones minores et barones majores étaient celles utilisées par les officiers du roi au sein de l’Échiquier : voir le Dialogue de l’Échiquier, reproduit dans E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 587, note infrapaginale 2. Quant à la description du statut des barons, lire STENTON, préc. au par. 263, pp. 84 à 114.
Par. 318 Il arrivait également que le mot baron soit employé pour désigner une fonction officielle ou encore de manière informelle pour marquer le respect éprouvé envers quelqu’un. Tous ceux qui, par exemple, siégeaient au tribunal de l’Échiquier se faisaient appeler barons de l’Échiquier. Et il arrivait qu’un seigneur parle de son vassal en disant mon baron, surtout lorsque le vassal avait lui-même plusieurs chevaliers à son service. Le roi lui-même appelait barons les hommes de son entourage qu’il mettait dans sa confidence et ce peu importe leur véritable statut. Cependant, quand le mot baron se trouvait dans un document officiel, sans autre qualification, on savait qu’il s’agissait d’un tenancier en chef du roi.
STENTON, id., p. 86.
Par. 319 Le titre de baron était devenu héréditaire comme celui de comte. C’était d’ailleurs des hauts barons qu’on élevait le plus souvent au rang de comte. Avec les prélats, archevêques, évêques et abbés, qui eux également possédaient ensemble environ le quart des terres, les hauts barons représentaient l’élite du pays, son aristocratie. Seul l’éclatement de leurs possessions en une multitude de fiefs dispersés dans le royaume les a empêchés d’exercer individuellement un trop grand pouvoir. Ensemble, toutefois, ils pouvaient devenir une menace pour n’importe quel roi, même aussi puissant que l’ont été en leur temps Guillaume le Conquérant (règne 1066-1087), Henri II (règne 1154-1189), Édouard Ier (règne 1272-1307) ou Henri VIII (règne 1509-1547). Car la réalité de leur pouvoir dépendait ultimement de l’appui de la noblesse.
Sur l’éclatement des possessions de hauts barons, voir STENTON, préc. au par. 263, p. 65-66.
Par. 320 La dernière classe de seigneurs laïcs était celle des chevaliers, en anglais knight, un mot venant de l’ancien germain cniht qui désignait autrefois un jeune serviteur page ou écuyer. Elle n’existait pas vraiment en tant que catégorie sociale au début du XIIe siècle, avant ou juste après la conquête normande. Pendant ces années, et jusqu’à la fin du XIe siècle, le combattant à cheval n’était encore qu’un simple guerrier de modeste condition, bref un exécutant, le plus souvent d’origine paysanne. Il ne combattait que sur l’ordre ou avec la permission de son seigneur. Sa valeur dépendait uniquement de son habileté au combat. Être adoubé chevalier signifiait simplement recevoir l’équipement du chevalier et non faire son entrée parmi la noblesse. Outre le cheval qu’il montait, un chevalier normand devait au moins porter une cotte de mailles, un casque et une épée. On demeurait chevalier tant qu’on possédait cet équipement et cessait de l’être une fois qu’on en était dépouillé. Certains chevaliers normands recevront de leur seigneur la possession d’une terre en fief leur permettant de vivre et de combattre. Et d’autres ne recevront que leur solde. Ces derniers dépendaient normalement du seigneur s’ils voulaient se procurer l’attirail extrêmement coûteux du chevalier, encore que quelques-uns, en réalité des mercenaires ou des professionnels du combat, le possédaient en propre. À beaucoup le seigneur demandait de remplir des corvées, notamment le service de garnison, en plus de servir en tant que combattant. Très peu distinguait donc les chevaliers des paysans libres lorsqu’ils ne portaient pas les armes. On pouvait même être à la fois alternativement paysan et chevalier.
STENTON, id., pp. 131-133; P. COSS, The Knight in Medieval England, 1000-1400, Stroud (Gloucestershire), Allan Sutton Publishing, 1993, pp. 5-7; pp. 592-593 et 596-601.
Par. 321 Le roi Henri Ier, dans sa charte de couronnement à l’année 1100, a annoncé qu’il entendait protéger le nombre de plus en plus élevé de chevaliers à qui un baron avait concédé une terre en fief de chevalerie, une tenure pour laquelle seul le service militaire était normalement exigé. Il y a expressément interdit de leur demander quoi que ce soit qui les empêcherait de se consacrer entièrement à leur occupation principale consacrée à la défense du roi et du royaume. La disposition pertinente se lisait : « [Traduction] Les chevaliers qui, en contrepartie de leur domaine, rendent le service militaire équipés de haubert et cotte de mailles (hauberk of mail), doivent pouvoir vivre sur leur terre sans avoir à verser quelque autre aide ou à exécuter quelque autre corvée; je demande cela de bonne grâce et sans rien demander en retour, pour que les chevaliers, une fois libérés de ce trop lourd fardeau, puissent enfin se procurer chevaux et armements de manière à pouvoir s’équiper convenablement et être fin prêts à faire leur devoir de défendre mon royaume. »
Paragraphe 11 de Henry I’s Coronation Charter, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 434.
Par. 322 Henri Beauclerc a donc voulu créer une classe particulière de chevaliers qui se distinguait enfin des paysans et des autres guerriers à cheval par la nature exclusivement militaire de leurs obligations féodales. Chacun de ces chevaliers dépendait du baron, de l’évêque ou du roi qui lui avait sous-inféodé une partie de son domaine afin de constituer son fief de chevalerie. Un baron pouvait ainsi se constituer une unité de chevaliers prêts à servir dans l’ost royal afin de remplir ses propres obligations militaires envers son seigneur le roi.
Par. 323 Le Plantagenêt Henri II procédera à une enquête en 1166 pour découvrir le nombre de chevaliers que comptait son royaume d’Angleterre. Il demandera à ses barons de lui dire combien chacun avait de chevaliers avec leur nom. Les chevaliers qui ne l’avaient pas déjà fait devront alors prêter le serment de fidélité habituel au roi. Malheureusement, le roi n’a pas défini ce qu’était un chevalier. Tous les guerriers à cheval étaient-ils chevaliers ou seulement ceux qui se consacraient exclusivement au métier des armes ? Son enquête s’est donc conclue sur un échec. On ne savait toujours pas quel était le nombre de chevaliers répondant aux critères posés par son grand-père Henri Ier dans sa charte. On savait seulement que les barons et les évêques, en vertu de leurs obligations contractées envers la Couronne, devaient fournir un contingent d’environ 5 000 chevaliers ou l’équivalent en paiement d’écuage. L’écuage gagnant en popularité, le nombre de véritables chevaliers ne pouvait que décliner, peu importe la définition retenue du chevalier.
Le chevalier normand de 1066
Complètement équipé

Par. 324 Le chevalier d’Henri Ier (règne 1100-1135) n’était pas encore gouverné par les règles éthiques qui feront sa réputation lors du règne de son arrière-petit-fils Richard Cœur de Lion (règne 1189-1199). Combattant rustre, sans aucune morale particulière, il tuait non seulement ses ennemis en armes, mais il violait, volait et assassinait également des civils lorsque l’occasion se présentait. Comme les guerres privées se multipliaient avec leur cortège habituel de pillages et de destructions, l’Église a tenté d’instituer la Paix et puis la Trêve de Dieu pour limiter ces exactions. Elle a cherché, dans un premier temps, à obtenir l’engagement des seigneurs et de leurs guerriers de ne pas attaquer, tuer, enlever ou rançonner les civils et les clercs, afin de protéger les innocents. C’était la Paix de Dieu. Par la suite, l’Église a voulu faire respecter une Trêve de Dieu en limitant les périodes où les combats étaient autorisés. Il fallait que ce soit en dehors de certains jours de la semaine et de l’année : soit les vendredi, samedi et dimanche, en souvenir des jours de la passion du Christ, de sa mise au tombeau et de sa résurrection, et lors des principales fêtes liturgiques comme Pâques, Noël et les jours anniversaires des saints notoires. En somme, à défaut de pouvoir interdire la guerre, une impossibilité en cette période troublée, l’Église a tenté d’en restreindre les dégâts en la réglementant. L’interdit et l’excommunication étaient ses armes de prédilection pour forcer le respect de ses injonctions.
BLOCH, préc. au par. 211, pp. 569-576 et 578-579.
Par. 325 Tous les efforts de l’Église n’ont pas suffi, en Angleterre encore moins qu’ailleurs, car l’île avait été largement à l’abri de ce mouvement. Le Conquérant n’en avait pas vu l’utilité. Et son fils Henri Ier avait pris sur lui de maintenir la paix dans son royaume sans en appeler au Tout Puissant. Leur terre de Normandie, par contre, aurait subi les effets de la Paix et de la Trêve de Dieu à partir de 1085. Quoi qu’il en soi, l’Église, à son siège de Rome, s’est rapidement rendue compte qu’elle devait aussi changer les mentalités. Et celles-ci ont évolué, aussi bien en Angleterre que dans le reste du monde chrétien.
H.E.J. COEDREY, « The Peace and the Truce of God in the Eleventh Century », (1970) no. 46 Past & Present 42, pp. 60-61 et 66-67.
Par. 326 En 1135, dans son Histoire des rois de Bretagne, complètement fictive, Geoffroy de Monmouth a fait renaître un grand héros populaire du VIe siècle, le roi Arthur, soi-disant modèle des chevaliers. Plusieurs ont récupéré ce mythe pour répandre l’idée qu’il existait un chevalier idéal. Celui-ci respectait les règles éthiques prescrites par l’Église en tout temps, aussi bien lors de ses activités quotidiennes que durant les combats. Être chevalier était devenu plus qu’une occupation. C’était désormais une certaine manière de se comporter tout comme un authentique titre de noblesse.
G. de MONTMOUTH, Histoire des rois de Bretagne, traduction de L. Mathey-Maille, Paris, Les Belles Lettres, 1992.
Par. 327 Les principes faisant d’un homme un véritable chevalier se résumaient à peu de choses. D’après la description donnée Jean de Salisbury, philosophe et historien du XIIe siècle, dans son traité Policraticus ou Policratique en français, le chevalier devait avoir été choisi par un grand seigneur sur le fondement de critères physiques et moraux indiscutables, tels que la force de corps et de caractère ainsi que le courage. Un serment solennel l’engageait à obéir à son seigneur et à lui rester fidèle. Sur le champ de bataille, sa vaillance était sans faille. Il ne désertait jamais ni ne fuyait devant l’ennemi, mais demeurait solidaire de ses compagnons d’armes. Il n’achevait pas de sang-froid un adversaire vaincu et désarmé demandant grâce. Le chevalier respectait également plusieurs règles de vie en dehors du champ de bataille : en bon chrétien, il évitait de rapporter des propos malveillants, portait secours aux pauvres et aux affligés, allait de bon cœur assister à la messe et défendait l’Église contre ses ennemis.
COSS, préc. au par. 320, pp. 46, 72 et 110 ; J. de SALISBURY, Policraticus, 1159, livre VI, chap. 8, traduit par J. Dickinson sous le titre The Statesman’s Book of John of Salisbury, New York, Alfred A. Knopf, 1927, pp. 198-200.
Le shérif
Par. 328 Être shérif n'était pas un titre de noblesse comme le deviendra celui de chevalier et comme l'étaient ceux de baron ou de comte, mais plutôt l'exercice d'une fonction : un shérif était un serviteur de la Couronne et pouvait être congédié comme tout autre serviteur de la Couronne. Au temps des Anglo-Saxons, il avait secondé l’earldorman, puis l’earl dans sa gestion du shire. D’ailleurs, la manière de le nommer vient de cette époque, car il était le reeve, soit un agent du roi, pour un comté, un shire dans la langue anglo-saxonne, d’où le mot composé shire-reeve, qui deviendra sheriff en anglais classique ou shérif en français. Son prestige et son pouvoir se sont accrus sous les rois normands après la disparition rapide des earls et le congédiement presque aussi rapide des anciens shérifs anglo-saxons. Désormais choisi parmi les quelques 178 barons du royaume, et occupant souvent son poste pour la vie Il était devenu le principal agent du roi dans le comté, sauf dans les districts palatins qui, comme on le sait maintenant, se trouvaient sous l’autorité de seigneurs quasi-indépendants. Le shérif présidait la cour de comté (de shire), veillait à l’application de la paix du roi, administrait les domaines royaux, levait les forces armées du fyrd ou de l’ost, et parfois les commandait lui-même. Il percevait également les impôts, taxes, redevances et amendes dues à la Couronne, qu’il avait d’abord reçus en affermage, autrement dit contre le paiement d’un loyer versé à l’Échiquier.
MORRIS, préc. au par. 142, pp. 1, 41-53 et 55-68.
Par. 329 En résumé, le shérif était devenu le principal exécuteur des ordres émanant du palais du roi. Son souverain communiquait le plus souvent par l’émission d’un bref, cet écrit concis désormais rédigé en latin ou en normand et authentifié par le grand sceau du royaume. Il exigeait l’accomplissement de telle ou telle autre action dans le comté. Ce pouvait être la convocation de la cour de comté ou de hundred, la mise en possession d’une terre, la capture d’un fugitif ou encore l’exécution d’un jugement. Parfois le roi demandait simplement de corriger une injustice, sans autre précision.
Par. 330 Le shérif disposait d’un personnel pour l’assister dans ses fonctions : des clercs, des huissiers, des agents percepteurs et des sergents en armes encaissaient les recettes, s’occupaient de la comptabilité, convoquaient les parties et les jurys aux cours locales de justice, et veillaient généralement à ce que les ordres du shérif soient obéis, au besoin en employant la force.
MORRIS, id., pp. 53-54.
Par. 331 Tous cherchaient l’amitié du shérif en raison de son influence et de son pouvoir considérable dans le shire. Lui-même s’en servait sans gêne pour promouvoir ses intérêts et ceux de ses amis. Lorsque l’homme se révélait sans scrupule, il commettait les pires abus. Et ces abus furent aussi nombreux que mémorables. Plusieurs shérifs ont ainsi augmenté arbitrairement le montant des impôts, taxes et redevances afin d’alimenter leur propre caisse. Les récalcitrants se voyaient emprisonnés, leurs biens saisis. Toute résistance semblait futile. Car ceux qui s’opposaient à lui ne jouissaient d’aucun recours. Ils étaient incapables de faire valoir leurs griefs devant les cours locales sous le contrôle du même shérif et n’avaient pas accès à la Cour du roi à moins d’être un baron. Bien sûr, il y avait ces clauses des chartes royales ordonnant aux shérifs de veiller à ce qu’aucune injustice ne soit commise à l’égard des tenanciers. Mais elles n’étaient que faux-semblants.
MORRIS, id., pp 68-71.
Par. 332 Si Guillaume le Conquérant a senti le danger représenté par ces serviteurs de la Couronne, et tout porte à le croire, car il avait ordonné une enquête à ce sujet en 1077, il n’a pourtant rien fait pour arranger les choses. Son fils et successeur, Guillaume II le Roux, a certes dépêché des agents spéciaux dans les shires, mais ce n’était pas pour protéger ses sujets, mais plutôt parce qu’il souhaitait lever de nouveaux impôts et doutait de l’honnêteté de quelques shérifs, ses agents collecteurs. Plus sensible aux maux affligeant son royaume, Henri Ier, dit Beauclerc, s’est senti obligé de sévir. Il a commencé par renouveler son personnel de shérifs, puis a envoyé en tournée ces juges itinérants dont nous avons parlés pour contrôler leurs abus.
MORRIS, id., pp 84-87.
Par. 333 Guillaume Ier, ou le Conquérant, a maintenu dans leurs fonctions de nombreux shérifs anglo-saxons. La continuité du régime et des institutions semblait à l’ordre du jour, d’autant plus que le nouveau roi se présentait comme l’héritier légitime d’Édouard le Confesseur. Un shérif ne servait toutefois que durant son bon plaisir; il pouvait donc être congédié à tout moment. Et c’est précisément ce qui arriva aux shérifs anglo-saxons, que des Normands et leurs alliés du continent ont remplacés après les révoltes de 1067 à1074.
Par. 334 Le choix des nouveaux shérifs par Guillaume Ier et Guillaume II a souvent porté sur des candidats de modeste condition. Ils récompensaient de la sorte d’anciens fidèles. La durée de leur mandat variait. Certains l’ont exercé seulement quelques mois, d’autres plusieurs années, voire parfois la vie entière. Entre 1100 et 1120, Henri Ier les a maintenus en poste jusqu’à leur retraite ou leur décès. Le roulement du personnel de shérifs s’est accéléré par la suite, soit durant les quinze dernières années de son règne, entre 1120 et 1135. Un mandat ne se prolongeait désormais que sur quatre ou cinq ans. Henri pensait peut-être éviter les abus des shérifs. C’était après tout ce qu’il avait promis de faire. Une autre raison, moins noble, aurait aussi été d’augmenter les recettes encaissées par son trésor. Les archives de l’Échiquier démontrent en effet que le roi vendait parfois cette charge tant convoitée. Malheureusement pour les appelés ou les meilleurs enchérisseurs, l’achat ne comportait aucune garantie, car rien n’empêchait le roi de se débarrasser d’un shérif avant l’arrivée du terme prévu au jour de sa nomination.
Par. 335 Beaucoup plus faible que son oncle Henri Ier, Étienne (règne 1135-1154) a perdu tout contrôle sur la nomination des shérifs. De nombreux comtes ont alors occupé cette fonction, soit avec l’accord du roi, soit parce que ce dernier s’est révélé incapable de les en empêcher. La puissance des comtes augmenta considérablement, au point de se comparer à celle des anciens earls anglo-saxons. Seul le Plantagenêt Henri II (règne 1154-1189) ramènera leur pouvoir à ce qu’il avait été auparavant.
Par. 336 Rappelons enfin que le roi Henri Ier avait été celui qui a porté un premier coup à l’autorité des shérifs quand il a mis sur pied les tournées de juges royaux dans les shires et qu’il a renforcé le contrôle de l’Échiquier sur les finances du royaume. Un sujet lésé, théoriquement, pouvait désormais se plaindre devant l’un de ces juges itinérants lorsqu’il présidait la cour du comté à la place du shérif. Et comme le juge déposait ensuite un rapport de ses activités à son retour à Winchester, des plaintes trop nombreuses pouvaient déclencher une enquête des barons de l’Échiquier sur l’administration du shérif incapable ou délinquant, pour se conclure par une amende ou possiblement par un congédiement. Mais attention ! Encore là, d’après les très rares indications contenues dans les relevés de compte de 1130, il semble que les barons de l’Échiquier se préoccupaient davantage des revenus perdus par le roi, que des injustices commises envers ses sujets.
MORRIS, id., p. 99 et 103; W.A. MORRIS, « The Sheriffs and the Administrative System of Henry I », (1922) vol. 37 The English Historical Review 161, p. 169.
Les cours locales
Par. 337 Tout comme le roi normand avait sa Cour, la Curia regis, chaque comte et chaque baron tenait également la sienne. Il s’agissait de cours d’honneur chargées de trancher les litiges impliquant leurs tenanciers. Les différentes cours royales, en réalité des cours locales de comté (shire) et de centaine (hundred) où les juges itinérants du roi prirent l’habitude de siéger, un peu lors du règne de Henri Ier (1100-1135), et régulièrement après celui de son petit-fils Henri II (1154-1189), ont bien sûr empiété sur ces juridictions féodales au point qu’elles seront progressivement marginalisées. Pourquoi ? Parce que la justice du roi, forte et davantage indépendante, s’est avérée beaucoup plus intéressante pour les parties impliquées dans un litige. L’évolution du droit et de la justice royale s’est donc poursuivie au sein des cours locales de shire et de hundred.
Note : Rappelons que le mot honneur désignait un fief noble auquel certains droits féodaux étaient associés, dont celui de tenir une cour de justice.
Par. 338 La procédure suivie par les cours de comté et de centaine avait peu changé depuis l’ancien régime anglo-saxon. Rappelons ses éléments essentiels, dont nous avons déjà traités aux paragraphes 150 à 156, car cette procédure sera en partie remaniée sous le règne du Plantagenêt Henri II.
Par. 339 Le rôle du juge ou de toute autre personne qui présidait la séance d’une cour de justice se limitait à identifier les coutumes du pays, de déclarer le droit applicable au litige et de décider qui, du plaignant ou du défendeur, supporterait le fardeau de la preuve et la nature de la preuve exigée. La personne ainsi désignée prenait alors Dieu à témoin qu’il disait la vérité. Uniquement Dieu pouvait porter un jugement sur les faits d’un litige. Et, bien sûr, la difficulté était toujours d’interpréter Sa pensée. Deux procédures se sont imposées permettant de connaître le jugement de Dieu : le serment purgatoire et l’ordalie.
Par. 340 Lorsqu’un juge décidait que le litige serait tranché par un serment purgatoire, la partie assumant le fardeau de la preuve donnait sa parole qu’elle disait la vérité, la main posée sur une relique ou sur les Évangiles, en prenant Dieu à témoin de sa sincérité. Le serment comportait implicitement ou explicitement la condamnation divine en cas de faux témoignage du jureur. Celui-ci était toujours aidé par un groupe de cojureurs du même lignage, des parents ou des amis dont le nombre variait selon la qualité des parties et la gravité de la cause. Les cojureurs, même lorsqu’ils ignoraient absolument tout des faits, venaient appuyer le jureur, l’auteur du premier serment, afin de garantir son honorabilité. Si ces conditions étaient satisfaites, un jureur gagnait son procès. Il arrivait cependant que l’autre partie récuse le serment purgatoire en déposant une accusation criminelle de parjure.
Par. 341 L’exemple le plus célèbre de jugement purgatoire a été celui prononcé par le pape Léon III. Léon, d’origine modeste, était ostracisé par les différentes factions de l’aristocratie romaine. En avril 799, des comploteurs sont parvenus à l’emprisonner, en l’accusant de toutes sortes de vices et de crimes, avant que celui-ci ne s’échappe pour trouver refuge auprès de Charlemagne, à Paderborn, en Saxe. Charlemagne s’est donné le temps de réfléchir. Puis il est retourné à Rome avec le souverain pontife bien résolu à l’innocenter. C’était entendu : vu le personnage impliqué, il n’était pas question de lui faire subir un procès trop contraignant. Charlemagne imposa donc au pape la procédure du serment purgatoire à la mode germanique. C’est ainsi qu’au 23 décembre de l’année 800, le pape a été lavé de tout soupçon et qu’il a pu ensuite coiffer son sauveur de la Couronne d’empereur.
Y-M. HILAIRE. (dir.), Histoire de la papauté, 2000 ans de mission et de tribulations, Paris, Éditions Tallandier, 2003, pp. 150-151.
Serment purgatoire du pape Léon III
Peinture réalisée par Raphaël et exposée au musée du Vatican

Par. 342 Le juge pouvait refuser le serment purgatoire d’une personne parce qu’elle était de basse condition sociale, peu fiable de réputation, ou encore que son affaire se présentait mal. Mais lorsque le serment purgatoire était ainsi écarté, quelle que soit la raison, il fallait découvrir la vérité par la procédure d’ordalie, beaucoup moins intéressante pour la partie impliquée. Comme nous l’avons vu plus tôt, l’ordalie consistait en une épreuve physique qu’il fallait surmonter afin de démontrer le soutien du Divin. Quatre types d’ordalie ont été en usage dans l’Angleterre normande : l’épreuve du feu ou de l’eau bouillante, l’épreuve de l’immersion dans l’eau, l’épreuve de la bouchée de pain ou de fromage, et enfin l’épreuve du combat, autrement dit le duel judiciaire.
Par. 343 C’est aussi sous le règne des rois de Normandie que la procédure en matière criminelle devant les cours de shire a connu des progrès importants.
Par. 344 Au début de notre texte, aux paragraphes 68 et 69, nous avons observé qu’au temps des premiers rois anglo-saxons, on ne distinguait pas entre le droit criminel, où une punition est infligée au délinquant pour une infraction contre la société, et le droit civil, où une réparation est accordée pour compenser le dommage causé à la victime par la commission d'un délit. Et que cette opposition n’est apparue que vers la fin du Xe siècle, plus précisément sous le règne d’Ethelred le Malavisé (978-1016). Ce sont les années où quelques infractions ont été jugées si graves qu’aucune compensation aux victimes ne semblaient convenir. Elles étaient considérées botless, ce qui signifie irréparables, et par conséquent hors du champs d’application du droit habituel qui était de permettre l’exercice de la vengeance privée ou l’octroi d’une compensation aux victimes, appelée un bot. La Couronne exerçait dorénavant un monopole à l'égard de ces infractions. Les victimes avaient donc été tout simplement oubliées. Elles n’obtenaient plus rien. Elles n'avaient plus aucun droit à faire valoir, ni vendetta, ni compensation. Il faudra attendre le règne d'Henri Beauclerc pour que l'injustice soit corrigée.
Voir aussi HYAMS, préc. au par. 68, pp. 17 et 18.
Par. 345 En effet, lorsque Henri Ier (1100-1135), lors de son couronnement, a fait valoir son droit de pardonner aux meurtriers, il a expressément confirmé et donc sauvegardé le droit de la famille des victimes à une compensation, conformément aux lois du roi Édouard le Confesseur.
HYAMS, ibid.; Henry I’s Coronation Charter, année 1100, par. 9, dans E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 434.
Par. 346 Un autre développement a eu lieu en procédure criminelle. Traditionnellement, les membres de chaque communauté formaient des jurys chargés des mises en accusation devant les cours locales. Toutefois, pendant le règne de Guillaume le Roux, peut-être à sa suggestion de son grand justicier Ranulf Flambard, le roi a nommé des juges locaux dont l’une des tâches étaient justement de veiller à ce que les criminels soient jugés. Ces poursuites semblaient une nouveauté en Angleterre. Et plus elle démontra son efficacité, plus elle devint impopulaire, tout simplement parce qu’elle représentait une source importante de revenus. L'argent, toujours l'argent.
BARLOW, préc. au par. 185, p. 154.
7. Empire angevin
7.1 Édification d'un Empire
Par. 347 Mathilde, l’héritière désignée par son père Henri Ier pour lui succéder, a contesté le verdict des grands qui avait placé son cousin Étienne de Blois sur le trône d’Angleterre. Mathilde et les membres de sa famille l’ont combattu sans repos, ce que nous avons vu précédemment aux paragraphes 205 à 207. Si Étienne a conservé le royaume d’Angleterre, Geoffroy Plantagenêt, comte d’Anjou et époux de Mathilde, a réussi à s’emparer du duché de Normandie. Après le décès de son fils aîné Eustache en 1153, Étienne a négocié le Traité de Winchester avec Henri, l’héritier de Geoffroy Plantagenêt. Les parties s’y sont mises d’accord pour qu’Étienne continue à régner, mais qu’Henri lui succède à son décès. Étienne n’a pas profité longtemps de la paix retrouvée car il est mort l’année suivante. Le jeune Plantagenêt avait en vue un chemin entièrement dégagé vers le pouvoir. Henri II d’Angleterre a pu ainsi commencer son règne (règne 1154-1189).
Voir l’arbre généalogique des maisons de Normandie et de Blois au par. 199. Lire également le texte du Traité de Winchester, dans E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 436-439.
Portrait fictif d'Henri II
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, mais son auteur peut avoir peint ce portrait après l'examen du gisant se trouvant à l'abbaye de Fontevraud, réalisé du vivant du roi ou immédiatement après son décès, et sûrement approuvé par son épouse Aliénor.

Par. 348 Quelques mois avant son décès, nous étions alors en 1150, l’époux de Mathilde, le comte d’Anjou Geoffroy Plantagenêt, avait confié le duché de Normandie nouvellement conquis à son fils aîné Henri, alors âgé de 17 ans. Ce duché, et le royaume d’Angleterre qu’il tenait de sa mère Mathilde, devaient constituer son héritage. L’Anjou, avec le Maine et la Touraine qui lui étaient des comtés subordonnés, devaient par contre revenir à son frère cadet, lui aussi prénommé Geoffroy. C’était du moins la version donnée par le jeune Geoffroy, le seul des deux frères au chevet de leur père mourant, au moment où il faisait connaître ses dernières volontés. Quoi qu’il en soit, Henri a refusé ce partage des biens et a conservé également les terres ancestrales des Plantagenêts.
Pour la chronologie des évènements à venir, on peut lire l’un des nombreux livres consacrés aux Plantagenêts, notamment D. WILSON, The Plantagenets : The Kings that Made Britain, Londres, Quercus Publishing Plc., 2011, ou le populaire D. JONES, The Plantagenets : The Kings who Made England, Londres, William Collins, 2013; aussi en français M. AURELL, préc. au par. 197; ainsi que A. CHAUOU, Les Plantagenêts et leur cour 1154-1216, Paris, Alpha/Humensis, 2023, et J. FAVIER, Les Plantagenêts : Origines et destin d'un empire XIe-XIVe siècles, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2004.
Par. 349 Brillant et ambitieux, Henri savait saisir les occasions favorables. Et une telle occasion s’est présentée à lui. Le roi de France Louis VII, dit le Pieux, avait commis ce qui pouvait être une erreur politique, et qui s’est avérée en être une assez rapidement, soit de demander et d’obtenir l’annulation de son mariage avec Aliénor d’Aquitaine, une héritière fortunée que l’on disait aussi très belle. Ses raisons n’ont ici aucune importance. Mais moins de deux mois après leur séparation, le 18 mai 1152, Henri Plantagenêt l’a épousé à son tour. Les préparatifs du mariage ont été rondement menés dans la plus grande discrétion. Aliénor, dans sa corbeille de mariage, apportait à Henri le duché d’Aquitaine. Or, à cette époque, le seigneur d’Aquitaine était également duc de Gascogne, un territoire adossé aux Pyrénées, ainsi que comte du Poitou, un domaine aussi vaste couvrant la portion nord-ouest de l’Aquitaine. Outre le Poitou, l’Aquitaine comprenait du nord au sud, de l’Indre à la Garonne, les comtés de La Marche, de Saintonge, d’Angoumois, du Limousin, d’Auvergne, de Périgord, d’Agenais, de Quercy et de Rouergue. Chacun des comtes à la tête de ces territoires jurait allégeance au duc d’Aquitaine, tout comme le duc le faisait à l’égard du roi de France.
Note : Le divorce, au sens où nous le comprenons aujourd’hui, soit la fin du mariage, n’existait pas et n’existe toujours pas en vertu des règles du droit canon qui régissent l’Église catholique. Toutefois, quand un roi appartenant au monde chrétien le souhaitait, il pouvait toujours invoquer l’une de ses règles pour que le Saint Père lui accorde l’annulation, autrement dit qu’il déclare que le mariage n’avait jamais existé, qu’il était et avait toujours été nul ab initio, soit dès l'origine. Un mariage nul, contrairement au divorce qui survenait par définition après le mariage, ne produisait aucun effet légal.
Par. 350 Avant de s’emparer de l’Angleterre, Henri avait déjà triplé la superficie de ses domaines; il possédait en propre ou grâce à son épouse toute la moitié occidentale de la France, hormis la Bretagne. Son pouvoir et sa richesse s’étaient accrus dans les mêmes proportions. Certes, il devait l’hommage à Louis VII pour ses terres françaises, un cérémonial quelque peu humiliant, il faut l’avouer, auquel ses fils Richard et Jean ont dû également se plier. Rappelons cependant que le roi de France intervenait très peu dans les affaires de ses vassaux, contrairement à son cousin anglais.
AUREL, préc. au par. 197, pp. 201-202.
Par. 351 Louis VII a ressenti le mariage d’Henri avec Aliénor comme un camouflet. Il a cherché une raison de s’y opposer et l’a aisément identifiée. En effet, d’après les coutumes féodales, toute femme de la noblesse à la tête d’un fief devait obtenir le consentement de son seigneur avant de se marier. Même Henri, le vassal de Louis, aurait dû faire la même démarche. Or, aucun consentement n’avait été donné, ni même sollicité. Louis a immédiatement invoqué ce prétexte pour déclarer la guerre. Il a élaboré un plan d’attaque contre la Normandie. Geoffroy, le cadet de la famille Plantagenêt, fâché avec son frère depuis qu’il lui avait volé son héritage, a choisi de se rallier à Louis. Son rôle était de fomenter la rébellion contre Henri en Anjou. C’est alors qu’Henri a démontré son savoir-faire. Revenu du Cotentin, une presqu’île au nord-ouest de la Normandie, afin d’affronter Louis, il a rapidement traversé son duché pour ravager le Vexin normand, autour de la ville de Rouen, puis est descendu immédiatement remettre de l’ordre en Anjou. Son courage et son talent auraient tant impressionné Louis que le Français, par ailleurs tombé malade, a renoncé à le combattre.
Par. 352 Henri a pu enfin faire voile vers l’Angleterre et négocier le traité qui fera de lui l’héritier du royaume. Il sera couronné à l’abbaye de Westminster le 19 décembre 1154. En moins de quatre années, il était devenu roi d’Angleterre, duc de Normandie, comte d’Anjou, du Maine et de Touraine, en plus d’avoir acquis les titres de duc d’Aquitaine, duc de Gascogne et comte du Poitou par son mariage. C’était beaucoup. Et pourtant, Henri n’était pas encore satisfait. Il entretenait également des vues sur la Bretagne, un duché reposant sur le flanc ouest de ses comtés d’Anjou et du Maine. Mais il ne devra pas patienter longtemps pour se l’approprier.
Par. 353 À la mort du duc Conan III de Bretagne, en 1148, une guerre de succession a opposé son gendre Eudes de Porhoët et son fils Hoël. Eudes a remporté le titre de duc, sans pour autant mettre fin aux hostilités. Vers 1155, les habitants de Nantes, exaspérés par ce conflit interminable, ont demandé à Henri II de rétablir l’ordre dans leur comté, une composante du duché. Nantes se trouvait au sud de la Bretagne et voisin de l’Anjou. Après qu’Eudes eut été délogé de son fauteuil ducal par son neveu Conan IV, le petit-fils de Conan III, Henri a contraint le nouveau duc à lui remettre ce comté pour le redonner immédiatement à son frère Geoffroy. Henri espérait de la sorte calmer les ardeurs belliqueuses de ce parent trop turbulant. À peine installé dans son comté, à l’été 1158, Geoffroy meurt, encore célibataire et sans enfant. Son héritage est alors passé au troisième fils d’Henri II qui portait également le nom de Geoffroy.
Par. 354 En 1166, le duc Conan IV a fiancé à Geoffroy sa fille unique et seule héritière Constance, puis a abdiqué immédiatement en faveur de son futur beau-fils. C’est ainsi que la Bretagne a été incorporée aux territoires angevins. Puisque Constance n’était encore qu’une enfant au moment où elle a été promise, le mariage aura lieu seulement en 1181. En 1187, elle accouchera d’un fils, Arthur, né peu après la mort de son père Geoffroy. Arthur, petit-fils d’Henri II et neveu du roi Richard Ier Cœur de Lion, sera aussitôt reconnu comme le nouveau duc de Bretagne. Il deviendra l’un des prétendants à la Couronne d’Angleterre après la mort de Richard en 1199.
Par. 355 Henri II a également régné dans le sud du pays de Galles et plus tard dans l'est de l'Irlande. Malheureusement pour lui, les seigneurs gallois, descendants des Normands qui avaient conquis la région sous Guillaume le Roux, n’entendaient pas abandonner leur autonomie. Ils acceptaient mal l’autorité du roi. Ambitieux, l’un des leurs, Richard fitz Gilbert, aussi connu comme étant Richard de Clare, second comte de Pembroke, a conduit ses troupes à l’assaut de l’Irlande et captura les villes de Dublin et Waterford dans le royaume de Leinster. Pendant ce temps, Henri, pour le forcer à se soumettre, a alors confisqué ses domaines gallois et anglais. Contraint, le comte a finalement cédé. Il a même reconnu la souveraineté d’Henri sur les territoires irlandais nouvellement conquis en 1171. Ces territoires deviendront en 1185 l’apanage du dernier fils du roi, Jean, surnommé le sans Terre parce qu’il n’avait reçu aucune terre lors d’un partage précédent entre les autres fils d’Henri. La souveraineté du roi d’Angleterre sur le pays de Galles et en Irlande demeurera longtemps fragile en raison d’une prédisposition observée chez les magnats locaux à rompre leurs engagements, dès que l’étau anglais se desserrait.
Par. 356 Henri II avait réalisé tous ses projets de conquête. Il était devenu le maître de vastes territoires contigus allant de la Mer du Nord aux Pyrénées, que plusieurs thuriféraires d’Henri ont baptisé l’Empire angevin pour rappeler l’Anjou, la terre natale des Plantagenêts. Ce n’était pas un empire au sens courant du terme. Henri n’a régné que sur l’Angleterre, le sud du pays de Galles et l’est de l’Irlande. En France, le Plantagenêt est demeuré un vassal du roi Louis VI le Pieux, à qui il a rendu l’hommage pour toutes les terres qu’il y possédait. Et si Henri a pu exercer un pouvoir fort en Angleterre et dans son duché de Normandie, ailleurs il a dû tenir compte de la large autonomie de ses propres vassaux, fortement attachés à leurs droits féodaux et aux anciennes coutumes de leur région respective. Le soi-disant Empire angevin formait donc une construction fragile, sans unité politique, institutionnelle ou administrative, que seul un roi à la personnalité exceptionnelle pouvait garder unie. Henri n’a cessé de le parcourir à cheval pour consolider et maintenir son autorité. Voilà pourquoi il passera les deux tiers de son existence de 35 ans en France.
Note : L’exemple du Béarn démontre comment un des seigneurs de l’Aquitaine pouvait déjà jouir d'une telle autonomie que son territoire pouvait fort ressembler à un pays souverain. En effet, cette vicomté, adossée au Pyrénées, a joué tour à tour les grandes puissances les unes contre les autres, Angleterre, France et Aragon, pour revendiquer et éventuellement gagner son indépendance. Voir www.histoire-du-bearn.fr.
Carte 9
L'Empire angevin

Par. 357 Les engagements pris par Henri II dans sa charte de couronnement de 1154 tenaient en un seul paragraphe. Ce qui ne s’y était pas était aussi important que ce que l’on y trouvait. Les rois Henri Ier et Étienne avaient admis devoir leur Couronne grâce à l’accord des hauts barons et des prélats du royaume. Le Plantagenêt a évité de le répéter pour ne pas s’affaiblir face aux grands. Les droits et les coutumes qu’Henri II a daignés reconnaître, protéger ou rétablir, étaient ceux qui existaient déjà au temps de son grand-père, le roi Henri Ier. Sa charte annonçait d’ailleurs l’avènement d’un gouvernement central fort dans la continuité de l’administration de ce grand roi. Henri II n'a pas mentionné son prédécesseur sur le trône, comme si Étienne de Blois n’avait jamais régné.
Charter of Henry II addressed generally (1154), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 439-440.
Par. 358 Pour s’attacher la Couronne sur sa tête encore davantage, Henri II renouera avec la coutume du serment général dû au roi par tous les vassaux, arrière-vassaux de la Couronne, nobles ou simples paysans, comme au temps de Guillaume Ier ou de Guillaume II, bien que formulée de manière encore plus exigeante et explicite, car tous les habitants, sans exception, étaient visés. Il inscrira cette obligation dans les Assises de Northampton de 1176. Le lien unissant le roi à ses sujets devra l’emporter sur tout autre engagement. La disposition pertinente de l’Assise se lisait : « [traduction] … que les juges reçoivent les serments de fidélité dû au roi (…) de tous ceux qui souhaitent demeurer dans notre royaume, notamment les comtes, les barons, les chevaliers et les tenanciers libres, et même les vilains. Et qui que ce soit qui refuserait de prêter ce serment doit être arrêté comme un ennemi du seigneur le roi. »
The Assize of Northampton (1176), E.H.D., id., p. 445.
Par. 359 Henri II, né et élevé en France, dans la vallée de la Loire, était étranger à son nouveau royaume. Il a démontré une fois de plus sa sagesse et surtout son habileté en écoutant ceux qui connaissaient l’Angleterre et en agissant suivant leurs conseils. Un de ces personnages influents a été Théobald, l’archevêque de Cantorbéry. Il lui a recommandé d’employer l’un de ses serviteurs du nom de Thomas Becket. Henri a également retenu les services d’anciens fidèles du roi Étienne. L’expérience et la compétence plutôt que les services passés ont été les critères qui ont guidé le choix de ses ministres et des serviteurs composant sa bureaucratie, cela bien que les riches et les puissants n'aient pas été oubliés.
AURELL, préc. au par. 197, pp. 82-89.
Par. 360 La priorité du nouveau gouvernement a été de rétablir le contrôle du roi sur son royaume. Henri a d’abord voulu reprendre les terres de la Couronne imprudemment cédées durant la guerre de succession. Il y avait bien sûr celles qu’Étienne avait données à ses amis, mais Henri lui-même avait beaucoup promis pour s’acheter des alliés. Plusieurs décès opportuns l’ont heureusement aidé. Les plus importants ont été ceux de son oncle le roi David d’Écosse qui devait prendre possession du nord de nord de l’Angleterre, et du comte palatin Ranulf de Chester auquel d’immenses domaines des deux côtés de la Manche étaient destinés. La mort des comtes de Northampton, du Devon, de Warwick et de Lincoln, entre 1153 et 1155, a aussi débarrassé Henri de seigneurs encombrants. Même ses contemporains ont remarqué à quel point la mort semblait son alliée. Mais Henri II n’a pas laissé le sort de son royaume dépendre uniquement de la chance. En invoquant sa prérogative qui lui assurait le contrôle des ouvrages fortifiés, il a ordonné, quelques jours après son couronnement, que ces châteaux soient immédiatement démantelés ou encore lui soient remis. Henri s’est même mis à la tâche personnellement. Avant 1158, il aurait pris quelque 74 châteaux, dont 52 resteront entre les mains de la Couronne jusqu’en 1215. Henri a en outre refusé de reconnaître plusieurs comtes créés par Étienne ou a empêché la transmission de leur titre à leur héritier. Sa politique, à long terme, demeurait d’endiguer, voire d’amoindrir la puissance de cette classe de nobles trop ambitieux et potentiellement dangereux.
J.T. APPLEBY, Henry II, The Vanquished King, New York, The MacMillan Company, 1962, pp. 42-45. F. MADELINE, Les Plantagenêts et leur Empire, Construire un territoire politique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, pp. 84-87.
Par. 361 Aussi urgent que la destruction ou la récupération des châteaux était la remise en état du royaume après deux décennies de laisser-aller. La population anglaise avait terriblement souffert de l’anarchie sous le règne d’Étienne. Des familles avaient été dépossédées de leurs terres, des églises avaient été saccagées, les meurtres, les viols et les prises d’otage s’étaient multipliés. Tous réclamaient le rétablissement de la loi et de l’ordre public. Henri II en a fait un véritable programme de gouvernement. À cette fin, il a procédé à plusieurs réformes du système judiciaire, certaines administratives, d’autres législatives.
Par. 362 L’évêque Nigel d’Ely, neveu du grand administrateur Roger de Salisbury qui avait établi l’Échiquier et mis sur lieds les tournées de juges itinérants, a accepté l’offre du roi Henri II de devenir son trésorier en 1154. C’est une position qu’il avait déjà occupée sous le règne d’Henri Ier. Son mandat était de remettre en vigueur les réformes de son oncle. Pour cela, il lui fallait discipliner les shérifs laissés trop longtemps sans supervision. L’Échiquier demeurait son principal organe de contrôle, le lieu où les shérifs rendaient compte de leur gestion. Nigel a également demandé aux juges itinérants de reprendre leurs tournées. Contrairement à leurs habitudes sous le règne d’Henri Ier, il leur a été enjoint de parcourir régulièrement tout le pays pour entendre les plaids de la Couronne et les plaintes contre les shérifs. Ces juges disaient cette fois agir directement au nom de la Cour du roi et non plus comme les émissaires de l’Échiquier. Si l’on se rappelle la situation sous Henri Ier, les juges itinérants présidaient les cours de comté lors de leur visite; ils renforçaient la justice locale. Ceux du premier roi plantagenêt venaient au contraire la remplacer. Grâce au travail concerté de l’Échiquier et des juges itinérants, Henri a pu évaluer la compétence et l’intégrité de ses shérifs. Un an lui a suffi pour comprendre qu’il fallait en congédier plus de la moitié.
HOLDSWORTH, vol. 1, préc. au par. 282, p.43; MORRIS, préc. au par. 142, pp. 111-112; R. HUDSON, « The Judicial Reforms of Henry II », (1911) vol. 9 Michigan Law Review 385, p. 395; J. BIANCALA, « For Want of Justice : Legal Reforms of Henry II », (1988) vol. 88 Columbia Law Review 433, p. 434.
Par. 363 L’Église représentait le principal centre de la résistance au gouvernement d’Henri II. Pendant le long règne d’Étienne, les évêques et les abbés s’étaient habitués à vivre en marge de la société civile, en conduisant leurs affaires sans trop se préoccuper du roi. Ils avaient notamment renoué avec les appels à Rome de jugements portant sur les clercs, une évolution qui allait dans le sens des réformes entreprises par le pape Grégoire VII (pontificat 1073-1085). L’opposition entre l’Église et le roi s’est cristallisée autour de la personnalité du nouvel archevêque de Cantorbéry depuis 1162 : Thomas Becket, l’ancien chancelier d’Angleterre.
Par. 364 Les parents de Thomas Becket, de prospères marchands normands, avaient émigré en Angleterre quelques années avant sa naissance, vers 1118. Becket avait acquis une formation de clerc sans toutefois avoir été ordonné prêtre. Il était brillant et son jugement semblait sûr. L’archevêque de Cantorbéry Théobald l’avait pris à son service pour le nommer archidiacre. C’est le poste qu’il occupait au moment où Henri II en a fait son chancelier, probablement en 1155.
Par. 365 Becket a été bien davantage qu’un simple ministre; pendant ses sept années passées aux côtés du roi Henri, il est devenu son confident, voire son ami. Et lorsque le siège de l’archevêché de Cantorbéry est devenu vacant, en 1162, Henri a naturellement pensé à lui pour l’occuper. Le nouvel archevêque serait un allié sûr pour achever sa construction politique, croyait alors Henri. Celui-ci a donc désigné Becket comme son candidat à l’élection épiscopale. Et les membres du clergé composant le collège électoral l’ont obligé en ratifiant son choix. Mais Henri n’avait pas prévu que son élévation transformerait Becket. Après avoir coiffé sa mitre, cet archevêque s’est fait le défenseur le plus acharné des droits de l’Église d’Angleterre, mis en danger, croyait-il, par les actions du roi. De son côté, Henri s’est senti personnellement trahi par l’opposition de son ancien ami, vu décidément comme un ingrat.
« Roger of Pontigny » on the election of Thomas Becket as archbishop (1162), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 756-759.
Par. 366 La crise a atteint son paroxysme à l’occasion d’un banal incident survenu en 1163. Des juges royaux ont voulu traduire devant leur cour un prêtre, Philippe de Brois, accusé de viol et d’assassinat. Mais Becket leur a enlevé l’accusé afin qu’il soit jugé par ses soins. L’archevêque était dans son droit. Car depuis un décret émis par Guillaume le Conquérant en 1075, les tribunaux ecclésiastiques avaient compétence en matière religieuse, tant sur les clercs que sur les affaires touchant au droit canon. Pour toute punition, le prêtre, après avoir été reconnu coupable des crimes reprochés, a été battus de verges et suspendu de ses fonctions ecclésiales. Cette sentence a paru fort dérisoire aux yeux de la population. Profitant de l’indignation générale, Henri II a convoqué une réunion du clergé pour lui faire adopter les Constitutions de Clarendon. L’objectif était de donner préséance à la justice du roi sur toutes les autres, y compris celle de l’Église. Les appels à Rome se voyaient dès lors interdits. Henri a réussi à obtenir l’accord général des prélats, mais non celui de l’archevêque Becket.
Constitutions de Clarendon de 1164, E.H.D., id., pp. 766-770. Sur les divers conflits le roi et son archevêque, lire : The disputes between Henry II and Thomas Becket (1162-November 1164), id., pp. 759-783. Et lire surtout, quant à l’incident en cause: Edward Grim, The Council of Woodstock (July 1163), and the case of Philip de Brois, id., pp. 761-762.
Par. 367 Le succès des Constitutions de Clarendon aurait transformé l’Angleterre en un véritable État et son roi serait devenu un souverain à part entière. En effet, s’il voulait être souverain sur le sol anglais, au sens moderne de ce terme, le roi devait écarter tout pouvoir concurrent à celui de son gouvernement. Il fallait donc que l’Église d’Angleterre cesse d’opérer de manière indépendante. Henri a présenté sa loi comme un simple rappel du droit coutumier. C’est ce qui était écrit dans le document en question. Et là était tout le débat : s’agissait-il vraiment de l’état des coutumes sous Henri Ier, celles que son petit-fils Henri II s’était engagé à défendre lors de son couronnement ? Probablement pas ! Les règles prescrites par les Constitutions de Clarendon venaient tout au plus fixer par écrit d’anciennes pratiques appliquées à la pièce que le roi renégociait à l’occasion avec les prélats. Henri voulait imposer ouvertement par la force ce que l’on faisait autrefois sous le manteau par la négociation.
Par. 368 L’adoption des Constitutions de Clarendon a pris Becket par surprise. Il a d’abord refusé de donner son accord, puis a cédé. Becket s’est immédiatement reproché sa faiblesse et est entré en rébellion ouverte contre le roi. Henri, exaspéré, a alors décidé de briser l’archevêque. Sa cour l’a accusé de détournement de fonds, mais Becket a réussi à se soustraire à sa juridiction en appelant à la justice du pape, ce que les Constitutions de Clarendon cherchaient justement à empêcher. Craignant pour sa vie, Becket s’est exilé en France, où il est demeuré six ans. Henri lui a permis de revenir en Angleterre en aux termes d’un accord entre eux garantissant la sécurité de l’archevêque. Becket, sitôt arrivé, a excommunié ses opposants. En l’apprenant, le roi a été pris d’une grande colère et aurait prononcé l’anathème suivant devant ses chevaliers : « [Traduction] Quels misérables bourdons ai-je entretenus et invités dans ma demeure qui permettent que leur seigneur soit traité avec un tel mépris par un ecclésiastique de basse extraction ? N’y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ? »
La citation pourrait cependant n’être qu’apocryphe. Il semble néanmoins qu’Henri ait souhaité tout haut la mort de l’archevêque devant plusieurs témoins, sans toutefois aller jusqu’à demander son assassinat. Voir The events leading up to the murder of Thomas Becket (December 1170) as described by William fitz Stephen, E.H.D., id., pp. 809-810, et Narrative of the murder of Thomas Becket (29 December 1170) by Edward Grim, id., pp. 812-820.
Par. 369 Quatre chevaliers anglo-normands présents, Réginald Fitzurse, Hugues de Morville, Guillaume de Tracy et Richard le Breton, ont interprété les paroles d’Henri comme un appel au meurtre, peu importe leur exacte teneur. Avec une rare violence, ils ont assassiné Becket dans sa cathédrale de Cantorbéry, le 29 décembre 1170. Henri souhaitait probablement la disparition de l’archevêque, mais certainement pas de cette façon. En fin politique, il a compris les implications du meurtre de Becket dont la réputation avait encore grandi par le récit entourant son décès. Alexandre II canonisera d’ailleurs Thomas trois ans plus tard. Les Constitutions de Clarendon ont donc été enterrées avec le nouveau martyr. Henri a juré qu’il renonçait désormais à empêcher les appels à la curie romaine et à adopter toute nouvelle loi relative au clergé. Les accusations criminelles visant les clercs relèveraient comme par le passé des cours ecclésiastiques. Thomas Becket s'était ainsi assuré une victoire posthume en même temps que la sainteté. Jean sans Terre confirmera ce recul en signant la Magna Carta de 1215. Cela ne mettra pas fin aux conflits entre les cours de common law naissantes et les cours ecclésiastiques. Il faudra cependant attendre le règne d'Henri VIII (1509-1547) avant que la juridiction des cours de common law sur les clercs accusés de crimes ne soit clairement établie.
Meurtre de Becket en 1170
Peinture de 1850, auteur inconnu.

Par. 370 Pendant l’exil de Becket en France, les relations entre l’Angleterre et royaume se sont détériorées suite au refus de Louis VII de remettre l’archevêque à Henri. Cela explique pourquoi le Plantagenêt, après avoir interdit aux Anglais de fréquenter la Sorbonne à Paris, a fondé la première université du pays à Oxford, au cours de l’année 1167. Oxford s’était déjà affirmée comme le centre intellectuel de l’Angleterre. Au début du XIIIe siècle, l’université comptera 1 500 étudiants. Il permettra d’instruire des laïcs et de fournir un personnel compétent prêt à servir dans l’administration publique anglaise. Cambridge accueillera à son tour un établissement universitaire en 1229.
L’un des plus vieux bâtiments d’Oxford et le centre autour duquel l’Université s’est développée est l’église St Mary the Virgin. Des cours magistraux y sont donnés depuis le début du XIIIe siècle.
Photo de Diliff, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287403.

Par. 371 À la même époque, en 1163 pour être précis, Henri a abandonné la perception de l’impôt du hergeld, dont le montant dépendait de l'étendue des terres possédées. Il en a compensé la perte en prélevant plus régulièrement la taille, l’aide prélevée sur tous les tenanciers roturiers, urbains comme ruraux. C'est l'exemple même d'une réforme où l'on enlève aux pauvres pour donner aux riches.
Par. 372 Des huit enfants d’Henri avec Aliénor, cinq étaient des garçons, dont quatre ont atteint l’âge adulte : Henri le Jeune, Richard, Geoffroy et Jean. En 1170, Henri II s’est décidé à appliquer le plan de partage de ses terres imaginé en janvier 1169 au château de Montmirail, dans son comté français du Maine. Henri le Jeune aurait l’Angleterre, la Normandie et le Grand Anjou (i.e. Anjou avec Maine et Touraine), Richard recevrait l’Aquitaine, alors que Geoffroy conserverait la Bretagne, territoire dont il était déjà duc depuis 1166 grâce à son mariage avec Constance, la fille du duc Conan IV. Rien n’avait été prévu pour le prince Jean né en 1167, d’où son surnom de « sans Terre ».
Par. 373 Richard se rendra en Aquitaine avec sa mère quelques mois plus tard afin de prendre possession de son duché. Quant à Henri le Jeune, son père l’a fait sacrer en 1170, puis à nouveau en 1172 pour corriger un défaut de procédure lors du premier sacre. Henri le Jeune vivra en tant que roi couronné, mais sans aucun pouvoir réel jusqu’à sa mort le 11 juin 1183. Quelques années plus tard, le 19 août 1186, Geoffroy décédera à son tour. Seuls Richard et Jean survivront à leur père.
Par. 374 Les quinze dernières années d’Henri II ont été les moins heureuses. Car la famille ne lui a pas réussi. Dès 1173, si l’on en croît les annales de Saint-Albin d’Angers : « [Traduction du latin] Les trois fils du roi Henri se révoltent ensemble contre leur père. » À nouveau, entre février 1183 et juillet 1189, ses enfants se sont rebellés contre lui, l’un après l’autre. Leur motif était toujours le même ? Leur père ne voulait pas renoncer à un iota de son pouvoir; il entendait continuer à gouverner l’ensemble des territoires de la famille au mépris des droits qu’il leur avait légalement cédés. Henri le Jeune, Richard et Geoffroy, pourtant roi ou duc de jure, voulaient pourtant autre chose que des couronnes de pacotille. Quant à Jean, l’oublié, le sans Terre, il a également trahi son père quand il a atteint l’âge de comploter. Mais Henri avait encore l’énergie nécessaire pour leur résister, cela encore quelques années. Aliénor, qui avait intrigué avec ses enfants bien avant, s’était déjà habituée à la vie de prisonnière, parfois en semi-liberté, dans divers châteaux. Elle devra attendre la mort d’Henri en 1189 pour que son fils Richard, devenu roi, lui donne les clés lui permettant d'en sortir.
Annales Sancti Albini Andegavensis, dans L. HALPIEN (éd.), Recueil d’annales angevines et vendômoises, Paris, Alphonse Picard et Fils éditeurs, 1903, p. 16.
Arbre généalogique 3

7.2 Dislocation de l'Empire et adoption de la Magna Carta de 1215
Par. 375 Après la mort d’Henri le Jeune, le 11 juin 1183, Richard était devenu l’héritier présomptif. Habile dans les arts du combat, il s’était acquis la réputation d’un guerrier valeureux et sans peur qui lui vaudra en Terre sainte le surnom de Cœur de Lion. Mais Richard ne voulait pas être couronné de roi et devenir comme son frère un monarque privé de tout pouvoir. Il n’envisageait surtout pas de renoncer à l’Aquitaine, dont son père voulait l’évincer pour la confier à Jean. Henri a tenté de régler l’affaire lors d’une rencontre avec les deux frères le 29 septembre 1183. Richard a refusé net l’arrangement proposé et a quitté la Normandie pour rejoindre le Poitou, bien décidé à défendre son héritage aquitanien. Jean, désormais allié avec Geoffroy, a pris les armes à son tour. La nouvelle bagarre a opposé cette fois les trois frères restants, qui ne s’aimaient guère, pas plus qu’ils n’appréciaient leur père. Après quelques péripéties, dont l’implication nouvelle du roi Philippe Auguste, et la mort de Geoffroy, les escarmouches ont repris entre les frères et contre leur père. Henri II, épuisé, s’est finalement retiré à son château de Chinon où il est mort à son tour, le 6 juillet 1189, non sans avoir appris la trahison de son fils favori, le prince Jean, qui avait rallié Richard à la dernière minute. Le premier acte du roi Richard Ier a été de libérer sa mère Aliénor.
Par. 376 Richard Ier, le futur Cœur de Lion (règne 1189-1199), a été oint et couronné le 3 septembre. Le rituel avait peu changé depuis d’intronisation du roi anglo-saxon Edgard le Pacifique, 200 ans auparavant. Mais ce rituel n’avait jamais encore été aussi bien dépeint avant Richard. Voici un résumé de ce qu’en a écrit Roger de Hoveden ou de Howden, un serviteur de Henri II et chroniqueur du XIIe siècle :
« Les évêques, les abbés et les autres membres du clergé, précédés de la croix, ont ouvert le cortège en escortant Richard jusqu’à l’autel de l’abbaye de Westminster. Entourés de ces prélats, suivis par les comtes, les barons et quelques-uns de leurs chevaliers, Richard s’est agenouillé devant l’autel. Il a juré sur les Évangiles et les saintes reliques posées devant lui que tous les jours de sa vie, il ferait observer la paix, qu’il honorerait et respecterait Dieu, la Sainte Église et ses ministres, qu’il exercerait droit de justice et stricte équité aux peuples qui lui étaient confiés, qu’il abrogerait les mauvaises lois et les coutumes injustes et adopterait à leur place de bonnes lois, qu’il observerait sans fraude ni malice. Richard s’est ensuite déshabillé pour ne conserver que sa chemise et son haut-de-chausses, a dénudé ses épaules, puis a reçu l’huile sainte des mains de Baldwin, l’archevêque de Cantorbéry. L’onction terminée, on l’a revêtu de ses vêtements royaux. Il a d’abord reçu l’épée. Après que deux comtes lui eurent fixé des éperons aux pieds, l’archevêque l’a semoncé en lui défendant d’accepter cet honneur s’il n’avait pas l’intention de respecter scrupuleusement le serment qu’il venait de prononcer. Richard s’est de nouveau engagé à le faire. L’archevêque lui a alors posé la couronne sur la tête avant de lui donner les autres symboles de son autorité : le sceptre et la baguette. Une messe a conclu la cérémonie. »
R. de HOVEDEN, The Annals of Roger de Hoveden, comprising the History of England, and of other Countries of Europe, from A.D. 732 to A.D. 1201, vol. 2, Londres, H.G. Bohn, 1853, pp. 117-119 (description du couronnement).
Gisant de Richard Cœur de Lion
Abbaye de Fontevraud, dans l'ancienne province d'Anjou, commune de Fontevraud-l'Abbaye.
Comme cette sculpture, placée à l'origine sur la tombe de Richard, a été réalisée par des personnes qui ont connu le roi ou suivant les conseils de personnes qui ont connu le roi, il est probablement le premier portrait relativement fidèle d'un souverain d'Angleterre.

Par. 377 Richard s’est montré magnanime. Il a pardonné à ceux qui l’avaient combattu en servant fidèlement son père, à commencer par le célèbre Guillaume le Maréchal, reconnu pour être le modèle des chevaliers. Richard lui a même offert pour épouse une riche héritière. Mais Jean, son unique frère survivant, posait problème. Tout était à craindre de lui. Richard, pour le contenter, lui a néanmoins concédé plusieurs terres rapportant 4 000 livres de revenu par an, ce qui correspondait aux dernières promesses de leur père Henri II au cadet de la famille.
Par. 378 Depuis la chute du royaume de Jérusalem en 1187 aux mains des musulmans, et de leur chef Saladin, l’obsession de Richard Ier était de partir en croisade afin de libérer la Terre sainte. Or, une telle entreprise coûtait énormément d’argent. Le roi a donc institué la dime saladine, un impôt prélevé par l’Église auquel on avait donné le nom de leur ennemi commun, le sultan Saladin. On a ainsi recueilli 60 000 livres. Tout impôt déplaisait. Cela dit, toute critique semblait malvenue dans le cas d’une action aussi noble que la croisade, d’autant plus que cette contribution était prévue par le droit féodal. La dime ne suffisant pas, Richard a aussi vendu des charges publiques et des privilèges.
Ordinance of the « Saladin Tithe » (1188), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 766-770.
Par. 379 Richard a finalement quitté ses terres au début de juin 1190. Après un détour par la Sicile, et par Chypre, il a capturé la ville d’Acre en Terre sainte le 12 juillet 1191, a remporté une importante bataille contre Saladin dans la plaine d’Arsouf ou Arsour le 7 septembre 1191, puis a renoncé à faire le siège de Jérusalem le 4 juillet 1192. Le roi a quitté la région à la fin de l’été, non sans avoir remporté une dernière bataille contre Saladin, cette fois à Jaffa, le 5 août 1192. On célébra chacune de ses victoires dans tout le monde chrétien. Il était devenu le Cœur de Lion, d’après le trouvère, poète et jongleur normand qui l’avait suivi en croisade, un dénommé Ambroise, le premier à l’avoir affublé de ce surnom.
Le récit de sa croisade, ici encore, a été bien documenté par son serviteur Roger de Hoveden : HOVEDEN, préc. au par. 376, pp. 140-269. Lire aussi AMBROISE, Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, ou l’Estoire de la guerre sainte, écrite vers 1195, Gaston Paris (trad.), Paris, Imprimerie Nationale, 1897, p. 360.
Richard Cœur de Lion quittant la Terre sainte
Illustration d’Alphonse de Neuville (1835-1885) pour L’histoire de France racontée à mes petits-enfants, par François Guizot en 1875.

Par. 380 Richard a précipité son départ de la Terre sainte, troublé par les nouvelles d’Angleterre plus qu’inquiétantes : le prince Jean complotait afin de s’emparer du trône, lui a appris la correspondance de son vice-chancelier Jean d'Alençon. Le prince, encouragé par le Français Philippe Auguste, avait rallié de nombreux barons à sa cause, saisi de nombreux châteaux, en plus d'avoir pris le contrôle de la taxation.
C.H. PEARSON, History of England during the Early and Middle Ages, vol. 1, Londres, Bell and Daldy, 1867, p. 559.
Par. 381 Comble de malchance pour Richard, il a été capturé, puis emprisonné sur le chemin du retour par l’empereur allemand Henri VI, au mépris de la coutume garantissant le libre passage aux croisés. Jean a saisi cette chance inespérée pour négocier un pacte avec le roi de France, Philippe Auguste. S’il le laissait gouverner en paix les autres terres de l’Empire angevin, Jean lui remettrait quelques places dans le pays d’Évreux, sur l’autre rive de la Seine, en plus du Vexin normand, mais en excluant la ville de Rouen.
HOVEDEN, préc. au par. 376, p. 269; Richard of Devizes, « Of the Time of King Richard I »; Selected passages from the years 1090-2, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, pp. 53-63. Lire aussi FAVIER, préc. au par. 348, pp. 574-590, pour un excellent résumé du passage de Richard en Terre sainte.
Par. 382 Au même moment, l’Allemand a exigé une rançon de 150 000 marks d’argent en monnaie de Cologne contre la libération de Richard, soit environ 100 000 livres anglaises, une somme énorme, équivalente au quart de la richesse du royaume anglais ou à trois années de revenus pour la Couronne. Aliénor a pressé les shérifs et les justiciers de rassembler au moins les deux tiers de la rançon, l’acompte nécessaire à sa libération, le solde pouvant être versé après son retour. L’impôt dédié au paiement de la rançon était une autre contribution prévue par le droit féodal. Sa légalité n’a nullement soulagé la population anglaise assommée par un fardeau aussi lourd. Une fois l’acompte versé, Richard a quitté l’Allemagne. Il a débarqué sur les côtes anglaises en avril 1194. Son entrée a été triomphale, à tel point que son escorte allemande s'est demandée pourquoi leur empereur n'avait pas demandé davantage pour la libération du Croisé. Peu après, magnanime, Richard a pardonné à Jean sa trahison.
PEARSON, préc. au par. 380, pp. 559-562; RAMSEY, préc. au par. 271, p. 211.
Par. 383 Richard Ier ne s’est jamais vraiment intéressé à la gouvernance de son royaume anglais. Pourtant, malgré des progrès notables réalisés par son père Henri II, l’administration de la justice laissait encore à désirer. Ses ministres ont donc introduit deux réformes significatives au cours de l’année 1194. Ils ont mis sur pied l’institution des coroners, dont la tâche était d’enquêter sur tout décès subi ou encore provenant de cause non naturelle. L’innovation a connu un tel succès parmi le peuple que l’on trouve encore aujourd’hui des coroners. Ils ont également créé une nouvelle cour royale d’archives siégeant au palais de Westminster aux côtés de l’Échiquier. On l’a d’abord baptisée le Banc de Westminster (Bench at Westminster), avant qu’elle ne prenne le nom de Cour des plaids communs (Court of common pleas). Cette cour siégeait lorsqu’il n’y avait pas de tournées de juges itinérants. Il se trouvait toujours ainsi une cour royale prête à entendre un litige, une autre innovation qui a plu à la population. La Cour des plaids communs connaîtra une très longue histoire. Elle sera le principal auteur de la common law avec les juges itinérants, la Cour de l’échiquier, ainsi que la future Cour du banc du roi qui naîtra sous Henri III.
R.F. HUNNISETT, « The Origins of the Office of Coroner : The Alexander Prize Essay », (1958) vol. 8 Transactions of the Royal Historical Society 85, surtout pp. 86 et 103; R.D. FLYNN, The Medieval Coroner; A Brief Examination, Publication indépendante, 2022, pp. 7-8; R.V. TURNER, « The Origins of Common Pleas and King’s Bench », (1977) vol. 21 The American Journal of Legal History 238, pp. 244 et 249-254; B. KEMP, « Exchequer and Bench in the Later Twelft Century – Separate or identical Tribunal », (1973) vol. 88 The English Historical Review 559, p. 562.
Par. 384 Ses immenses besoins d’argent ont obligé Richard à faire revivre sous une autre forme l’impôt foncier du heregeld abandonné par son père en 1163. La nouvelle unité de superficie servant à calculer l’impôt a été appelée un caruca et le nouvel impôt un carucage. Un caruca, ou terre de labour, correspondait à la superficie de terre pouvant être labourée dans une année par une charrue avec un équipage de huit bœufs. Sa dimension pouvait varier de 60 à 120 acres. Richard a prélevé cet impôt en 1194 au taux de deux pence par caruca. En 1198, après qu’une nouvelle enquête semblable au Domesday Book eut réalisé l’inventaire de toutes les terres du royaume, il a augmenté le taux à cinq pence. Le carucage a encore été prélevé en 1200, en 1220 et en 1224, avant d’être abandonné à son tour.
RAMSEY, préc. au par. 271, pp. 212-214, 224-225 et 279.
Par. 385 Richard a repris le sentier de la guerre, cette fois afin de récupérer les territoires imprudemment cédés par Jean au roi de France Philippe Auguste. Il y avait aussi plusieurs villes et forteresses que son frère, dans sa quête d’alliances et de soutiens, avait abandonnées à divers seigneurs. Les victoires de Richard sur le champ de bataille se sont enchaînées jusqu’à ce qu’une trêve, négociée le 5 décembre 1195, et ratifiée en janvier, appelée Traité de Gaillon par les Français ou de Louviers par les Anglais, mette fin aux hostilités. Richard a pu ainsi rétablir plus ou moins dans leur état d’origine les frontières de ses domaines. Mais Gaillon fut une paix de compromis et non pas une victoire. Car Philippe avait conservé une partie de ses conquêtes normandes. D’ailleurs, la guerre a repris dès l’été suivant. Batailles, négociations et nouvelles trêves ou pauses ont suivi, sans paix véritable, pendant trois années.
ROUSSEAU et G. DÉSIRÉ dit GOSSET, « Le traité de Gaillon (1196) : Édition critique et traduction », Tabularia [en ligne], Sources en ligne, mis en ligne le 5 novembre 2002, URL : http://journals.openedition.org/tabularia/2461. Les auteurs ont pu consulter dans les archives les documents originaux. Il s’agit donc de la traduction la plus fidèle à ce jour. Lire aussi FAVIER, préc. au par. 347, pp. 623-638, pour le récit des suites du Traité de Gaillon.
Par. 386 Il ne fallait pas s’opposer au Cœur de Lion. On aurait pu penser que les vassaux français de Richard avaient compris la leçon. Et pourtant non ! Le vicomte Adémar (ou Aimar) de Limoges osa encore le défier, C'était en mars 1199. Dans ses chroniques, Roger de Hoveden raconte qu'Adémar avait trouvé sur ses terres un trésor rempli de pièces d’or et d’argent. Il en fit parvenir une part à son seigneur Richard en sa qualité de duc d’Aquitaine, alors que ce dernier, mécontent, affirmait avoir le droit d’en exiger la totalité. Le vicomte refusa sec. Richard alla donc à sa rencontre à la tête d’une imposante force armée et assiégea le château d’Adémar à Châlus. L'affaire se présentait plutôt bien pour le duc-roi; il n'y avait dans l'enceinte de la forteresse que deux chevaliers et 38 hommes d'armes. Et pourtant, mauvais coup du sort, Richard, pendant les combats, a été touché à l’épaule par un carreau d’arbalète, au bas du cou. La blessure s’est infectée et, 11 jours plus tard, le 6 avril, le roi chevalier mourait aux pieds des murailles du château de Châlus-Chabrol, à l'âge de 41 ans.
HOVEDEN, préc. au par. 376, pp. 452-455.
Château de Châlus-Chabrol
Photo prise par Charles de Flahaut

Par. 387 Richard Ier a régné dix ans. (1189-1199). L’essentiel de son temps a été consacré à la guerre, soit en France, soit en Terre sainte. Au total, il ne passa guère plus d’une année de son règne en Angleterre. S’il a conservé à peu près intact l’héritage reçu, il a par contre laissé son royaume exsangue, appauvri par le coût de ses campagnes militaires et le paiement de sa rançon. Richard a néanmoins laissé un excellent souvenir dans l’imaginaire collectif en raison de ses nombreuses victoires. Champion de la Guerre Sainte, héros et idole, Richard a représenté le modèle du roi chevalier.
Par. 388 On s’en doute; la nouvelle de la mort de Richard Ier a été bien accueillie à la Cour de France. Immédiatement, le roi Philippe Auguste profita de la vacance du pouvoir au sein de l’Empire plantagenêt pour s’attaquer à la ville d’Évreux et capturer le pays alentour. Le Traité du Goulet, du 22 mai 1200, avec Jean sans Terre officialisa sa prise en faisant entrer le comté d’Évreux dans le domaine du roi de France.
HOVEDEN, id., p. 455. Pour le texte du traité dans sa version latine, voir H.F. DELABORDE et C.H. PETIT-DUTAILLIS, Recueil des Actes de Philippe Auguste roi de France, tome 2 (1194-1206), Paris, Imprimerie Nationale, 1943, document 633, pp. 178-185.
Par. 389 Jean, dit le sans Terre (règne 1199-1216), a ceint la Couronne le 27 mai 1199. Bien que n’excellant pas dans le maniement des armes, contrairement à Henri le Jeune, Richard ou Geoffroy, Jean avait néanmoins reçu une excellente éducation, certainement comparable à celle de ses aînés et des autres princes de son temps. Le nouveau roi parlait et lisait bien sûr le français, sa langue maternelle, mais aussi l’anglais et le latin. Il a d’ailleurs tant pris goût à la lecture dans son enfance qu’il ne cessera jamais, sa vie durant, d’enrichir sa bibliothèque d’œuvres de toutes sortes et de toutes provenances, sacrées comme profanes. À l’âge de 15 ans, donc vers 1180 et pour quelques années, son père l’avait confié aux soins du célèbre justicier Ranulf de Glanville, l’auteur sinon l’inspirateur du premier véritable traité sur la common law naissante. Le maître l’avait alors certainement initié au droit et à l’administration du royaume. Il possédait ainsi tout le savoir nécessaire pour bien gouverner. Toutefois, l’éducation de Jean n’avait pas corrigé ses défauts de caractère. Il se montrait trop souvent soupçonneux, méfiant, impulsif, arrogant ou méprisant envers ses semblables. On l’a également accusé de cruauté et haï pour cela. Giraud de Barry ou de Barri, autrefois précepteur de Jean, qui devait pourtant se montrer prudent lorsqu'il a publié son ouvrage en 1189, l'a dépeint à l'âge de 22 ans comme étant attiré dans les filets et pris au piège d'une jeunesse dissolue et bouillante, incapable de résister aux élans de la nature, plus adonné à la molasse qu'à la prouesse, plus à la jouissance qu'à l'endurance, plus à l'amour qu'à la bravoure, et plus à la légèreté de la jeunesse qu'à la maturité de l'âge d'homme. Tout était dit. Après son accession au trône, ces travers empêcheront Jean de fidéliser ses barons.
G.D.H. HALL, The Treatise of the Laws and Customs of the Realm of England Called Glanvill, Oxford, Oxford University Press, 1965. Pour la cérémonie de couronnement, lire WENDOVER, préc. au par. 197, pp. 180-182. Pour un portrait de Jean, lire GIRAUD de BARRY, ou GERALD of WALES pour les Anglais, The Historical Works of Giraldus Cambrensis, Topographia Hibernica, publié à l'origine en 1189, T. Wright (éd.), Londres, George Bell & Sons, 1905, p. 163. Un contemporain, malheureusement anonyme, mais s^rement un témoin oculaire, a également mentionné sa cruauté envers les hommes et son âpre convoitise envers les femmes: F. MICHEL, Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, Paris, Chez Jules Renouard et Cie, Imprimerie de Crapelet, 1840, pp. 105. Ses termes exacts étaient: « Molt mal homme ot el roi Jehan: crueus estoit sor toz homes; de bieles femes estoit trop convoiteus; mainte honte en fist as haus homes de ta tierre: par coi il fu moult haïs. »
Portrait fictif du roi Jean sans Terre
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 390 Jean était devenu roi d’Angleterre avec le soutien de la noblesse anglaise et de celle de son duché de Normandie. Mais la plupart de ses autres vassaux français, en Bretagne, en Aquitaine ou dans le Poitou, se sont opposés au nouveau roi pour lui préférer le duc Arthur de Bretagne, fils de son frère aîné Geoffroy décédé 13 ans plus tôt. Arthur jouissait également de l’appui du roi de France, Philippe Auguste, qui voyait dans ce mouvement d’opposition à Jean une occasion de profit. Parce que Jean, se sentant vulnérable, craignait de perdre ses terres françaises, il a négocié avec Philippe le Traité de Goulet déjà mentionné pour s’assurer de sa neutralité. Cette neutralité avait cependant un prix. En vertu des clauses du traité, le roi de France conservait le Pays d’Évreux et reprenait le Vexin normand, déjà cédés par Jean en 1193, mais récupéré par Richard en 1195 et 1196.
Par. 391 Le prix était conséquent, surtout si l’on considère que Philippe invoquerait le premier prétexte venu pour renier sa parole. Jean sans Terre le lui a aimablement fourni quand il a épousé au cours du mois d'août de l'année 1200 Isabelle, héritière du comté d’Angoumois en France, alors que la belle de 12 ans, l'âge légal pour un mariage, avait déjà été promise quelques semaines plus tôt à Hugues de Lusignan, un seigneur français du Poitou. Furieux de perdre à la fois sa fiancée et surtout sa dot, Hugues, devenu entre-temps comte de La Marche, territoire voisin de l'Angoumois, s’en est plaint au roi de France, son suzerain (voir au par. 355 la carte des territoires plantagenêts). Philippe se garda de réagir sur le moment. Mais ce mariage forcé conduisait forcément à la guerre. Jean ne l'ignorait pas. Il se porta donc à l'attaque dès 1201 en envahissant le comté de La Marche et quelques places de la Touraine auparavant cédées au roi de France. Philippe Auguste, considérant que Jean avait rompu la paix du Goulet, renouvela alors son appui au jeune Arthur de Bretagne qui réclamait par droit d'héritage toutes les possessions françaises des Plantagenêts. En accord avec la coutume du temps, Philippe a ensuite convoqué Jean et Hugues de Lusignan à Paris pour le mois d'avril 1202, ceci afin de juger leur différend. Toutefois, le roi d’Angleterre a refusé de comparaître à la Cour du roi Philippe, comme il en avait pourtant l’obligation en raison de son statut de vassal sur le territoire français. Le 28 avril, Philippe a riposté en décrétant la commise, soit la confiscation de toutes les terres françaises du Plantagenêt. C’était ni plus ni moins qu’une déclaration de guerre. Et la guerre, comme de fait, recommença.
« How king John married queen Isabel » et « On the disagreement wich arose between the French and English Kings », id., pp. 187-188 et 203-204.
Par. 392 Le duc Arthur de Bretagne, à nouveau un pion utile dans le jeu du roi de France, a repris les armes contre son oncle le roi Jean d'Angleterre. Il a concentré son action au Poitou, pendant que Philippe Auguste envahissait le nord-est de la Normandie. Contrairement à son habitude, Jean a réagi avec promptitude et de manière décisive. Il a porté secours à sa mère Aliénor, alors assiégée par Arthur dans son château poitevin de Mirabeau. Jean a atteint le château à l’aube du 1eraoût 1202 et a remporté une brillante victoire. Il a capturé un grand nombre de prisonniers, incluant Arthur qu’il a immédiatement envoyé croupir dans une cellule du château de Rouen. Sa captivité a duré neuf mois. En effet, d’après l’homme de main de Jean, Guillaume de Briouse, le roi serait venu à Rouen pour y voir son neveu le 3 avril 1203. Intoxiqué, possiblement en colère en raison du refus d'Arthur de renoncer à ses prétentions, Jean l'aurait égorgé, avant de demander que l'on dispose de son corps dans la Seine. La nouvelle finira par se répandre dès le printemps de 1204. Si le roi Jean espérait briser son opposition, la fin tragique du duc a plutôt eu l’effet inverse en minant le peu de crédit que le roi possédait encore auprès de ses vassaux continentaux, dégoutés par un tel manquement à l’éthique chevaleresque. Désormais contraints de choisir entre la France et l’Angleterre, les seigneurs de Bretagne, d’Anjou, du Maine et de Touraine, ont majoritairement rallié le parti de la France, au risque de perdre les terres que certains possédaient de l’autre côté de la Manche.
Lire « On the death of Arthur, count of Britany », WENDOVER, id., pp. 205-206. Toutefois, le chroniqueur Wendover reste prudent quand il aborde les détails de la mort d’Arthur. Le récit exact du meurtre du duc, recueilli après la mort de Briouse, a été publié dans les cartulaires-rouleaux de l’abbaye de Margam, aujourd’hui entreposés au British Museum. On en trouve l'extrait pertinent dans ce livre écrit par un archiviste du musée : W. de GRAY BIRCH, A History of Margam Abbey, Derived from the Original Documents in the British Museum, H.M. Record Office, the Margam Muniments, Londres, Bedford Press, 1897, p. 176.
Par. 393 Jean a choisi de se retrancher en Normandie où il avait encore des appuis. Château Gaillard, une forteresse construite par Richard à grands frais dans le nord-ouest du duché, sur les bords de la Seine, lui a servi de poste de commandement. Il a élaboré un plan ingénieux mais difficile à appliquer pour briser son encerclement et ouvrir de nouvelles lignes d’approvisionnement par terre et par mer. Son plan ayant échoué, Jean a abandonné son château en septembre 1203 pour rejoindre la Bretagne, afin de tenter une nouvelle offensive. Ce fut un autre échec, le dernier avant son retour en Angleterre en octobre.
Château Gaillard reconstitution
De Vincent Lamy

Par. 394 Le départ de Jean a laissé le champ libre au roi de France. Philippe Auguste a saisi l’occasion pour achever sa conquête de la Normandie. Château Gaillard, assiégé pendant six mois, a été pris le 6 mars 1204. Voyant les progrès du Français, les citoyens de Caen ont offert de se rendre. Puis ceux de Rouen l’ont imité, non sans avoir souffert 40 jours de siège, ce qui a décidé leur défenseur Pierre de Préaux à signer une armistice le 1er juin, suivie par une reddition en bonne et due forme le 24 juin 1204. Arques et Verneuil ont fait de même. À l'exception de Dieppe, la Normandie était désormais entre les mains du roi de France. Mais Philippe n'avait pas encore dit son dernier mot. Il lui restait encore beaucoup à faire. La Bretagne, le Maine, la Touraine et l'essentiel de l'Anjou sont également tombés dans son escarcelle ou encore on changé d'allégeance. Après avoir reçu le message de Jean de n'attendre aucune aide de sa part, les derniers seigneurs de ces terres qui lui résistaient encore, les uns après les autres, ont fait la paix avec le roi de France avant la fin de l'année. À la mi-juillet 2005, date du départ de sa flotte, Jean a bien tenté de stopper l’hémorragie en commanditant une expédition éclair au Poitou, dans le nord de l’Aquitaine, mais qui s’est conclue par une autre défaite.
F.M. POWICKE, The Loss of Normandy, 1189-1204, Studies in the History of the Angevin Empire, Manchester, Manchester University Press, 1913, pp. 370, 374, 378 et 386-387. Lire également, pour la perte des autres terres, WENDOVER, préc. au par. 197, vol. 2, pp. 213-215.
Par. 395 Mais Jean n’a pas voulu renoncer. L’année suivante, donc en 2006, le roi a dirigé personnellement une autre expédition, cette fois plus au sud. Il est arrivé avec sa flotte à La Rochelle le 9 juillet et a été bien reçu par les habitants. Encouragé, Jean a parcouru ses terres d'Aquitaine et de Gascogne. Il y a capturé un grand nombre de châteaux et de cités, et obligé leurs habitants à se soumettre quand ceux-ci lui résistaient, tout en repoussant les armées menaçantes du roi de Castille sur sa frontière sud. C’est ainsi que Jean a réussi à conserver ses duchés méridionaux. L’Empire angevin avait cependant cessé d’exister, ne serait-ce qu’en raison de la perte de l’Anjou, la terre ancestrale des Plantagenêts. Pour la seconde fois depuis 1066, l’Angleterre devenait dès lors le principal lieu de résidence de son roi. Malgré ce récent succès, le pauvre Jean s’est vu affubler d’un nouveau surnom, encore moins flatteur que le précédent : Jean la Lame Molle (softsword en anglais), une manière, pour ses détracteurs, de souligner son peu d’adresse au combat.
WENDOVER, id., pp. 218-219. À vrai dire, celui qui, le premier, a employé le surnom de Jean la Lame Molle, Gervais de Cantorbéry, l'a fait au cours de l'année 1200, non pour médire, mais pour complimenter son roi, parce que celui-ci avait préféré négocier la paix plutôt qu'entreprendre une guerre avec son homologue français. Plus tard, le surnom a pris un autre sens, moins agréable. Lire R.V. TURNER, King John, England's Evil King ?, Stroud (Gloucester), The History Press, 1994, p. 24.
Par. 396. La seule ambition du roi Jean a été de reconquérir les territoires perdus aux mains de Philippe Auguste. Huit longues années lui ont été nécessaires à la préparation de sa prochaine contre-attaque. Parce que la guerre coûte cher, et que la perte de nombreuses possessions françaises avait diminué ses recettes, ses besoins d’argent l’ont obligé à augmenter considérablement les impôts et les taxes dès 2004. Et cette pression fiscale s’est accentuée au fur et à mesure que l’on se rapprochait de l’échéance de 1214.
Par. 397 Les pires abus ont porté sur l’écuage, le relief et une taille spéciale visant les juifs. Notons également que l’Église a été mise à contribution. L’écuage, cette taxe qui remplaçait le service militaire, avait été prélevé en moyenne une fois tous les 4 ans entre l’avènement d’Henri II et la mort de Richard. Or, Jean l’a exigée 11 fois en 17 ans de règne, tout en augmentant de beaucoup le taux de la taxe. Quant au relief, la taxe sur les successions, Jean a exigé des sommes énormes sans commune mesure avec les taux passés. John de Lacy, par exemple, s’est vu demander 4 500 livres ou 7 000 marks payables sur trois ans s’il voulait prendre possession de son héritage. Et Nicholas Stuteville, ainsi que Guillaume fitz Alan, ont dû pour leur part débourser la somme incroyable de 6 000 livres ou 10 000 marks pour succéder à leur père. Comble de l’ignominie, Jean a fait emprisonner et torturer les juifs d’Angleterre pour leur soutirer une taille spéciale valant 44 000 livres, ou 60 000 marks, soit plus d’une année normale de revenus pour la Couronne. Certes, en raison des préjugés qui les affligeaient, on considérait normal de soumettre les juifs à un régime spécial, mais Jean avait dépassé la mesure socialement acceptable pour les autres. Tous ceux qui refusaient de payer étaient emprisonnés et leurs biens saisis. Le roi a même pris des otages afin de garantir le recouvrement des montants réclamés.
En général, lire RAMSEY, préc. au par. 271, pp. 245-252. Voir aussi WENDOVER, préc. au par. 197, p. 208-209 (taxe spéciale sur les biens meubles des nobles en 1204), p. 252-253 (taxe sur les juifs en 1210), ainsi que l'excellente biographie rédigée par S. PAINTER, The Reign of King John, Baltimore, John Hopkins Press, 1949, pp. 220-221, sur les reliefs exigés par Jean.
Par. 398 Taxer outrageusement les juifs, une minorité méprisée, comportait peu de risques. Il en allait autrement de la perception des autres sommes, surtout l’écuage. En effet, croyant que leur obligation militaire se limitait à défendre le sol anglais, notamment sa frontière avec l’Écosse, les barons du nord de l’Angleterre ont hésité avant de délier les cordons de leur bourse, cela pour récupérer la Normandie et l’Anjou, des terres étrangères à leurs yeux. S’ils ont néanmoins accepté de payer l’écuage entre 1206 et 1213, plusieurs ont refusé de suivre Jean lorsque, le 9 février 2014, celui-ci a levé les voiles en direction du Poitou. Jean savait qu'ils comploteraient contre lui en son absence.
RAMSEY, id., p. 253. PAINTER, id., pp. 280-281.
Par. 399 Jean avait connu d’autres difficultés auparavant, cette fois avec l’Église. Leur mésentente, qui a rapidement dégénéré en conflit, a débuté à l’occasion de l’élection du nouvel archevêque de Cantorbéry à la fin de 1205. Deux factions, les moines de la cathédrale de Cantorbéry d’un côté, des évêques de l’autre, voulaient chacune former le collège électoral, en plus de Jean qui entendait bien influencer le vote. Afin de dénouer l’impasse, le roi a négocié un compromis portant sur les modalités de l’élection : l’archevêque serait choisi par les moines, puis confirmé par les évêques réunis en synode. En présence du roi, son candidat, l’évêque Jean Grey de Norwich, a été élu le 11 décembre. Immédiatement intronisé, il a pris possession des biens du siège épiscopal. Des moines mécontents se sont rendus à Rome plaider leur cause devant le pape Innocent III. Celui-ci a annulé l’élection de Grey et ordonné une enquête. Celle-ci terminée, le pape a alors jugé que seuls les moines avaient le droit de choisir l’archevêque. Il a suggéré dans l’instant un candidat qu’il souhaitait plus consensuel, Étienne Langton, un cardinal anglais appartenant à sa Cour, puis a ordonné aux moines venus présents à Rome de procéder immédiatement à son élection, sous peine d’excommunication. Ceux-ci ont bien sûr obéi. Nous étions arrivés en décembre 1206. Les émissaires de Jean sont arrivés dans la Ville éternelle au printemps suivant pour manifester le mécontentement du roi, et avertir le pape qu’il refusait le choix de cet inconnu fait en violation des libertés de l’Église d’Angleterre. Le 17 juin 1207, Innocent III a défié le roi en procédant à l’intronisation de Langton. Jean a exilé et saisis les biens des moines coupables d’après lui de trahison.
W. FARQUHAR HOOK, Lives of the Archbishops of Canterbury, vol. 2, Londres, Richard Bently, 1862, pp. 665-671.
Par. 400 Une lutte s’est immédiatement engagée entre les protagonistes. Innocent III, ou plutôt ses commissaires, ont proclamé un interdit suspendant les services religieux dans toute l’Angleterre et l’Irlande en mars 1208, et comme le pape n’obtenait pas encore le résultat voulu, il a autorisé l’excommunication de son roi en novembre 1209. Sur quoi Jean a répondu en expropriant les biens de l’Église. Il avait cependant oublié que son excommunication le rendait particulièrement vulnérable, ses vassaux n’étant plus tenus par leur serment envers lui. C’était une grave erreur. Lorsque Jean, en mai 1213, a eu vent d’un complot de ses barons et du projet du roi de France d’envahir l’Angleterre, il s’est donc empressé de faire la paix avec le pape. Mais voilà ! Le pape y a mis des conditions, auxquelles le roi a dû se plier. Ce dernier a d'abord accepté l’élection de Langton. Puis il a redonné à l'Église ses biens, non sans en conserver une partie. Enfin, pour mieux assurer la protection de ses royaumes, Jean a déclaré, le 15 mai, qu’il tenait désormais l’Angleterre et l’Irlande en fiefs du Saint-Siège, qu’il devenait conséquemment le vassal du pape. Un Innocent III satisfait a réintroduit Jean dans la communauté des croyants en 1213 et levé l’interdit en 1214.
FARQUHAR HOOK, id., pp. 672-675, 683-685, 692 et 707-708; John’s surrender of his kingdoms of England and Ireland to the pope, May and October 1213, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, pp. 307-310.
Par. 401 Les mauvaises relations de Jean avec ses hauts barons et la noblesse en général l’avaient rendu encore plus méfiant qu’à l’habitude. Puisqu’il devait vivre en Angleterre après la perte de l’Anjou et de la Normandie, en 1204, il a voulu faire renaître la Cour du roi dans son rôle d’institution rendant justice en présence du roi, coram rege, ce qui lui permettait de surveiller de plus près le règlement des litiges, surtout ceux qui concernaient davantage la Couronne. Nous avons vu que de tous temps, voire même avant la conquête normande de 1066, le souverain pouvait rendre justice en personne, entouré de quelques hauts personnages. La différence ici est que Jean a nommé des juges, des professionnels du droit, quoique des hommes de confiance, qui devaient l’accompagner et l’assister lors de ses déplacements en Angleterre. Ceux-ci siégeaient ensemble et rendaient justice au nom de la Cour du roi, avec toute l’autorité que cela comportait. Jean leur a demandé de tenir des archives, une autre innovation qui démontrait son intention de faire de la nouvelle cour coram rege une institution permanente. Elle ne cessera de gagner en importance, au point d’éclipser la Cour des plaids communs à Westminster. Évidemment, comme elle constituait une cour en présence du roi, elle devait cesser ses activités momentanément dès que le roi s’absentait de l’Angleterre pour se rendre en Irlande ou sur le continent.
TURNER, préc. au par. 383, pp. 244-247; F.B. WIENER, « Tracing the Origins of the Court of King's Bench », (1973) vol. 59 American Bar Association Journal 753, p. 754.
Par. 402 Peut-être le roi, déjà soupçonneux de nature, voulait-il concentrer tous les pouvoirs entre ses mains ! On sait qu’il a ordonné à la Cour des plaids communs de cesser toute activité en 1209. Ce geste lui a été reproché par ceux, et ils étaient nombreux, qui trouvaient utiles d’avoir accès à une cour royale de justice siégeant dans un lieu fixe, en l’occurrence au palais de Westminster. Car les juges qui y siégeaient, au moins depuis la naissance des Plaids communs en 1196 sous le règne de son frère Richard, étaient également des professionnels du droit et rendaient donc une justice à peu près équitable, hors les cas de corruption. La Cour des plaids communs ne siégera à nouveau qu’après février 1214, lorsque le roi tentera de reconquérir ses terres continentales.
TURNER, id., pp. 247-248.
Par. 403 Les principaux alliés du roi d’Angleterre, lors de son offensive de 1214, demeuraient les membres normands et angevins de son entourage qui avaient beaucoup perdu lors de sa première confrontation avec Philippe Auguste. Car ceux-ci espéraient recouvrer leurs terres françaises. Mais Jean s’est montré égal à lui-même, autrement dit un piètre général. Au mois de juillet 1214, le dauphin Louis, fils de Philippe, a remporté une première victoire sur les armées anglaises à Roche-aux-Moines, en Anjou, puis son père a battu à son tour la coalition anglaise à Bouvines, près de Lille dans le Pas-de-Calais. Jean a dû se résigner à signer une autre trêve le 11 septembre avant de regagner son île en octobre, plus humilié que jamais.
RAMSEY, préc. au par. 271, pp. 453-254.
Par. 404 Dès son retour, Jean a exigé de nouvelles contributions, un versement d’écuage des barons et un versement de la taille des tenanciers roturiers, le premier pour défrayer les coûts de sa dernière campagne, le second pour la levée de l’interdit prononcé par le pape (il s’agissait de rembourser à l’Église les montants injustement saisis). Une majorité de mécontents s’est rebiffée. Les plus dangereux se trouvaient être les barons. La révolte grondait. On a crié à l’oppression. Si au moins Jean avait gagné comme son frère Richard, on lui aurait peut-être pardonné. Seul le succès pouvait excuser les impôts et les taxes des huit dernières années.
RAMSEY, ibid.; D. CARPENTER, « Magna Carta : its Social and Political Context », dans L. Goldman (éd.), Magna Carta, History, Context and Influence, Londres, University of London Press, 2018, pp. 17 à 24.
Par. 405 Pendant l’hiver 1214-1215, le mécontentement général s'est transformé en rébellion. Le roi Jean, pour sa part, avait commencé à réunir des troupes sur le sol anglais, avec l’idée de punir les barons qui avaient refusé de le suivre en France. Jean ne faisait pas mystère de ses intentions; d’après Matthieu Paris, chroniqueur et moine bénédictin du XIIIe siècle, il aurait déclaré « haïr, comme le sang des vipères, la noblesse du royaume, spécialement Saer de Quincy, Robert Fitzwalter, ainsi que l’archevêque Étienne de Cantorbéry ». Le temps pressait. Plusieurs barons, flairant la menace, ont donc pris les devants et dénoncé leur allégeance au roi, le 5 mai 1215, puis ont marché sur Londres et capturé sa fameuse Tour. D’autres barons les ont rejoints. Contraint de négocier, avec l’idée de gagner du temps car il n’était pas prêt, le roi s’est rendu en juin dans la plaine de Runnymède, près de la cité de Windsor, afin d’y signer le 15 juin 1215 une charte reconnaissant les droits et libertés de ses sujets. C’est le document connu aujourd’hui sous le nom de Magna Carta ou Grande Charte en français. On l’appela la Grande Charte pour la distinguer de la Charte des forêts adoptée la même année. Par une étrange ironie, Étienne Langton, auquel Jean s’était opposé quand le pape l’avait désigné pour être l’archevêque de Cantorbéry, et entretemps devenu le porte-parole des barons, avait porté à leur connaissance la Charte de couronnement du roi Henri Ier qui a inspiré les rebelles.
FARQUHAR HOOK, préc. au par. 399, pp. 716-718; M. PARIS, Grande Chronique de Matthieu Paris, Paris, Paulin, Libraire-Éditeur,1840, tome 2, pp. 475-476 et 527-531, et tome 3, p. 5. Notez que je n’ai pas retrouvé dans la Chronique de Mathieu Paris la citation du roi Jean que Farquhar Hook lui a prêtée dans son livre.
Signature de la Magna Carta à Runnymède le 15 juin 2015
Photo : Universal History Archives/U/REX

Par. 406 La Magna Carta aura une influence considérable et durable sur le développement ultérieur du droit constitutionnel anglais. Et pourtant, la seule intention des barons était que le roi reconnaisse l’intangibilité de leurs droits et libertés en vertu des coutumes féodales existantes. En effet, quand l’archevêque Langton a rejoint à Londres les évêques, abbés, prieurs, doyens et barons du royaume réunis dans la cathédrale de Saint-Paul, en août 1214, il leur a parlé de rétablir dans leur ancien état « vos libertés depuis longtemps perdues ». Plus tard, pendant la seconde semaine de janvier 1215, les barons, habillés en tenue de combat, l’ont d’ailleurs argumenté avec force devant un Jean inquiet, lors d'une rencontre improvisée, après que le roi se soit réfugié au Temple Neuf de Londres (Novum Templum, plus tard appelé Temple Church). Rappelons que c’était l’ancienneté d’une règle de droit qui lui conférait sa valeur. La Grande Charte se voulait donc l’opposé d’un document révolutionnaire. Certes, Jean aurait pu contester l'affirmation des barons qu'il s'agissait d'un simple retour au droit antérieur. Seulement, dans ce monde autrefois gouverné par des coutumes non écrites au contenu parfois incertain, les interprètes jouissaient immanquablement d’une marge de discrétion, que les barons entendaient exercer à leur avantage.
PARIS, tome 2, id., pp. 472-473 et 528; PAINTER, préc. au par. 397, p. 300.
Par. 407 L’opposition entre Jean et les barons anglais ne portait pas sur l’existence d’un droit régissant le royaume, mais sur la lecture qu’on en faisait. Et la victoire des seigneurs anglais leur a permis d’imposer leur vue. Or, ils entendaient corriger ce qu’ils croyaient être les abus des 60 ans du régime des Plantagenêts, soit l’application de mauvaises coutumes ou l’application erronées de coutumes existantes, surtout celles concernant les impôts et les taxes prétendument abusifs, sans oublier les emprisonnements injustifiés qui les accompagnaient. Afin d’accroître leur soutien parmi la population, les barons ont pris en compte les doléances des clercs, de la petite noblesse, des paysans aisés et des commerçant fortunés, en somme de tous ceux dont l’opinion comptait.
Par. 408 La Magna Carta remettait à l’ordre du jour le caractère contractuel de la royauté, apparent sous les rois anglo-saxons, puis réaffirmé par les normands Henri Ier Beauclerc et Étienne de Blois dans leur charte de couronnement. Cela signifiait qu’un roi devait sa Couronne au consentement des grands du royaume et non à une quelconque intervention divine. Le consentement pouvait être révoqué si le roi ne respectait pas ses engagements pris sous serment, ont donc conclu les barons et leur suite. À l’article 61 de la Magna Carta, Jean reconnaissait d’ailleurs aux barons le droit de se soulever contre leur roi, si lui ou l’un de ses héritiers violait les droits et libertés qu’il venait de leur accorder ou de confirmer à perpétuité. Une commission de 25 barons était établie pour veiller à leur respect. Les articles les plus importants de cette charte, eu égard à l’évolution constitutionnelle anglaise et aux sujets de mécontentement cités plus haut, se résumaient ainsi :
- L’Église d’Angleterre jouira de tous ses droits et libertés et élira librement ses prélats (art. 1).
- Le relief a été fixé à 100 livres pour un fief de baronnie et à 5 livres ou 100 shillings pour un fief de chevalerie (art. 2).
- Aucun écuage ou aide ne sera levé sans le consentement du Conseil commun du royaume, à moins que ce ne soit pour payer la rançon du roi, armer son fils aîné chevalier ou marier sa fille aînée (art. 12).
- Le Conseil commun du royaume réunira les prélats et hauts barons, convoqués individuellement par le roi, et d’autres barons que les shérifs et autres officiers de la Couronne informeront. Le roi donnera les raisons de leur convocation et les membres présents décideront les questions soulevées à la majorité (art. 14).
- Les plaidoyers ordinaires ne suivront plus la Cour du roi mais seront entendus dans un endroit précis. Sans le préciser, tous comprenaient que le lieu évoqué était Westminster, à la Cour des plaids communs (art. 17).
- Toute amende devra être proportionnelle à l’infraction commise, sans aller jusqu’à priver la personne reconnue coupable de son gagne-pain. Elle ne pourra être imposée sans le témoignage sous serment d’hommes honnêtes et justes du voisinage (art. 20).
- Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays (art. 39.
- Le droit d’obtenir justice ne sera pas vendu, ni refusé ou différé (art. 40)
- Tous les marchands pourront librement et en toute sécurité sortir d’Angleterre ou entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement, tant par les voies terrestres que maritimes, excepté lorsque les marchands proviennent d’un pays en guerre contre l’Angleterre (art. 41).
Huillard-Bréholles, qui a traduit en français la Grande chronique de Matthieu Paris, a aussi rédigé une excellente version française de la Magna Carta de 1215 dans le tome 3 de la chronique, préc. au par. 405, pp. 7 à 22. On peut aussi consulter notre traduction en annexe.
Par. 409 Jean n’entendait pas respecter ses promesses. La rencontre à Runnymède n’était pour lui qu’une manœuvre dilatoire. Voilà pourquoi il en a immédiatement appeler au pape Innocent III pour se sortir de ce mauvais pas. Jean se doutait que le pape, lui-même jaloux de ses prérogatives de seigneur féodal, n’accepterait jamais les principes qui sous-tendaient la Magna Carta. Dans une bulle datée du 24 août 1215, Innocent III déclara donc, sans surprise, que ce document était nul et sans effet. Les Anglais n’ont pris connaissance de la bulle pontificale que vers la fin de septembre. Cette nouvelle relança les hostilités entre Jean et ses barons.
Pope Innocent III declares Magna Carta null and void (1215), E.H.D., vol. 3 (1189-1327), édition de 1975, pp. 324-326.
Bulle pontificale d’Innocent III annulant la Magna Carta
British Library Cotton MS Cleopatra E I, ff. 155-156

Par. 410 Jean a concentré ses mouvements de troupe dans les comtés des rebelles au nord et à l’est de l’Angleterre. Les barons ont alors demandé l’aide du roi Philippe Auguste et de son fils le dauphin Louis. Le 22 mai 1216, encouragé par les deux tiers des barons anglais qui souhaitaient en faire leur roi, Louis a débarqué sur les côtes anglaises et occupé le sud-ouest du pays et sa métropole Londres, des bastions de la résistance au roi. Jean a immédiatement voulu reprendre l’offensive. Malheureusement pour lui, une attaque de dysenterie l’en a empêché. Il est mort dans le comté de Nottingham au cours de la nuit du 18 au 19 octobre 1216. La suite, sur laquelle nous reviendrons, dépendra de Guillaume le Maréchal, le plus célèbre et le plus grand chevalier que l’Angleterre ait jamais connu, ainsi qu’un ministre influent à la Cour d’Angleterre.
Par. 411 La mort de Jean sans Terre a clos un chapitre de l’histoire de l’Angleterre. Car l’Empire angevin n’existait plus après la perte de l’Anjou, la terre ancestrale de la famille plantagenêt. Mais la Magna Carta, auquel le nom de Jean restera à jamais associé, lui survivra, et représentera même son héritage, peu importe ce que son auteur en pensait.
Carte 10

Par. 412 La Magna Carta imprègnera effectivement les consciences. Plusieurs de ses clauses s’inscriront assez rapidement dans le droit anglais. Son influence persistera, même si le nom de Magna Carta ne sera plus mentionné. Et puis, après des siècles d’oubli, la Magna Carta connaîtra une seconde vie sous le règne des rois de la maison des Stuarts. En effet, le célèbre Edward Coke, juge en chef de la Cour du banc du roi et auteur prolifique, ainsi que des hommes politiques qui instrumentaliseront ses écrits, combattront l’absolutisme de Charles Ier (règne 1625-1649) en invoquant tous les arguments imaginables, à la condition qu’ils apparaissent raisonnables. Pour servir leur dessin, ils vont réinterpréter la Magna Carta en versant dans l’anachronisme, non sans ressemblance avec une méthode d’interprétation qui a cours actuellement dans les pays où une constitution écrite existe; on y compare un texte constitutionnel à un organisme vivant, dont l’interprétation doit évoluer afin de l’adapter aux nouvelles réalités, même si celles-ci n’étaient nullement envisageables au moment de l’adoption du texte en cause. L’attention de l’interprète porte alors sur les principes sous-jacents qui ont guidé sa rédaction. Or, la Grande Charte contenait certainement deux principes utiles à la gouvernance de l’Angleterre : le premier exigeait du roi qu’il rende justice conformément aux lois du royaume; le second voulait qu’il gouverne en consultation avec ses sujets. Ces deux principes orienteront l’évolution constitutionnelle du royaume anglais.
G. GARNETT, «Sir Edward Coke’s Resurrection of Magna Carta », dans L. Goldman (éd.), Magna Carta, Londres, University of London Press, 2018, pp. 51-60; J. BAKER, The Reinvention of Magna Carta 1216-1616, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 335-409 (Sir Edward Coke and Magna Carta 1606-1615). Lire aussi Edwards v. Canada (Attorney General), [1930] AC 124, 1929 CanLII 438, ou [1930] 1 D.L.R. 98, aux pp. 106 et 107 des Dominion Law Reports, où le Comité judiciaire du Conseil privé du Royaume-Uni, alors qu’il interprétait la Constitution du Canada, a écrit : « [Traduction] L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique a planté au Canada un arbre vivant capable de croître et de s’étendre à l’intérieur de ses limites naturelles. L’objet de cette loi était de conférer une Constitution au Canada. Et comme toutes les constitutions écrites, elle a vocation à se développer conformément aux usages et aux conventions. » On peut également consulter la décision de la Cour suprême des États-Unis dans McCulloch v. Maryland (1819), 17 US 316.
8. Constitution sous l'Empire angevin
8.1 Succession: apparition de la coutume de primogéniture
Par. 413 À la fin du chapitre 5, nous avons vu Mathilde, l’héritière désignée par son père Henri Ier pour lui succéder, refuser le verdict des grands qui avaient placé son cousin Étienne de Blois sur le trône d’Angleterre. Et une guerre s’ensuivit. Le fils aîné de Mathilde, Henri Plantagenêt, a finalement négocié avec Étienne le Traité de Winchester qui le désignait comme le prochain héritier de la Couronne. Après la mort d’Étienne, le Plantagenêt, en accord avec les dispositions du traité, lui a succédé sous le nom d’Henri II (règne 1154-1189). La lignée des Plantagenêts durera 331 ans, jusqu’à la mort de Richard III en 1485.
Par. 414 Lorsqu’Henri II a voulu partager ses terres entre ses enfants, le droit des successions semblait toujours incertain. L’ancienne façon de procéder, commune aux peuples d’origine germanique tels que les Francs, les Angles, les Jutes ou les Saxons, avait été de considérer un royaume comme s’il s’agissait d’une propriété privée, que l’on pouvait diviser à volonté au profit de sa descendance. Toute construction politique s’en trouvait fragilisée. L’Empire franc de Charlemagne, par exemple, n’a pu survivre à son fondateur parce que celui-ci s’est cru obligé de répartir ses États entre ses trois enfants. Une variante de cette coutume s’est développée en Angleterre et au nord de la France, incluant la Normandie. Elle a été appelée la coutume du parage.
Par. 415 En vertu de la coutume du parage, un roi ou quelque autre grand seigneur partageait toujours ses terres entre ses enfants, mais préservait l’unité de la famille en inféodant les cadets au frère aîné. Les plus jeunes devaient donc rendre l’hommage et jurer fidélité à l’aîné pour toutes les terres reçues en héritage. Henri II semble avoir favorisé cette coutume lors du plan de partage élaboré en 1169 entre ses trois premiers fils, car il insistera pour que Richard et Geoffroy rendent l’hommage à leur ainé Henri le Jeune, celui qui avait été couronné roi du vivant de son père, en 1170, sans avoir jamais régné. En janvier 1183, lorsque mis en demeure par leur père de s’exécuter, Geoffroy a accepté en rendant l’hommage pour la Bretagne. Toutefois, un Richard en colère a refusé, car se dire le vassal du futur roi d’Angleterre pour son duché d’Aquitaine, une terre française, aurait voulu dire qu’il serait abaissé au second rang dans l’ordre féodal, derrière son frère qui serait lui-même inféodé au roi de France.
L’altercation entre Richard et son père Henri II nous a été racontée par Roger de Wendover, moine et chroniqueur du début du XIIIe siècle, dont l’œuvre est une compilation des écrits de Jean de Cella (ou de Wallingford), abbé de Saint-Alban de 1195 à 1214. Lire WENDOVER, vol. 2, préc. au par. 197, p. 52, ainsi que la description de la coutume du parage par R.V. TURNER, « The Problem of Survival for the “Angevin Empire”: Henry II’s and His Sons’ Vision versus Late Twelfth-Century Realities », (1995) vol. 100 The American Historical Review 78, pp. 83-87.
Par. 416 Quoi qu’il en soit, ce plan est devenu caduc avec la mort prématurée d’Henri le Jeune la même année, six ans avant le vieux roi. Henri II a refusé par la suite de désigner un nouveau successeur. Richard, maintenant l’aîné, et l’héritier présomptif, s’en est inquiété, et non sans raison, parce qu’il existait une autre interprétation de la coutume du parage. Connue et même appliquée en Angleterre depuis 1066, elle aurait pu empêcher Richard de ceindre la Couronne d’Angleterre.
Par. 417 En effet, d’après cette autre interprétation de la coutume, le père transmettait à son aîné les terres dont il avait lui-même hérité, dans ce cas certainement l’Anjou avec le Maine et la Touraine qui lui sont associés, mais disposait librement des autres domaines acquis de son vivant, dont l’Angleterre faisait partie. Si Henri II l’avait envisagé sérieusement, il aurait pu céder l’Angleterre à Jean, son fils favori, et ne laisser à Richard que la terre ancestrale de la famille en Anjou. Ce dernier, en prenant les armes contre son père, ne lui a pas laissé le choix. Peu importe ce qu’en pensait Henri II, Richard garderait pour lui à la fois l’Angleterre, l’Anjou et éventuellement tout le reste de l’Empire angevin.
TURNER, ibid.
Par. 418 On s’est posé à nouveau la question du droit applicable aux succession lors du décès de Richard en avril 1199. Sur son lit de mort, le roi a exprimé le désir de léguer sa Couronne à son frère Jean. La désignation d’un héritier importait donc encore, croyait-il, que ce soit en application de la tradition anglo-saxonne ou de la version de la coutume du parage défendue par son père Henri II. Cependant, ses ministres n’en étaient pas tous convaincus.
Par. 419 Après la mort du Cœur de Lion, Guillaume le Maréchal a rencontré l’archevêque de Cantorbéry, Hubert Walter, afin d’examiner les revendications respectives des deux prétendants, le prince Jean et son neveu le duc Arthur de Bretagne, âgé de seulement 15 ans. L’archevêque croyait qu’Arthur avait préséance en raison du droit supérieur de son père Geoffroy, le frère aîné de Jean, ceci d’après la coutume de primogéniture ou droit du premier né, qui avait cours parmi la noblesse (voir l’arbre généalogique des premiers Plantagenêts au paragraphe 373). Pour sa part, Guillaume le Maréchal lui préférait Jean, non pour quelque motif d’ordre juridique, mais après une lecture politique des enjeux entourant la succession : il ne voulait pas d’un roi qui serait le patin de Philippe de France. Comme de fait, Arthur avait grandi à la Cour du roi Philippe, d’ailleurs son principal soutien avec les seigneurs de Bretagne et d’Anjou. Après avoir consulté et obtenu l’adhésion de la reine Aliénor, Guillaume n’a donc éprouvé aucune difficulté à rallier les suffrages des commandants militaires anglais et normands, des appuis plus que suffisants pour couronner le prince Jean le 27 mai 1199.
WENDOVER, vol. 2, préc. au par. 197, pp. 179-180; D. CROUCH, William Marshall, Knighthood, War and Chivalry, 1147-1219, 2e éd., Londres, Pearson Education, 2002, p. 85; H.E. LEEMAN, Lives of England’s Reigning and Consort Queens; England History through the Eyes of its Queens, Bloomington (Indiana), AuthorHouse, 2011, p. 88.
Par. 420 Les barons, afin d’écarter toute contestation, ont cité le principe de l’élection par la noblesse d’Angleterre pour légitimer leur choix, un rappel de l’élection par le Witan anglo-saxon, une pratique abandonnée un siècle et demi auparavant par Guillaume le Conquérant. Il n'empêche que, lors du couronnement, le prêtre officiant, l’archevêque Hubert, insista sur ce fait en déclarant tout haut afin d'être entendu : « Tous tant que vous êtes, écoutez. Que votre prudence sache que nul n’a de royaume en succession par droit acquis, s’il n’est élu unanimement, sous l’invocation de la grâce de l’Esprit saint, par la totalité du royaume (…) ».
Ces paroles ont été citées par Mathieu PARIS, ce chroniqueur et moine bénédictin du XIIIe siècle, préc. au par. 405, dans le tome 2 de sa chronique, à la p. 306.
Par. 421 Ce qui compliquait la situation, lors du règne des premiers Plantagenêts, est que les autres princes et grands seigneurs du XIe siècle avaient progressivement abandonné la tradition franque de diviser leurs possessions entre leurs héritiers, pour lui préférer la dévolution par primogéniture mâle, ceci afin de conserver intact le patrimoine familial. Certes, les cadets recevaient parfois quelques domaines, ou leur père prévoyait un mariage avec une héritière fortunée ou encore un poste important au sein de l’Église, mais rien qui pouvait compromettre l’avenir.
TURNER, préc. au par. 415, p. 83.
Par. 422 L’antériorité de la naissance, dans la succession par primogéniture mâle, déterminait l’ordre de succession de manière automatique, en donnant préséance au sexe masculin. Au décès d’un roi, le premier-né de la branche aînée de la famille héritait du tout. Celui-ci était normalement le fils aîné du roi défunt. Mais s’il mourait avant son père, il transmettait son droit à son propre enfant, le petit-fils du roi. Une telle succession où l’on saute une génération s’appelle une succession par représentation. Richard II (règne 1377-1399) a ainsi succédé à son grand-père Édouard III (règne 1327-1377), tout comme George III (règne 1766-1820) l’a fait après le décès de George II (règne 1727-1760). Lorsqu’un roi n’engendrait que des filles, c’est la fille aînée qui devenait l’héritière présomptive. Le dernier exemple est celui d’Élisabeth II (règne 1942-2022) qui est montée sur le trône après le décès de son père George VI (règne 1936-1952). Et quand un roi, ou une reine, mourait sans descendance, on devait lui trouver un héritier parmi ses parents collatéraux, ses frères ou sœurs et leurs enfants, en respectant le même ordre de naissance, toujours en donnant priorité au sexe masculin. Marie Ière (règne 1553-1558) a succédé à son frère Édouard IV (règne 1547-1553), avant qu’Élisabeth Ière (règne 1558-1603) la suive à son tour, puis Jacques II (règne 1685-1688) a ceint la Couronne après son frère Charles II (règne 1660-1685), et Guillaume IV (règne 1830-1837) après son frère George IV (règne 1820-1830). George VI a également succédé à son frère Édouard VII (règne 1936, 11 mois) après son abdication. Il est arrivé qu’un roi ou une reine soit le dernier survivant de sa famille immédiate, donc sans enfant, ni aucun frère ou sœur survivant, ni aucun neveu ou nièce. Lors du décès d’Élisabeth Ière, en 1603, il a fallu remonter à son grand-père Henri VII pour identifier une nouvelle branche aînée de la famille royale dans les descendants de sa fille Marguerite, dont le petit-fils est devenu Jacques Ier d’Angleterre (règne 1603-1625), premier roi de la maison de Stuart. De même, à la mort de la reine Anne (règne 1702-1714) qui a marqué la fin de la maison de Stuart, il a fallu remonter à son arrière-grand-père Jacques Ier pour trouver une nouvelle branche aînée dans les descendants protestants de sa fille la princesse Élisabeth, dont le petit-fils est devenu George Ier (règne 1714-1727), premier roi de la maison de Hanovre. Le Parlement avait écarté entre-temps tous les prétendants de foi catholique pour mieux lui ouvrir la voie.
Par. 423 La coutume de primogéniture, à quelques exceptions près, est le droit qui a régi la succession à la Couronne d’Angleterre depuis le règne d’Henri III. De 1216 à 1399, six générations de descendants de Jean sans Terre l'ont suivi sur le trône d’Angleterre en respectant strictement l’ordre de primogéniture, au point que l’on croyait cette coutume fermement établie. Henri IV, duc de Lancastre, l’a pourtant enfreint en 1399 en se faisant couronner aux dépens de la branche aînée des Plantagenêts, la famille du duc de Clarence, juste après avoir contraint Richard II à abdiquer. Cela a causé un grand dommage à la Couronne et a affaibli l’institution de la monarchie. Doutes et conflits sur la succession ont persisté pendant longtemps, jusqu’au jour, en 1485, où le Parlement, pas du tout gêné par son raisonnement circulaire, a déclaré que le Tudor Henri VII était roi parce qu’il était effectivement le roi.
Statut confirmant le titre de roi (Titulus Regis), 1 Hen. 7, c. 1. Lire également E.H.D., préc. au par. 69, vol. 4 (1327-1485), 1969, partie III, The Governement of the Realm, Introduction, p. 354.
Par. 424 Henri II avait retiré de son serment de couronnement toute allusion concernant l’importance d’obtenir l’accord de la noblesse, comme l’avaient mentionné ses prédécesseurs Henri Ier et Étienne. Sa seule hérédité devait emporter l'adhésion de tous. Le Plantagenêt a donc préféré se faire appeler « roi par la grâce de Dieu ». Avec lui, on était donc passé d’une royauté fondée sur le consentement des grands ou plus largement du peuple à une royauté fondée sur la volonté du divin.Théoriquement, le roi, une fois sacré, devenait un personnage inviolable qui ne devait rendre des comptes qu’à Dieu, certainement d’après l’opinion de Richard fitz Nigel, le trésorier du même Henri II à qui il devait sa nomination.
FITZ NIGEL, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, p. 524.
8.2 Portrait d'ensemble des pouvoirs du roi: un régime de confusion des pouvoirs
Par. 425 Semblable en cela aux rois normands, le souverain angevin, que ce soit Henri II Richard ou Jean, possédait en principe tous les pouvoirs de puissance publique : le droit de légiférer, le droit d’appliquer les lois et le droit de juger, pouvoirs qu’il devait exercer conformément aux coutumes du royaume et aux promesses contenues dans sa charte de couronnement. Un Henri II prudent avait cependant pris garde, lors de son couronnement en 1154, de ne garantir que les seuls droits reconnus par grand-père Henri Ier, en omettant le règne de son prédécesseur immédiat, le roi Étienne, pendant lequel les hauts barons avaient beaucoup rogné sur les prérogatives de la Couronne.
Par. 426 Au moment de son élévation à la magistrature suprême, Henri II entendait donc rappeler à la mémoire de ses contemporains les institutions et les précédents établis par Henri Ier, lorsque le royaume avait achevé un fort degré de centralisation. Car il lui fallait ménager l’opinion publique à cette époque où l’innovation choquait, et démontrer qu’il gouvernerait en vertu de principes déjà suivis et acceptés lors des règnes précédents. Cela n’empêchera pas toute évolution. Seulement, l’évolution devra être camouflée, prendre d’anciens habits pour la rendre méconnaissable ou tout au moins imperceptible. Henri II innovera surtout dans le domaine de la justice. Ses fils Richard Ier et Jean, ainsi que son petit-fils Henri III, poursuivront son œuvre.
Par. 427 Pendant les règnes des premiers Plantagenêts, la Cour du roi est demeurée l’organe central du gouvernement de l’Angleterre. On a vu cependant apparaître l’amorce d’une décentralisation dans l’exercice des pouvoirs de puissance publique. En effet, ces rois ont délégué en partie l’autorité de leur Cour à différents organismes judiciaires, principalement des juges itinérants, la Cour de l’Échiquier et la Cour des plaids communs. Ils ne possédaient pas encore d’identité propre. Ils agissaient toujours au nom de la Cour du roi et leur justice demeurait la justice du roi. Et pourtant, sans avoir changé de nature, la justice du roi avait été étendue à tout son royaume et rendue accessible à la petite noblesse comme aux bourgeois, paysans aisés et commerçants. Il s’agissait d’une réforme structurelle qui a rendu possible l’éclosion d’un droit nouveau. Nous avons déjà évoqué l’existence de ce droit qui a été appelé de différentes façons à différentes époques et dans différentes langues : on a dit tour à tour lex terrae, communem legem, commune ley et finalement common law. En découplant la justice royale de la personne du souverain, les réformes d’Henri II, qui seront suivies par d’autres sous les règnes de ses successeurs immédiats, ont également contribué à renforcer la notion même du droit, et de l’intangibilité des coutumes lui servant de véhicule, en leur conférant une existence indépendante de la volonté du monarque. Un autre changement, arrivé sur le tard durant le règne de Jean, a été la mise en place d’un droit écrit, la Magna Carta, qui devait préciser et codifier les coutumes se rapportant aux pouvoirs de la Couronne, autrement dit aux prérogatives royales. Il s’est alors développé dans la conscience populaire l’idée qu’il existait une Constitution s’imposant à tous, incluant le roi.
Par. 428 On le voit dans les écrits des grands juristes de l’époque, notamment les Jean de Salisbury (1115-1180) et Ranulf de Glanville (1125-1190). Ceux-ci s’accordaient dorénavant sur l’obligation faite au roi de respecter le droit et les libertés de son peuple. Henri de Bracton, juge sous le règne d’Henri III (1216-1272), s’est montré encore plus précis sur la relation entre le roi et la loi : « [Traduction] Le roi ne doit pas se soumettre à aucun homme mais seulement obéir à Dieu et à la loi, parce que c’est la loi qui fait le roi ». Le peuple, de plus en plus en accord avec cette lecture de leur Constitution, rappellera leur devoir aux rois de son pays à quelques occasions, quand ces mêmes rois croiront posséder et exercer un pouvoir absolu. Il faudra cependant attendre la Glorieuse Révolution de 1688-1689 pour lever définitivement la contradiction. Entre-temps, le pays devra vivre avec les idées des uns et des autres, le plus souvent dans un silence résigné, mais parfois submergé par la volonté exprimée violemment d'obtenir justice.
SALISBURY, préc. au par. 327, p. 3; GLANVILLE, préc. au par. 229, p. XXXVII; H. de BRACTON, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, 1220-1250, traduit et édité par S.E. Thorne sous le titre Bracton on the Laws and Customs of England, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1968, p. 33. Lire également notre paragraphe 90 où cette question a été abordée une première fois.
Par. 429 Voyons dans le détail le contenu de ces réformes. En raison de la séparation progressivement plus marquée entre l’exercice des différents pouvoirs de puissance publique, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, nous adopterons cette terminologie pour le reste de l’ouvrage.
8.3 Exercice du pouvoir exécutif : centralisation et résistance
Par. 430 Henri II, Richard Ier et Jean ont gouverné sans trop se soucier de la portée réelle de leurs pouvoir régaliens. À vrai dire, les seules qu’ils semblaient reconnaître étaient celles qu’ils s’imposaient en raison de considérations plus politiques que juridiques. La question pertinente, de leur point de vue, devenait : le peuple va-t-il accepter ou refuser telle ou telle autre proposition avancée par son roi ? Le respect de la tradition, un sentiment très fort partagé par les sujets anglais, surtout les plus influents d’entre eux, agissait tel un frein incitant ces rois à se montrer prudents. Henri II et Richard ont donc dirigé le pays en invoquant toujours des précédents, qu’ils interprétaient le plus libéralement possible, il est vrai, mais dans les limites du raisonnable. C’est justement parce qu’il avait dépassé de beaucoup ces limites que le roi Jean a éprouvé des difficultés. En raison de ses abus réels ou perçus, du sentiment populaire que Jean, voire même Richard Ier et Henri II avant lui, avaient violé les anciennes coutumes, les hauts barons ont choisi de se révolter. Leur objectif était de freiner les ambitions des Plantagenêts en leur imposant leur propre interprétation du droit du royaume. La Grande Charte ou Magna Carta de 1215 a été le produit de leurs efforts.
Note: L’intention des barons anglais était donc de revenir à une époque ancienne et idéalisée, telle qu’ils l’ont expliquée lors de leur rencontre avec le roi Jean en janvier 1215. Le chroniqueur Matthieu Paris en a fait le récit dans sa chronique, tome 2, préc. au par. 405, à la p. 528 : « (Les barons) demandèrent la confirmation des lois et libertés du roi Édouard, ainsi que les autres libertés octroyées déjà à eux-mêmes, au Royaume d’Angleterre, et à l’Église anglicane, telles qu’elles étaient contenues dans les lois d’Édouard et dans la charte du roi Henri Ier. » Voir également notre paragraphe 405 qui traite du même sujet.
Par. 431 La Magna Carta a notamment fixé le montant de certains prélèvements effectués par le roi ou par les barons eux-mêmes. D’après l’article 2, lorsqu’un baron décédé laissait son domaine à l’aîné de la famille, l’héritier devait dorénavant verser à la Couronne un relief de 100 livres pour une baronnie entière, alors que l’héritier d’un fief de chevalerie devait pour sa part verser un relief de 100 shillings à son baron. Le roi était également autorisé à percevoir une aide spéciale de ses tenanciers en chef pour faire chevalier son fils aîné ou pour marier sa fille aînée, une fois seulement, à la condition qu’il s’agisse d’une contribution raisonnable, mentionnait l’article 12. On n’a pas précisé comment évaluer la raisonnabilité d’une aide. Au moins, le montant pouvait être discuté, probablement selon les barèmes qui avaient cours pour l’équipement d’un chevalier et pour la dot d’une jeune princesse dans le reste du monde médiéval. L’aide exigée de la cité de Londres devait également être raisonnable, nous informe le même article 12. Sauf pour ces trois cas, la Charte interdisait au roi de prélever quelque taxe ou impôt que ce soit, à moins d’obtenir préalablement le consentement de la nation représentée par le Conseil commun du royaume, dans les conditions décrites à l’article 14. Cette approbation du Conseil était expressément requise pour déterminer le montant d’écuage exigé en remplacement du service militaire.
Par. 432 Le roi est demeuré le chef incontesté des armées de la nation. Ses pouvoirs de police ont été étendus par suite de l’élargissement de sa paix à tout le royaume. L’application du droit dans les comtés relevait toujours des shérifs. Ceux-ci ont cependant perdu l’autonomie à peu près complète dont ils jouissaient durant les règnes du Conquérant et de son fils Guillaume le Roux. En effet, l’Assise de Clarendon de 1166 leur a rappelé qu’ils n’étaient pas des officiers indépendants du roi. Cette loi a de plus réduit leurs pouvoir de justice : la tâche des shérifs se résumait désormais à introduire et à instruire les causes devant des juges royaux, non plus à tout diriger. On leur a demandé de poursuivre la collecte des loyers, des taxes et des impôts pour le compte du roi, quoique sous la supervision constante de l’Échiquier, comme de veiller à faire respecter le service militaire. Les shérifs sont donc redevenus ce qu’ils devaient être au départ, soit de simples agents de la Couronne. Pour le reste, l’organisation gouvernementale des trois premiers souverains plantagenêts serait demeurée à peu près la même que sous les rois normands, à l’exception notable de l’ajout de la Cour des plaids communs parmi les cours royales siégeant à Westminster, et de plusieurs coroners parmi les officiers de justice.
The Assize of Clarendon (1166), E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 440-443.
Par. 433 Pour l’anecdote, notons que le terme de shérif ou sheriff en anglais est une déformation de mots empruntés au vieil anglais. Sous le règne du danois Cnut (1016-1035), on l’a effectivement appelé scirgerefa : scir (ou shire) et gerefa (officier). Les administrateurs des rois normands ont préféré l’appeler le scir-reeve (gardien du shire), devenu le scirreve dans sa forme contractée adoptée par l’Échiquier en 1167. On ne verra pourtant le mot shérif ou scirreve que très rarement. Pourquoi ? Parce que l'anglais n'était pas la langue du droit. Ce rôle a été réservée au latin, puis au français. Il faudra attendre 1362 et une loi du Parlement avant que l'anglais ne devienne la langue des tribunaux. Par ailleurs, lorsque les clercs du roi ont procédé à une traduction de la Magna Carta en français, pour être compris des barons, ils ont privilégié l’emploi du mot vicomte, visconte dans le français du début du XIIIe siècle, parce qu’ils considéraient que le scirreve anglais, le futur shérif, occupait une position comparable au vicomte normand.
PIPE ROLL SOCIETY, vol. XII, The Great Roll of the Pipe, from the Fourteenth Year of the Reign of King Henry the Second, A.D., 1167-1168, Londres, Handsard Publishing Union, 1890, p. 104. On peut consulter le texte original de la Magna Carta en français de l’époque, peut-être même celui de 1215, dans l’article de J.C. HOLT, « A Vernacular-French Text of Magna Carta, 1215 », (1974) vol. 89 The English Historical Review 346, pp. 356-364. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque municipale de Rouen. Malheureusement, il n’a pas été digitalisé. L'Acte des tribunaux anglais de 1362 (Statute of Pleading), 36 Edw. III, c. 15, Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 375-376, est une loi promulguée par Édouard III ordonnant que les procès soient tenus en langue anglaise.
8.4 Exercice du pouvoir législatif : roi et Conseil commun du royaume
Par. 434 Le roi d’Angleterre a conservé son pouvoir de légiférer seul ou avec les membres de la noblesse ou du seul clergé au moyen de chartes, d’assises ou de constitutions. Son pouvoir a cependant été tempéré à partir du règne de Jean dès qu’il voulait lever de nouveaux impôts ou taxes sur ses sujets.
Par. 435 De fait, en signant la Magna Carta en 1215, Jean a renoncé pour toujours à exiger quelque aide financière additionnelle qui ne serait pas clairement prévue dans les exceptions mentionnées à l’article 12, à moins d’obtenir préalablement l’accord du Conseil commun du royaume. Ce Conseil, d’après l’article 14, se composait des archevêques, des évêques, des abbés, des comtes et hauts barons du royaume, tous convoqués individuellement et par écrit, comme c’était d’ailleurs l’habitude dans les réunions plénières de la Cour du roi, auxquels devaient s’ajouter d’autres membres de la petite noblesse, convoqués cette fois par l’intermédiaire de huissiers ou de shérifs selon des modalités restant à définir.
Par. 436 Qui étaient exactement ces autres personnes plus humbles et néanmoins appelées à siéger au Conseil commun du royaume ? Il est vraisemblable que la Magna Carta ait fait le lien avec l’assemblée tenue à Oxford deux ans plus tôt, en 1213. Le roi Jean avait alors exigé de chaque shérif ou huissier qu’il choisisse quatre personnes de son comté pour assister aux travaux de la Cour du roi, en vue d'y traiter les affaires intéressant le royaume. Il semble que Jean ait pu souhaiter leur aide afin de combattre les barons insurgés. Certes, on ne sait pas comment ceux-ci ont été choisis. La méthode qui s’imposera plus tard sera de tenir des élections. Un précédent avait néanmoins été créé voulant que des membres de la petite noblesse, appelés pour l’occasion chevaliers de comtés (knights of the shire), soient invités à joindre la formation plénière de la Cour du roi, son Grand conseil, renommé Conseil commun du royaume dans la Grande Charte.
J.C. HOLT, « The Prehistory of Parliament », dans R.G. Davis et J.H. Denton (éds.), The English Parliament in the Middle Ages, Manchester, Manchester University Press, 1981, pp. 5-9.
Par. 437 Un roi souhaitant lever de nouveaux impôts ou taxes ou quelque autre aide devait donc obtenir le consentement du Conseil commun du royaume, cet embryon du futur Parlement. Apparemment, le consentement aurait été demandé et obtenu par Henri II et par Richard Ier, lorsqu’ils ont voulu accroître leurs rentrées fiscales. Bien sûr, d’après la coutume ayant cours, un seigneur ne pouvait modifier unilatéralement les termes de son contrat féodal, y compris les engagements financiers, sans obtenir l’accord de ses vassaux. La différence, après 1215, était non seulement de faire du consentement une exigence légale applicable dans tous les cas, dès que les vassaux, arrière-vassaux, arrière-arrière-vassaux, paysans et artisans étaient appelés à contribuer, mais également de coucher par écrit la nouvelle règle, en plus de l’assortir de sanctions contre le roi en cas de violation. Comme le jurisconsulte Ranulf de Glanville l’avait souligné dans son traité rédigé vers 1188, « [traduction] le fait de consigner par écrit (les lois et les coutumes d’Angleterre) leur confèrerait assurément une plus grande autorité (…) ». Les barons anglais, peut-être instruits à ce sujet par l'archevêque Langton, en étaient bien conscients.
GLANVILL, préc. au par. 229, p. 2.
Par. 438 Hormis les questions financières, le pouvoir du roi de légiférer paraissait inchangé. Oui et sans aucun doute aux yeux des contemporains ! Mais comme la santé financière du gouvernement dépendait désormais de leur accord, les hauts barons et les prélats, et plus tard les représentants des communautés du royaume, comprendront l’utilité de ce nouveau pouvoir pour limiter davantage les prérogatives de la Couronne. En effet, lorsque le Conseil commun du royaume changera à nouveau de nom pour devenir le Parlement, celui-ci exigera parfois, en échange de sa collaboration, la reconnaissance de tel droit ou de tel privilège. C’est ainsi que le Parlement parviendra graduellement à accroître ses champs de compétence pour devenir, au moins à partir de la Glorieuse révolution de 1688-1689, l’unique législateur et l’autorité suprême dans le royaume d’Angleterre.
Par. 439 Même soumis aux lois fondamentales de son royaume, à une Constitution naissante s’imposant à lui, le roi plantagenêt n’est pas devenu pour autant un personnage quelconque régi par le droit de la même manière que ses sujets. Il possédait effectivement en propre de nombreux droits, pouvoirs et privilèges, qui le confirmaient comme le souverain de son royaume. Il conservera d’ailleurs intacts ses prérogatives, du moins tant qu’il ne les aura pas abandonnées en ratifiant un projet de loi du Parlement. Et ce sont ces actions subséquentes du Parlement qui permettront le développement des droits et libertés fondamentaux des Anglais. La Magna Carta n'aura été qu'un premier pas vers cet objectif.
Par. 440 Aussi récemment qu’en 1920, le Comité judiciaire de la Chambre des lords a défini les prérogatives de la Couronne comme le résidu de ses anciens droits, pouvoirs et privilèges discrétionnaires lui ayant appartenus de tous temps et qui n’ont pas encore été abrogés par le Parlement. Lord Parmoor en a fait la synthèse dans un exposé clair et concis sur l’évolution de la prérogative, tout en établissant le lien avec la progression des droits et libertés des Britanniques : « Les progrès réalisés dans le développement des libertés constitutionnelles ont été pour une large part le résultat de la diminution des pouvoirs discrétionnaires de l’exécutif, et de l’action grandissante du Parlement en faveur de la protection du sujet, inscrite dans une série d’instruments statutaires. Le résultat est que, alors qu’autrefois les actions gouvernementales dans leur grande majorité se justifiaient légalement grâce à la prérogative, celle-ci est désormais encadrée dans des limites fort étroites. La prérogative royale a été progressivement réduite, par nécessité, pour que le règne du droit s'impose et remplace ce qu’était autrefois une discrétion administrative incertaine et arbitraire. »
Attorney-General v. De Keyser’s Royal Hotel, Ltd., [1920] AC 508, p. 568 (lord Palmoor). Voir aussi pp. 526 (Lord Dunedin) et 538 (lord Atkinson).
8.4 Exercice du pouvoir judiciaire : cours de common law et apparition du jury
Par. 441 C’est assurément l’administration de la justice qui a subi les transformations les plus profondes pendant le règne des premiers Plantagenêts. Déjà, lors de l’avènement d’Henri II, la justice royale était puissante et respectée en Angleterre, plus qu’en aucun autre royaume d’Occident. Le mérite en revenait à son aïeul Guillaume le Conquérant. Il avait ouvert la porte à l’extension illimitée de la justice du roi en réclamant à titre d’héritage toutes les prérogatives de ses prédécesseurs anglo-saxons, incluant celle d’exercer le pouvoir judiciaire suprême au sein de sa cour. Certes, ses vassaux directs, les barons, tenaient également une cour de justice, une cour d’honneur autorisée par le droit féodal. Et les collectivités locales opéraient toujours les cours de comté (shire) et de centaine (hundred) dans une relative indépendance. Leur contribution a cependant décru au profit de la justice royale sous le règne d’Henri Ier (règne 1100-1135) et surtout sous celui de son petit-fils Henri II (règne 1154-1189).
J. BIANCALANA, préc. au par. 362, p. 436.
Par. 442 Souvenons-nous qu’en vertu du droit féodal, un vassal avait le droit d’exiger un procès devant son seigneur. Un comte ou un baron pouvait donc en appeler à la justice du roi parce qu’il comptait au nombre de ses tenanciers en chef. Toute autre personne qui souhaitait en faire autant devait d’abord obtenir son consentement. Le roi l’accordait parfois à titre gracieux, mais sa Cour, dont le temps était mesuré, ne s’intéressait normalement qu’aux affaires les plus importantes; elle demeurait la Cour des puissants et des grandes causes. La justice du roi se trouvait conséquemment hors de portée de la presque totalité de ses sujets.
Par. 443 Tant que la justice du roi avait été dispensée personnellement, ce que faisait Henri II à l’occasion tant qu’il se trouvait en Angleterre, son influence sur le droit du royaume est demeurée limitée. Cet ordre ancien s’est trouvé bouleversé lorsque le roi a mis en place des cours de justice avec le pouvoir de siéger en son absence tout en rendant justice en son nom. Rendre la justice royale plus accessible a permis de réaliser son plein potentiel comme instrument unificateur du droit du royaume. Parce que la justice du roi était plus puissante que les autres, ceux qui avaient la possibilité de s’en prévaloir l’ont favorisée, accélérant d’autant la création d’un droit vraiment national, la future common law, tout en causant le déclin parallèle de l’activité des autres cours de justice.
BIANCALANA, id., p. 435-436.
Par. 444 Comment Henri II a-t-il justifié son activisme judiciaire ? Les rois normands Guillaume II Rufus et Henri Ier Beauclerc avaient autrefois délégué leur pouvoir de rendre justice à un grand justicier ou à des juges itinérants. Ces exemples, bien qu’encore occasionnels, ont servi de précédents à Henri II pour se justifier aux yeux de ses contemporains. Henri aurait pu prétendre qu’il n’accomplissait rien de vraiment nouveau, qu’il se contentait d’adapter aux nouvelles circonstances un ancien principe suivi et accepté par tous. Certes, mais Henri l'a étendu et généralisé en délégant l'autorité de la Cour du roi à de nombreux juges qui siégeait désormais régulièrement. Et c’est cela qui a rendu possible le développement de la common law.
J.H. BAKER, An Introduction to English Legal History, 2e éd., Londres, Butterworth and Co., 1979, p. 14.
Délégations de pouvoirs par la Cour du roi

Par. 445 Invoquer des précédents s’avérait indispensable à cette époque ou le peuple voyait le droit comme un ensemble de coutumes dont l’ancienneté demeurait le principal gage de leur valeur. La présence de précédents rendaient les actions du roi inattaquables. Voilà pourquoi Henri II et son fils Richard Ier se sont crûs justifiés de poursuivre les activités de la Cour de l’Échiquier, de faire revivre l’institution des juges itinérants abandonnés sous le règne d’Étienne, en plus de créer la nouvelle Cour des plaids communs, comme d’étendre leur juridiction. Toutes siégeaient et jugeaient avec la même autorité reconnue à la Cour du roi. Elles étaient d’ailleurs la Cour du roi sous une autre forme. Ce n’est que progressivement, imperceptiblement serait un terme plus juste, qu’elles ont acquis un statut distinct et indépendant de la personne physique du roi. Nous avons déjà traité de l’Échiquier. Voyons maintenant le rôle des juges itinérants et celui de la Cour des plaids communs.
BIANCALANA, préc. au par. 362, pp. 437-438; G.B. ADAMS, « The Origins of the English Courts of Common Law », (1921) vol. 30 Yale Law Journal 798, p. 801.
Par. 446 L’histoire des juges itinérants ou errants (justiciae errantes en latin), commencé sous Henri Ier, s’est poursuivi durant le règne d’Henri II. En effet, quelques années après son arrivée sur le trône, Henri II a renoué avec la pratique d’envoyer des juges royaux en mission dans les shires pour rendre la justice, faire rentrer les impôts et surveiller les shérifs. On les reconnaît dans certains passages de l’Assise de Clarendon, une législation adoptée lors d’une rencontre plénière de la Cour du roi en 1166. Il semble que les juges itinérants agissaient au début en vertu de mandats spéciaux et non régulièrement, ce qui était déjà apparemment le cas à l’époque de son grand-père. On a cependant augmenté progressivement le nombre de leurs tournées et de shires visités. À cet égard, le règne d’Henri II s’inscrit dans la continuité de celui d’Henri Ier.
MOORES, préc. au par. 306, pp. 343-345 et 357. Voir également l’Assise de Clarendon, préc. au par. 69, p. 441-443, plus précisément aux articles 1, 4, 5, 6, 10 et 19.
Par. 447 Henri II a finalement précisé et normalisé l’organisation des juges itinérants à partir de 1176 en adoptant au sein de sa Cour l’Assise de Northampton. Le roi a divisé le royaume en six tournées ou circuits, chacun parcouru par trois juges chargés d’instruire et de juger les litiges au nom de la Cour du roi. Trois ans plus tard, lors d’une autre réunion de la Cour tenue à Windsor, le nombre de ces tournées a été réduit à quatre, avec cinq ou six juges par tournée. Leur durée n’avait pas encore été déterminés.
Ralph de Diceto and the “Deeds of King Henry II” on Henry II’s changes in Judicial Organisation, 1176-1179, E.H.D., vol. 2 (1042-1189), éd. 1981, pp. 513-515.
Par. 448 On a demandé aux juges itinérants d’entendre les accusations portées par des jurys locaux chargés d’enquêter sur de possibles infractions. Ce type de jury, une institution mise en place quelques années plus tôt dans chaque centaine ou bourg, composé de quatre ou de douze hommes jurés, devait chercher activement les coupables des crimes énumérés dans l’Assise de Clarendon de 1166. Il s’agissait des crimes les plus graves, ceux considérés comme des violations de la paix du roi. Ce jury d’accusation sera plus tard appelé le grand jury (grand jury en anglais) pour le distinguer du petit jury (petty jury en anglais), qui servira éventuellement lors du procès lui-même. Si les jurys d’accusation n’existent plus au Royaume-Uni depuis le 31 août 1933, ils sont toujours en usage aux États-Unis d’Amérique.
Note: L’institution du Grand Jury a été totalement abolie au Royaume-Uni par la Loi sur l'Administration de la justice (Diverses dispositions), 1933, c. 36, art. 1(1). Pour ce qui est des États-Unis d’Amérique, le Cinquième Amendement de la Constitution de 1791, dans la partie habituellement appelée le Bill of Rights, prescrit : « [Traduction] Nul ne sera tenu de répondre d’un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d’un Grand Jury (…) ».
Par. 449 D’autres assises ont étendu la juridiction des premiers juges itinérants. Outre les violations de la paix du roi et plaids intéressant la Couronne, ils entendaient désormais des litiges entre les seigneurs et leurs vassaux portant sur la possession des fiefs et de leurs droits afférents, empiétant ainsi sur les pouvoirs des cours féodales tenues par ces mêmes seigneurs, ce qui a eu pour effet de les marginaliser. Cela étant dit, si les juges itinérants estimaient cependant qu’une affaire semblait trop délicate ou importante, en raison des personnes en cause, ils pouvaient toujours la référer à l’institution mère, c’est-à-dire au roi siégeant littéralement au milieu de sa Cour.
Par. 450 L’histoire des juges itinérants, ou justices in eyre, se poursuivra avec quelques interruptions pendant presque un siècle et même davantage. En effet, quoique leurs tournées régulières (general eyres) se sont terminées en 1294, en raison d’une guerre imminente avec la France, plusieurs tournées ad hoc ont été ordonnées durant la première moitié du XIVe siècle, puis après un bref retour des tournées régulières en 1329-1330, elles se firent de plus en plus rares. Les dernières ont eu lieu en 1374. Mais on ne trouve aucun dossier les concernant après 1348. Leur disparition n’affectera pas les Anglais, puisque d’autres cours de common law accompliront le même travail, soit la Cour des plaids communs, déjà à l’œuvre sous Richard Ier (règne 1189-1199), et de la Cour du banc du roi, dont la création se fera sous Henri III (règne (1216-1272).
D. CROOK, « The Later Eyre », (1982) vol. 97 The English Historical Review 241.
Par. 451 Le roi Henri II aimait expérimenter. En 1178, motivé par de nombreuses plaintes portant cette fois sur le comportement de ses juges itinérants, Henri les a tous congédié, un total de 18 juges. À la place, il a choisi cinq membres de sa maison, trois laïcs et deux clercs, pour soulager les travaux de sa Cour lorsqu’il siégeait au milieu d’elle. Un chroniqueur de l’époque raconte : « [Traduction du latin] Quand (le roi Henri II) a appris que la terre et les hommes de la terre devaient souffrir de la présence d’un si grand nombre de juges, car celui-ci s’élevait à dix-huit, il a choisi, après avoir consulté les sages de son royaume, de ramener ce nombre à cinq : deux clercs et trois laïcs, tous appartenant à sa famille (le personnel de son Palais en réalité). Et le roi a décrété que les cinq devraient entendre toutes les plaintes pour y faire droit (i.e. trancher le litige), et qu’ils ne devraient pas quitter la Cour du roi mais plutôt l’accompagner pour entendre ces plaintes, tout en se rappelant que, s’ils étaient incapables de s’entendre sur une question, celle-ci devra être serait soumise lors d’une audience devant le roi et les conseillers les plus sages du royaume. »
W. STUBBS et H.W.C. DAVIS, Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History, 9e éd., Oxford, Clarendon Press, 1913, p. 155, année 1178. Lire également Account in the “Deeds of King Henry II” of the Provisions of Justices to Hear Pleas (clamores hominum ) (1178), E.H.D., vol. II (1042-1189), éd. 1981, p. 516.
Par. 452 Ces nouveaux juges n’étaient pas encore des professionnels du droit mais des personnes en qui le roi avait placé sa confiance. Ils accompagnaient Henri lorsqu’il parcourait son royaume. Quoique travaillant et décidant seuls, ils devaient néanmoins consulter le roi si les litiges soumis requéraient une main plus sûre, ce que le chroniqueur n’oublie pas de mentionner. Cette expérience aurait été interrompue et définitivement abandonnée en raison des longues absences du roi Henri de l’Angleterre.
Par. 453 Les juges royaux nommés par Henri II se seraient finalement établis à Westminster où ils ont partagé le personnel de la Cour de l’Échiquier. Ils ne possédaient pas encore d’identité propre. Dit autrement, on ne les a pas vraiment distingués des barons de l’Échiquier. Cela changera sous l’administration du justicier et archevêque de Cantorbéry, Hubert Walter, l’homme de Richard Ier. En 1194, celui-ci a décidé d’un changement de personnel au sein de cette institution informe. Des hommes mieux qualifiés, de véritables professionnels du droit, y ont alors fait leur entrée. C’est seulement à partir de ce moment qu’il est devenu possible de distinguer clairement l’existence de deux cours de justice à Westminster : l’ancien Échiquier et la nouvelle cour, d’abord appelé le Banc à Westminster (Bench at Westminster), puis la Cour des plaids communs (Court of Common Pleas). Celle-ci conservera des dossiers sur ses procédures et les décisions prises, comme il est d’usage pour une cour d’archives.
TURNER, préc. au par. 383, p. 244.
Cour des plaids communs 1450-1454
Illustration tirée d’un manuscrit en possession de la bibliothèque du Inner Temple à Londres, publié entre 1450 et 1454, parce que l’on compte 7 juges. La Cour ne comptait 7 juges qu’à ces seules dates.

Par. 454 Peu après le début de son règne, en 1200, le roi Jean a décidé de s’entourer d’un nouveau groupe de juges, pour former une nouvelle cour de justice qui le suivrait dans ses déplacements, tout en laissant en poste et à leurs tâches habituelles ses autres juges à Westminster. On ignore pourquoi Jean a souhaité créer une nouvelle cour royale de common law, car elle semblait faire double emploi.
Par. 455 Justement à ce propos, Jean, à partir de 1207, se montra de plus en plus mécontent de l’opération en parallèle de deux cours de justice, l’une qui siégeait en sa présence et l’autre en résidence à Westminster. Il a alors choisi de diminuer progressivement le nombre des litiges soumis à la Cour des plaids communs, jusqu’à suspendre complètement ses travaux en 1209, la même année où il a été excommunié. Cela a provoqué la colère de la noblesse de l’Angleterre. Mais Jean avait ses raisons; ses ennuis avec l’Église et les barons avaient accentué sa propension naturelle à la méfiance, voire à la paranoïa. Il aurait donc cherché à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. L’un des moyens retenus a été de faire appliquer la justice par des juges proches de lui. Certes, durant quelques mois, entre 1214 et 1215, Jean a fait revivre la Cour des plaids communs, mais pour la mettre de nouveaux au rancart dès que la révolte des barons a repris.
TURNER, id., p. 247; D. CROOK, Records of the General Eyre [Public Record Office Handbooks 21], Her Majesty's Stationary Office, Londres, 1981, pp. 68-71.
Par. 456 Les barons victorieux ont par la suite exigé que le roi inscrive à l’article 17 de la Magna Carta de 1215 le retour de cette Cour dans un lieu fixe, que tous savaient être Westminster. Mais cela aurait pu être à un autre lieu déterminé à l'avance, ce que les barons étaient prêts à accepter, en autant que les plaignants n'aient pas à courir après le roi pour soumettre et trancher leur litige. Quant à la nouvelle cour de justice créée par Jean qui devait le suivre lors de ses déplacements, donc une cour coram rage, elle a disparu avec la mort du roi en 1216, tout simplement parce que l’héritier de la Couronne, le désormais Henri III, un enfant d’à peine neuf ans, n’étaient pas en âge de la présider. La Cour de l’Échiquier, les juges itinérants et la Cour des plaids communs restaient donc les seules cours royales en activité pour le moment.
Par. 457 Henri II et ses fils Richard et Jean ont poursuivi le développement de la justice royale. Souvenons-nous d’abord que leurs prédécesseurs normands avaient fait un usage parcimonieux du bref, lorsqu’il s’agissait d’attribuer compétence à leurs cours de justice. En effet, le bref (writ) du roi normand n’avait jamais été accordé automatiquement. On dirait également qu’il n’avait jamais été accordé de plein droit. Son émission, qui seul ouvrait la porte de la justice royale, dépendait des bonnes dispositions du chancelier ou de son maître à l’égard du justiciable. Le roi normand s’était en outre montré respectueux de la compétence des cours locales, soit les cours de shire et de hundred, ainsi que les cours d’honneur des seigneurs, surtout en matière de droit privé (le droit criminel était autre chose en raison de l’extension de la paix du roi). Son bref de droit ou breve de recto (writ of right), par exemple, apparu vers 1108, était un ordre donné au shérif d’un comté lui intimant de voir à ce que justice soit rendue par une cour locale ou la cour d’un seigneur, à défaut de quoi un officier du roi ou une autre personne nommée dans le bref le ferait à sa place. Le bref precipe quod reddat, apparu vers 1150, était déjà moins respectueux, car il ordonnait au défendeur de remédier au grief du plaignant, sinon de comparaître devant le juge royal. Dans la forme, tout au moins, la justice du roi normand avait donc été une justice par défaut, un dernier recours visant à éviter une injustice. Les types de litiges visés par ces brefs ont été la possession d’une terre, les services associés à la tenure d’une terre, et plus tard les dettes en argent.
Des exemples de ces brefs sont donnés par GLANVILL, préc. au par. 229. Mais, pour des explications plus détaillées et plus simples à comprendre, lire l’histoire de la procédure de BIGELOW, préc. au par. 302, pp. 156-160 (bref de droit) et p. 77 note infrapaginale 3, pp. 83-84, et p. 342 note infrapaginale 1 (bref quod reddat).
Pat. 458 La relative timidité du roi normand en matière de justice a laissé place à une ambition affichée sous le plantagenêt Henri II. Celui-ci s’est montré effectivement plus agressif. Peut-être n’avait-il guère le choix ! Car il fallait remettre en ordre le royaume après la période trouble d’Étienne. Son idée était qu’il fallait d’abord remettre à leur légitime tenancier les terres dont ils avaient été dépossédés injustement et sans jugement sous le règne précédent. On procédait pour cela à une enquête. La procédure, qui date entre 1155 et 1166, appelée l’Assise de novel disseisin (assize of novel disseisin), débutait par un bref, le bref de novel disseisin. C’était incontestablement la plus importante innovation du règne d’Henri II.
C. TATE, « Ownership and Possession in Early Common Law », (2006) Vol. 48 The American Journal of Legal History 280, pp. 297-299.
Par. 459 Le bref de droit (writ of right) a également connu une rapide progression par la multiplication de ses usages, notamment pour que des fils de seigneurs injustement et sans jugement déshérités durant l’anarchie puissent récupérer les biens de leur père. Le bref ordonnait à un seigneur de rendre justice à son tenancier, sinon ce dernier pouvait se rendre voir le shérif, et après vérification, ce dernier évoquait alors la cause devant la cour de comté (shire). Toutefois, à la grande différence de ce qui arrivait auparavant, le plaignant pouvait encore lui retirer l’affaire avant le début de l’audience par un bref de Pone pour la confier cette fois à des juges du roi.
BIANCALANA, préc. au par. 362, pp. 439-440 et 442-443. Plus intéressant encore, lire le plus ancien livre de droit rédigé en français et portant sur le droit anglais, attribué en partie à Jean le Breton, évêque de Hereford, mort en 1275, puis révisé après, peut-être aussi tard qu’en 1290, puisqu’il évoque le texte de loi Quia Emptores adoptée à cette date. F.M. NICHOLS (éd.), Britton: The French Text Carefully Revised with an English Translation, Introduction and Notes, Vol. 1, Londres, Macmillan and Co., 1865, pp. XLII-XLIII et 203-204.
Par. 460 Dans tous les cas, on invoquait une défaillance des instances judiciaires inférieures si l’on souhaitait l’intervention de la justice du roi. Il n’empêche que tous, seigneurs comme vassaux et humbles tenanciers, ont fini par croire, une croyance qui s’inscrira dans la coutume, que seul un bref émanant du chancelier du royaume pouvait mettre fin à une dispute sur la possession d’une terre.
Par. 461 Les premiers souverains de la maison des Plantagenêts ont également introduit l’usage du jury dans l’administration de la justice. Cette institution servait cependant à d’autres fins depuis fort longtemps ailleurs en Europe, au moins depuis le VIIIe siècle. En effet, dans le monde franc, au moins depuis l’époque de Charlemagne, les rois et empereurs francs avaient cherché les meilleurs moyens de recueillir de l’information sur leur domaine. L’un de ces moyens a été de réunir un groupe d’hommes dans chaque district administratif, de leur faire prêter serment de dire la vérité, avant de leur soumettre des questions d’intérêt local auxquelles ils devaient répondre au meilleur de leur connaissance. La procédure, sous la direction d’envoyés du maître (missi dominici), pouvait être répétée à la grandeur du royaume ou de l’empire pour y mener une enquête exhaustive. Ces hommes ont été appelés des jurés, mot pouvant signifier serment ou enquête. On le déformera en Angleterre pour créer le terme de jury, puis il fut reçu dans le français moderne dans le sillage de la révolution de 1789. Le jury servait donc à l’origine à des fins purement administratives. Il faisait partie du bagage institutionnel des envahisseurs normands lors de la conquête de 1066. Guillaume a d’ailleurs employé de tels jurys en 1086 pour mener à bien son enquête du Domesday Book. Et Henri Ier les a aussi utilisé pour mener diverses enquêtes. Était-ce ce qui a inspiré Henri II quand il a mis en place de nouveaux jurys en matière judiciaire ? Cela reste l’opinion la plus convaincante.
C.T. COLEMAN, « Origin and Development of Trial by Jury », (1919) vol. 6 Virginia Law Review 77, pp. 78-79; R.V. TURNER, « The Origins of the English Medieval Jury: Frankish, English, or Scandinavian? », (1968) vol. 7 Journal of British Studies 1, pp. 1-2 et 6-9. Plus récemment, lire l'article de M. McNAIR, « Vicinage and the Antecedents of the Jury », (1999) vol. 17 Law and History Review 537.
Par. 462 Henri II a trouvé un nouvel emploi au jury lorsqu’il a adopté en 1166 l’Assise de Clarendon. L’assise règlementait la procédure criminelle pour les meurtres, les vols et le brigandage, en mettant sur pied dans chaque comté ou shire des jurys qui devaient identifier les personnes soupçonnées de ces crimes et déposer des accusations. Ils étaient donc des jurys d’accusation. Les accusés devaient eux-mêmes se défendre par la suite. On s’en remettait encore au jugement de Dieu afin de déterminer si l’accusé disait vrai ou mentait lors du procès, celui-ci étant identifié au moyen du serment purgatoire ou de l’ordalie. Or, l’une et l’autre procédure ont été interdites par le quatrième concile du Latran tenu en 1215 sous l’égide du pape Innocent III. L’Église de Rome a tout simplement rappelé le principe défendu par saint Augustin voulant que nul ne tente Dieu s’il peut disposer de moyens rationnels. Ces procédures sont conséquemment tombées en désuétude. Il ne restait, comme moyen rationnel de trouver la vérité sur les faits d’un litige, que l’enquête par témoins conduite selon le modèle accusatoire avec jury ou selon le modèle inquisitoire sans jury. En Angleterre, après de longues années d’hésitation, on choisira de conduire les procès avec un jury en suivant une procédure de type accusatoire. Il s’agira cette fois du petit jury (petty jury en anglais), que l’on a opposé au grand jury d’accusation (grand jury), tous deux déjà mentionnés au paragraphe 447.
POLLOCK et MAITLAND, vol. 1, préc. au par. 215, p. 559. Voir supra aux paragraphes 150 à 156 pour connaître les diverses modalités menant au jugement de Dieu. Voir aussi le 18e canon du quatrième concile du Latran, ALBERIGO, préc. au par. 228, p. 523.
Par. 463 Henri II avait déjà introduit l’usage du petit jury dans les procès civils presque 50 ans auparavant. C’est vraisemblablement lors d’une réunion de sa Cour qu’il aurait adopté l’Assise de novel disseisin, mentionnée au paragraphe 457. On n'en connait pas la date exacte. Mais c’était surement avant 1166, quelque part durant le règne du premier souverain Plantagenêt, entre 1154 et 1189. Henri a alors posé la règle voulant qu’une personne ne puisse être dépossédée de sa terre sans le verdict d’un jury. Celle-ci devait obtenir un bref de novel disseisin du chancelier pour défendre sa position. Le bref était accordé si la victime avait été dépouillée de ses droits injustement et sans jugement, précisera Ranulf de Glanville. Le bref exigeait du shérif qu’il convoque 12 hommes libres des environs, susceptibles de connaître les faits du litige, de les assermenter en présence d’un juge royal, puis d’exiger d’eux qu’ils rendent un verdict. Le jury pouvait se retrouver devant un dilemme : remettre la terre à la demanderesse parce qu’elle avait été dépossédée sans jugement ; ou laisser la terre en possession de la défenderesse parce qu’elle avait un titre valable. Heureusement, après 1179, celui qui détenait un titre en bonne et due forme avait désormais un recours pour décider du droit sur le fond, et non seulement sur une question de procédure.
Voir GLANVILL, préc. au par. 229, pp. 167-169, pour des explications et des exemples. Lire également D.W. SUTHERLAND, The Assize of Novel Disseisin, Oxford, Clarendon Press, 1973, pp. 1-3 et 7.
Par. 464 Car Henri II a procédé à une autre réforme lorsqu’il a adopté sa Grande Assise de 1179. Le nouveau bref, dit action de droit (action of right), permettait cette fois de contester un titre de propriété en soumettant son litige à un juge royal aidé d’un second jury de 12 hommes. Toutes les parties devaient accepter la juridiction du tribunal. Un défendeur pouvait encore préférer le jugement de Dieu, mais n’avait d’autre choix que le duel, avec le danger que cela comportait pour sa vie. La Grande Assise permettait d’éviter cette terrible sanction, la pire qui puisse survenir, a commenté Ranulf de Glanville. Elle représentait en outre une solution plus réaliste pour découvrir la vérité et était plus équitable pour les deux parties.
Ranulf de Glanville explique comment la Grand Assize (1179) s’applique dans le cas où la propriété d’une terre est en litige, et donne des exemples, dans GLANVILLE, id., pp. 26-33. Lire également D.W. SUTHERLAND, id., pp. 2, 36 et 81-82.
Par. 465 L’article 39 de la Magna Carta de 1215, qui sera repris à l’article 29 de la version de 1225, où l’on exigeait un jugement par les pairs ou selon les lois du pays avant qu’un homme libre ne soit arrêté, emprisonné, dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou lésé de quelque manière, n’assurait pas la tenue d’un procès devant jury, pour la raison que le jury (plus tard appelé le petit jury) restait inconnu en droit criminel à cette époque. L’allusion au jugement par les pairs permettait seulement d’exiger un tribunal où siégeaient des membres de même condition sociale que l’accusé. Pour le reste, la seule garantie offerte était que le procès suivrait la procédure habituelle, autrement dit le recours au serment purgatoire ou à l’ordalie afin de déterminer la valeur des témoignages des parties. Prétendre le contraire correspond à une interprétation anachronique de la Magna Carta.
J.C. HOLT, Magna Carta, Cambridge, Cambridge University Press, 1965, pp. 8-9; L.W. LEVY, The Palladium of Justice; Origins of Trial by Jury, Chicago, Ivan R. Dee, 1999, pp. 15 et 16.
Par. 466 Évidemment, les cours de justice anglaises ont dû délaisser les moyens de preuve qu’étaient l’ordalie et le serment purgatoire dès leur condamnation par l’Église, en 1215, la même année où la Magna Carta a été adoptée. De toute manière, ils devenaient de plus en plus déconsidérés. Nous avons vu qu’Henri II avait commencé à les écarter dans les affaires civiles, une évolution à laquelle Ranulf de Glanville a souscrit lorsqu’il a écrit qu’un droit de propriété pouvait difficilement être prouvé par ordalie ou par serment purgatoire. Après leur abandon, la solution pour découvrir la vérité semblait trouvée : on étendrait aux procès criminels l’institution du jury.
GLANVILLE, préc. au par. 229, p. 28.
Par. 467 Tout n’a pas changé du jour au lendemain. Beaucoup de temps s’est écoulé avant que le procès avec jury ne s’impose dans les affaires criminelles. Le bureau du chancelier montrait toujours son désarroi lorsqu’il a fait parvenir ses directives aux juges itinérants dans un bref datant de 1219. Puisque l’Église interdisait désormais d’en appeler au jugement de Dieu, il leur a conseillé de donner suite aux accusations de crimes graves comme autant de condamnations, alors que les personnes poursuivies pour des infractions moins sérieuses seraient seulement bannies ou libérées sur leur engagement de garder la paix. La possibilité de tenir un procès avec jury n’avait donc pas encore été envisagée sérieusement quatre ans après le quatrième concile du Latran.
Temporary instructions to justices in eyre because prohibition of ordeal, 1219, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), édition de 1975, préc. au par. 69, p. 340.
Par. 468 Le principal obstacle à la tenue du procès avec jury restait l’exigence du consentement. Rappelons cette ancienne règle, datant de l’époque anglo-saxonne, voulant que les parties à un litige doivent consentir à la juridiction du tribunal et donc renoncer à se faire justice elles-mêmes. Certes, la règle datait d’un autre temps où la vengeance institutionnalisée constituait le principal moyen de régler les différends, mais elle faisait toujours partie des coutumes du pays. Or, lorsqu’un grand jury de 12 hommes avait déjà considéré la preuve suffisante pour déposer une accusation contre lui, la crainte de l’accusé était que ces mêmes hommes servent à nouveau au sein du petit jury, lors du procès. C’était plus que probable car les membres du grand jury, le jury d’accusation, devaient avoir une connaissance personnelle des faits de la cause, tout comme les membres du petit jury auxquels on demandait de témoigner de ce qu’ils savaient ou croyaient savoir à propos du litige. Ils n’étaient pas, comme aujourd’hui, des arbitres impartiaux chargés d’entendre une preuve dont ils n’avaient aucune connaissance personnelle, et à propos de laquelle ils n’avaient tiré aucune conclusion afin de préserver leur impartialité.
Voir supra aux pars. 70-71 et 156.
Par. 469 S’il fallait le consentement de l’accusé pour le soumettre à un procès avec jury, rien n’empêchait de le lui extorquer, comme nous l’avons vu plus tôt. On s’y est employé avec constance et détermination. Le récalcitrant a d’abord été soumis à un régime de prison forte et dure (prison strong and hard). Après son incarcération, le prisonnier était dévêtu et enchaîné nu sur le sol dans la partie la plus infecte de la prison, puis nourri uniquement de pain une journée et d’eau le lendemain. Une loi du Parlement, le Statut de Westminster I, adoptée en 1275, a alors déclaré que le procès avec jury était devenu la loi du pays (the common law of the land). Le régime de prison forte et dure a laissé la place au régime de peine forte et dure avant l’année 1300. On a simplement ajouté la torture au menu quotidien. Cette peine a été l’objet d’une description précise dans des documents d’archive de 1306 et 1322. Bras et jambe écartés, le prisonnier était cette fois étendu au sol. Son geôlier plaçait sur lui autant de poids de fer que le prisonnier pouvait en supporter et même davantage. Le traitement continuait jusqu’à ce que le prisonnier meure ou qu’il accepte son procès en plaidant coupable ou non coupable. La peine forte et dure était considérée comme une simple mesure faisant partie de la procédure et non comme une sanction. Elle sera éventuellement abolie en 1772.
Statut de Westminster I, 3 Edw. 1, art. 12, dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, p. 29; Peine forte et dure, 1306 and 1326, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, pp. 566-567.
Peine forte et dure
Gravure du Melefador's Register de 1780

Par. 470 Pourquoi un prisonnier résistait-il ? Ce n’était pas qu’il cherchait à tout prix à éviter un procès avec jury, mais, au risque de nous répéter, il ne voulait surtout pas d’un jury composé des mêmes personnes qui l’avait accusé. L’injustice semblait évidente aux yeux de tous. Même le prince Édouard, le futur Édouard II (règne 1307-1327), dont un ami avait été inculpé de meurtre en 1305, a demandé au juge présidant le procès d’exclure du petit jury tous ceux qui avaient siégé sur le jury d’accusation. Il y avait un autre avantage à refuser de plaider, même si la mort devait en être l’issu pour le prisonnier. L’accusé reconnu coupable de félonie, au terme d’un procès, était pendu et ses biens confisqués, alors que celui qui mourait sous le régime de peine forte et dure continuait d’être présumé innocent et ses biens passaient alors à ses héritiers. Nous y reviendrons à la partie 10.5.
E.H.D., id., p. 566; LEVY, préc. au par. 465, pp. 20 et 22.
9. Héritiers plantagenêts de la Grande Charte
9.1 Naissance du Parlement de Westminster
Par. 471 La Magna Carta ou Grande Charte aurait pu n’être qu’une parenthèse vite oubliée, une anecdote sans importance. Mais la conjoncture lui a permis de renaître pour s’intégrer durablement dans la Constitution anglaise.
Par. 472 En effet, l’héritier de la Couronne à la mort de Jean, Henri III (règne 1216-1272), n’avait que neuf ans lorsqu’il est devenu le roi. Un conseil de régence dirigé par le Guillaume le Maréchal a donc gouverné à sa place. Celui-ci, à l’âge de 70 ans, au crépuscule de sa vie, n’avait aucune autre ambition que d’assurer le salut du royaume et de la Couronne. Or, la situation restait précaire pour l’enfant roi. La guerre, commencée sous le précédent règne, se poursuivait. Louis de France, le futur Louis VIII, qu’on surnommera le Lion, contrôlait toujours le sud-est de l’Angleterre et les barons rebelles avaient repris l’avantage dans le Nord. Certes, le décès de Jean, le souverain honni, avait déjà affaibli le soutien dont Louis jouissait auprès de la noblesse anglaise. Guillaume le Maréchal tentera d’encourager de possibles défections en adoptant une version expurgée de la Magna Carta le 12 novembre 1216, sans toutefois obtenir l’effet recherché, puisque la plupart des rebelles ont continué le combat auprès de leur allié français. Guillaume les a finalement vaincus sur le champ de bataille de Lincoln le 20 mai 1217. Cette défaite a refroidi l'ardeur du dauphin Louis qui a rapatrié ses troupes en France, non sans exiger auparavant le versement d’une forte somme d’argent, en application des termes d’une paix qu’il venait de signer, le Traité de Lambeth du 11 septembre 1217. Le traité pardonnait également aux barons d’avoir pris les armes contre leur roi. Ce bon geste a permis à Guillaume d’amener les barons à négocier et à réconcilier enfin le royaume.
FAVIER, préc. au par. 348, pp. 729-732; N. VINCENT, « Magna Carta : from King John to Western Liberty », dans GOLDMAN, préc. au par. 412, p. 33; P. MEYER, Histoire de Guillaume le Maréchal, vol. 3, Paris, Librairie Renouard, 1901, pp. 215-250.
Gisant du roi Henri III
Abbaye de Westminster

Par. 473 Peu après, Guillaume le Maréchal a convoqué une assemblée des hauts barons et des prélats pour le 6 novembre 1217, dont l’objectif était l’adoption d’une seconde version révisée de la Grande Charte. La rencontre s'est déroulée dans de bonnes conditions et tous se sont montrés satisfaits d'en ressortir avec cette Magna Carta remaniée. Parmi les changements les plus notables apportés au document original, on avait aboli la commission de 25 barons prévue à l’article 50 qui devait veiller au respect des droits énoncés, de même que les articles 12 et 14 où l’on exigeait l’approbation du Conseil commun du royaume avant la levée de tout nouvel impôt ou taxe. Le compromis a rallié aussi bien les barons rebelles que ceux demeurés loyaux à la Couronne. C’est seulement alors que le document a pris le nom de Magna Carta, afin de le distinguer de la Charte de la forêt (Charter of Forest) adoptée le même jour.
FAVIER, id., pp. 732; VINCENT, id., p. 34; H.J. LAWLOR, « An Unnoticed Charter of Henry III, 1217 », (1907) vol. 22 English Historical Documents 514, pp. 514-518.
Par. 474 Lorsqu’il a atteint ses 18 ans, en 1225, Henri III a ratifié en personne en apposant son grand sceau une troisième version révisée de la Grande Charte, en échange de l’approbation par le Conseil commun du royaume à la levée d’un impôt équivalent au quinzième de la valeur des propriétés foncières, un fifteenth. Il manquait effectivement à Henri l’argent nécessaire pour se rendre guerroyer en France. Or, la guerre, une entreprise très coûteuse, ne se finançait pas avec les revenus réguliers de la Couronne. Obtenir cette approbation est-il toujours nécessaire d'après cette version de la Magna Carta ? Que les articles 12 et 14 en aient été retirés ne changeait rien aux rapports de force : lever un nouvel impôt sans l’accord des grands comportait toujours de grands risques pour le roi et pour son trône. Consentir à l’impôt deviendra donc rapidement la coutume tout autant qu’une nécessité politique.
FAVIER, id., p. 741.
Par. 475 Il est intéressant ici d’établir un parallèle avec la situation pré-révolutionnaire des futurs États-Unis d’Amérique. L’un des motifs ayant justifié la Déclaration d’indépendance de 1776 a été l’obligation faite aux colons américains de payer des taxes à la Couronne anglaise, malgré l’absence de représentation de ces mêmes colons au sein du Parlement de la Grande-Bretagne. À cela, les membres de l’assemblée législative du Massachussetts, l'une des 13 colonies fondatrices des États-Unis d'Amérique, ont répondu, le 29 octobre 1765 : « No taxation without representation », en invoquant la Magna Carta, telle qu’elle sera interprétée par le juriste anglais sir Edward Coke au XVIIe siècles.
H.T. DICKINSON, « Magna Carta in the American Revolution », dans GOLDMAN, préc. au par. 412, pp. 90-91.
Par. 476 C’est la version de la Magna Carta de 1225 qui sera reproduite en 1297 dans le registre des statuts du Parlement naissant. Elle sera relue de manière routinière lors de la séance d’ouverture de chaque nouveau Parlement et confirmée plus de 30 fois, d’après un calcul de sir Edward Coke dans une décision de justice de 1596. La dernière confirmation enregistrée par le Parlement de Westminster aurait été celle d’Henri V, souverain de la famille de Lancastre, le 19 octobre 1416. C’est ainsi, grâce aux multiples répétitions de sa confirmation, ainsi que par diverses lois de mise en œuvre, que l'on considèrera que les demandes formulées par les barons à Runnymède ont été pour la plupart incorporées durablement dans le droit du royaume.
E. COKE, The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, vol. 1, Indiannapolis, Liberty Fund, 2003, pp. 442 et 473. Lire également Clark’s Case, (1596) Trinity Term, 38 Elizabeth I, dans E. COKE, The Reports of Sir Edward Coke, 1572-1617, nouvelle édition, vol. 3, Londres, Joseph Butterworth and Sons, 1826, p. 129 ou 64a. Magna Carta de 1225 reproduite en 1297 dans le registre des statuts du Parlement : The Great Charter of the Liberties of England and of the Liberties of the Forest, 25 Edw. 1, c. 1, dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 114-119. Voir aussi Charters and Statutes Confirmed, 4 Hen. V., c. 1, dans Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, p. 196, pour la dernière confirmation de la Charte par le Parlement.
Copie originale de la Magna Carta de 1297
National Archives, Londres

Par. 477 Revenons sur les péripéties entourant la première partie du règne d’Henri III. Celui-ci a attendu 1227 avant de prendre les rênes de son gouvernement. Sur les conseils de l’évêque de Winchester, Pierre des Roches (Guillaume le Maréchal était mort entretemps), Henri s’est donné comme objectif de réparer les échecs de son père Jean en récupérant l’héritage ancestral des Plantagenêts : la Normandie, la Bretagne, le Grand Anjou et le Poitou. L’ambition, quoique noble de son point de vue, se révélera coûteuse. Parce que les prélats et les hauts barons ne partageaient pas son enthousiasme, Henri n’a pu compter que sur ses seules ressources financières pour préparer sa première expédition en 1230. Mal financée, elle s’est conclue sur un échec. Henri a réalisé qu’il lui faudrait davantage de ressources. Il s’y emploiera en 1253.
Par. 478 Malgré la disparition des articles pertinents de la Magna Carta, Henri, au cours de son règne, semblait néanmoins avoir reconnu le bien-fondé d’obtenir le consentement de la noblesse d’Angleterre s’il souhaitait obtenir les impôts voulus, qu’il employait ensuite à divers usages. Le 15 janvier 1237, puis à nouveau le 23 février 1245, et encore le 15 avril 1253, celle-ci, réunie en Conseil commun, lui a alors consenti des aides financières spéciales, en échange du renouvellement de la Grande Charte. Toutefois, Henri ne se montrera pas toujours aussi sage, ce qui lui attirera quelques ennuis sur lesquels nous reviendrons.
RAMSEY, préc. au par. 271, p. 293 (vote des aides de 1237 et lecture des deux chartes), pp. 302-303 (vote des aides de 1245 et lecture des deux chartes), p. 313 (vote des aides de 1253 et lecture des deux chartes).
Par. 479 Les impôts votés en 1253 ont permis au roi Henri III de financer une seconde expédition militaire en France. Elle s’est révélée aussi infructueuse que la précédente. Le Traité de Paris de 1259 a enfin mis un terme aux ambitions d’Henri sur le continent. Ses clauses lui ont permis de conserver une Aquitaine rétrécie, renommée Guyenne pour l’occasion, ainsi que le Limousin, le Quercy, l’Agenais, le Périgord presqu’entier, la partie de la Saintonge au sud de la Charente et des fiefs en Auvergne, à la condition de se reconnaître le vassal du roi Louis IX pour ces fiefs. La Guyenne comprenait pourtant des parties de l’ancienne Gascogne, Béarn, Soule et Bigorre, des terres souveraines adossées aux Pyrénées, dont le seigneur n’avait jamais accepté depuis des lustres de prêter allégeance à quelque puissance, qu’elle soit l’Angleterre, la France, l’Aragon ou la Castille. Le traité de 1259 n'a rien changé, a rappelé Gaston VII de Béarn au roi anglais Édouard Ier (règne 1272-1307), frustré par l'attitude de ce vassal récalcitrant. Tous les seigneurs du Béarn, de la Soule et du Bigorre ont continué à réclamer et à défendre leur indépendance.
M. GAVRILOVITCH, Étude sur le Traité de Paris de 1259 entre Louis IX, roi de France, & Henri III, roi d’Angleterre, Paris, Librairie Émile Bouillon éditeur, 1899, pp. 67 à 75 (questions territoriales) et pp. 75 à 83 (hommages dues par Henri III et ses seigneurs au roi de France). Voir aussi notre site www.histoire-du-bearn.fr pour se familiariser avec l’histoire si particulière du sud-ouest de la France.
Carte 11
Possessions françaises du roi Henri III après le Traité de Paris de 1259
Carte de Auguste de Longnon, 1889

Par. 480 L’attitude respectueuse d’Henri II à l’égard de la levée des impôts dépendait davantage de la conjoncture que d’un nouveau respect pour ses barons. En effet, lorsque Henri a cru pouvoir s’en tirer indemne, il n’a pas hésité à passer outre à leurs droits et libertés les plus fondamentaux. Il a notamment commis l’erreur, en 1232, de révoquer d’anciennes concessions de terres pour les redonner à des mercenaires étrangers, en violation de l’article 29 de la Magna Carta dans sa version de 1225 (article 39 dans celle de 1215) qu’il avait lui-même adoptée. C’était un retour aux errements du règne de son père. Tous les barons craignaient à nouveau pour leurs propriétés. La Grande Charte est la loi du pays, ont repris en chœur les barons, qui se sont dits prêts à la défendre. Après une période de résistance passive de leur part, de non-collaboration, les violences ont repris. Henri a d’abord fait appel à ses mercenaires flamands au cours du mois août 1233 pour les contraindre à l’obéissance, a continué à les combattre huit mois durant, jusqu’à ce que Edmond Rich de Abingdon, plus tard saint Edmond de Cantorbéry, le nouveau primat de l’Église d’Angleterre depuis le 2 avril 1234, le ramène à la raison. Henri s’est alors résolu à revenir sur ses positions. De mauvais ministres ont été congédiés. Le Conseil commun du royaume, lors d’une rencontre tenue en mai 1234, a pu dès lors rétablir dans leurs droits ceux dont les terres avaient été confisquées. Pour enfoncer le clou, le jurisconsulte Bracton, dont on peut penser qu’il a possiblement rédigé ces lignes un peu avant ou un peu après cette crise de deux ans, a écrit dans son traité sur la common law que c’est la loi qui fait le roi et non l’inverse, et que la loi doit tempérer l’exercice de son pouvoir en le maintenant en bride.
RAMSEY, préc. au par. 271, pp. 288-290; BRACTON, vol. 2, préc. au par. 428, p. 33.
Par. 481 Malheureusement, Henri III n’avait pas compris la leçon. Les infractions au droits et libertés des Anglais se sont poursuivies. Mais elles ne portaient plus sur des confiscations de terres, plutôt sur des interventions du roi dans le domaine de la justice comme des délais pour l’obtenir, si elle n’était pas simplement refusée, en violation de l’article 29 de la Magna Carta de 1225 (articles 39 et 40 de la version de 1215). La coupe des barons était pleine. Lorsqu’Henri les convoqua en Parlement à Westminster le 28 janvier 1242, toujours à court d’argent pour financer ses aventures militaires, ils s’entendirent ensemble à ne lui consentir aucun subside pécuniaire que le roi chercherait à leur extorquer. Le chroniqueur Matthieu Paris nous a appris que les barons ont justifié leur refus en avançant divers motifs, maladministration, incompétence militaire, mais aussi le fait qu’Henri « n’avait jamais observé sa charte de liberté, que même il avait, depuis [le 15 janvier 1237, date du dernier subside], commis plus de vexations qu’à l’ordinaire ».
PARIS, préc. au par. 405, vol. 5, p. 252; The king refused an aid, 1242, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, pp. 355-357.
Par. 482 Sous le règne d’Henri III, on a commencé à faire usage du mot Parlement (Parliament en anglais) pour désigner la Cour du roi dans sa formation la plus large, lorsque le roi y invitait tous les hauts barons et les prélats, en plus des ministres de la Couronne. Son premier usage officiel en Angleterre remonte à 1236 et s’est répandu par la suite. Il ne s’agissait pas encore du Parlement que l’on connaîtra plus tard. Ce mot n’était qu’une nouvelle manière de nommer la Cour du roi en formation plénière, au lieu de l’expression Conseil commun du royaume se trouvant dans la Magna Carta. Parlement venait du mot français parler. Il servait notamment à désigner une discussion formelle entre une personne en autorité et ses agents. Un léger glissement terminologique l’a rendu tout à fait approprié pour désigner une rencontre tenue par un roi avec ses vassaux.
H.G. RICHARDSON et G.O. SAYLES, « The Earliest Known Official Use of the Term “Parliament” », (1967) vol. 82 The English Historical Review 747, p. 749; A.J. GREIMAS, Grand dictionnaire Ancien français, La langue du Moyen-Âge de 1080 à 1350, Paris, Larousse, p. 443, au mot parler.
Par. 483 Des représentants des shires ou comtés (i.e. shires où un comte avaient été nommé) ont été invités à participer au Parlement de 1254. Ils répondaient au nom de chevaliers de shire ou de comté (knights of the shire).Tous n’étaient pas réellement des chevaliers. Il s’agissait plus d’un titre désignant la fonction de député des communautés du royaumes, que l'on appellera en court les communes. En réalité, tout baron inférieur (barones minores), chevalier ou propriétaire foncier aisé pouvait se présenter aux élections destinées à les choisir. Ces hommes composaient la nouvelle classe sociale en ascension au XIIIe siècle que l’on connaîtra sous le nom de gentry. Ceux qui n’étaient pas déjà titrés chevaliers se feront plus tard appeler des écuyers (squire ou esquire) ou des gentilshommes (gentlemen). Aujourd’hui, on dirait qu’ils étaient les bourgeois. Parce que leur richesse augmentait, il devenait politiquement opportun de les consulter, si le roi souhaitait accroître leur contribution fiscale. D'ailleurs, pour les décennies à venir, le roi limitera leur participation aux seuls Parlements convoqués pour la levée de nouveaux impôts.
J. SCAMMELL, « The Formation of the English Social Structure: Freedom, Knights, and Gentry 1066-1300 », (1993) vol. 68 Speculum 591, pp. 613 et 616. Lire aussi P.R. CROSS, « The Formation of the English Gentry », (1995) No. 147 Past and Present 38-64.
Par. 484 Le plus ancien précédent d’une représentation populaire au sein de la Cour du roi remonterait possiblement à 1213, quand des membres de la petite noblesse y ont été invités par Jean. Le roi, manifestement, connaissait déjà le principe de la représentation, soit le fait que des personnes puissent agir au nom d’un groupe plus large. Nous ignorons comment ils auraient été choisis. Comme aucune preuve n’existe de cette assemblée, il est même possible qu’elle ait été annulée par la suite, qu’elle n’a donc jamais eu lieu. Toutefois, lors du Parlement de 1226, sous le règne d’Henri III, des élections ont été tenus dans chaque comté. L’expérience a été répétée en 1254, à la différence près que les chevaliers de comté ont reçu pour la première fois le mandat exprès d’agir au nom de leur communauté, conformément à la règle de la représentation. Derrière les lords, pairs du royaume, soit les hauts barons et prélats en position assise, on voyait donc, se tenant debout, des chevaliers de comté avec pour mission de représenter les communautés du royaume, d’où le terme de communes servant à les désigner.
HOLT, préc. au par. 436, pp. 5-9; H.P. TUNMORE, « The Dominican Order and Parliament : An Unsolved Problem in the History of Representation », (1941) vol. 26 The Catholic Historical Review 479, pp. 479, 485-489 (sur les experiences de 1213 et de 1227); A.B. WHITE, « Some Early Instances of Concentrations of Representatives in England », (1914) vol. 19 The American Historical Review 735, pp. 736-742 (sur l’expérience de 1226); et G.B. ADAMS, The Origin of the English Constitution, New Haven, Yale University Press, 1920, pp. 317-322 (sur l’expérience de 1254).
Par. 485 Le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, afin de choisir les chevaliers de comté, aurait été employé en Angleterre depuis aussi loin qu’on s’en souvienne; c’est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans une circonscription qui remportait le siège lors d’un vote se tenant normalement à main levée. Nous y reviendrons au chapitre 10.
Par. 486 Une autre initiative d’Henri III, qui s’est également mal terminée, mais avant même d’avoir commencé, a été de vouloir prendre la Couronne de Sicile pour en coiffer son fils Edmond. Toujours à court d’argent, Henri a convoqué un nouveau Parlement à Westminster pour le 9 avril 1258 en vue de débattre du financement de l’opération. Il lui a également demandé de voter les sommes nécessaires à la suppression des révoltes au pays de Galles et au rétablissement des finances du pape Alexandre IV. C’en était trop pour les barons et pour leur chef de file Simon de Montfort, un noble d’origine française mais néanmoins 6e comte de Leicester.
J.R. MADDICOTT, Simon de Montfort, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 152-153.
Par. 487 Les griefs des barons ne se comptaient plus. Quelques années plus tard, ils les exposeront en détails en présence du roi de France. Ils se plaindront des violations par Henri de la Magna Carta, de son exploitation sans retenu des biens de l’Église, des faveurs, des terres et de l’argent donnés à son entourage à la Cour et aux étrangers, au préjudice de ses sujets et des finances du royaume, puis de la rapacité de ses officiers dans les comtés, ainsi que du gaspillage occasionné par son aventure sicilienne.
Par. 488 La mention de son entourage et des étrangers était une allusion aux méfaits des Lusignan, soit Guillaume de Valence, Guy de Lusignan, Geoffroy de Lusignan, Adhémar de Valence et leur sœur Alix, une fratrie arrivée en Angleterre en 1247. Ils étaient les demi-frères d’Henri III par leur mère Isabelle d’Angoulême. C’était leur seul mérite. Ils n’étaient pas particulièrement agréables et surtout entretenaient un fort sentiment que tout leur était dû. Le roi, afin d’assurer leur avenir, les a comblés de bienfaits dès leur arrivée, attisant ainsi la jalousie de la noblesse d’Angleterre. Alix a été marié au jeune comte de Surrey, Jean de Warenne. Guillaume est devenu comte de Pembroke et seigneur de Wexford grâce à son mariage avec une riche héritière, Jeanne de Montchenu. Guy et Geoffroy se sont vus octroyer des rentes et la promesse de terres rapportant la même somme dès que possible. Enfin, Adhémar a été élu évêque de Winchester. C’était à la fois beaucoup et trop rapide pour être accepté sans susciter la colère.
MADDICOTT, id., pp. 127, 128, 151 et 153.
Par. 489 Lors de la rencontre de Westminster, en avril 1258, les barons en colère ont exigé du roi, s’il voulait obtenir des parlementaires le vote de subsides, qu’il mette sur pied un comité constitutionnel ayant pour mandat de discuter des réformes nécessaires à la gouvernance du royaume. Douze membres ont été choisis par Henri et douze autres par les barons. Le roi et son fils aîné Édouard ont juré d’accepter leurs recommandations. Ils étaient d’ailleurs prêts à jurer n’importe quoi tant leur situation semblait précaire. Pour l'instant, leur sécurité, voire leur vie, dépendaient du bon vouloir de leurs opposants.
Par. 490 Le comité constitutionnel s’est réuni le 11 juin 1258 dans une atmosphère de crise, alors que chacun s’armait pour parer à toute éventualité. Son rapport a pris la forme d’une série de propositions qui ont été entériné par le Parlement réuni cette fois à Oxford. Voilà pourquoi elles sont connues des historiens sous le nom de Provisions d’Oxford. En raison de leur caractère par trop audacieux, l’assemblé d’Oxford a été surnommée le Parlement Fou (Mad Parliament).
MADDICOTT, id., pp. 156-159.
Par. 491 En effet, les Provisions d’Oxford recommandaient que le gouvernement du royaume soit placé sous la direction conjointe du roi et d’un nouveau conseil de 15 barons qui l’éclairerait sur tout sujet d’importance. Le nouveau conseil devait être constitué en suivant une procédure alambiquée. Chacun des deux groupes de 12 membres formant le comité choisirait deux membres dans l’autre groupe. Les quatre hommes sélectionnés choisiraient à leur tour un conseil de 15 barons, sujet à l’approbation de l’ensemble des 24 membres du comité constitutionnel. Ce conseil devait se réunir au moins trois fois par année pour discuter des affaires intéressant le pays. Le choix des grands officiers du royaume, chancelier, trésorier, juges et autres personnages d’importance lui serait soumis pour son approbation. Tous hommes, en réalité les futurs ministres de la Couronne, autrement dit les membres du gouvernement, jureraient fidélité à la fois au nouveau conseil et au roi. La garde des châteaux et des autres places fortes serait placée sous l’autorité de ce même conseil qui les remettrait à des personnes de confiance. Enfin, quatre chevaliers par comté seraient nommés afin de recueillir les plaintes contre les shérifs et les autres officiers du roi pour en rendre compte au conseil. Henri III et son fils, tenus par la parole donnée en avril dernier, ont juré de se conformer au nouvel ordre constitutionnel proposé dans les Provisions d’Oxford, une promesse qui sera cependant vite oubliée dès qu’ils le pourront.
So-called Provisions of Oxford (1258), E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, pp. 361-367; Proclamation of 18 October 1259, E.H.D., id., p. 367. Pour plus de details, lire H.G. RICHARDSON, G.O. SAYLES, et H. GUPPY, The Provisions of Oxford : A Forgotten Document and some Comments, Bulletin of the John Rylands Library, Manchester, 1933.
Henri III face à la Commission des barons dirigée par Simon V de Montfort
Illustration de James Doyle, A Chronicle of England, Longmans, Green & Co., Londres, 1864

Par. 492 Les Lusignan ont été bannis et poursuivis par Henri, le fils aîné de Simon de Montfort, jusqu’en France. Des amis de Montfort ont immédiatement occupé les châteaux et places fortes et remplacé les anciens shérifs. Même les lettres rédigées au nom du roi étaient désormais dictées par ses barons. À toute fins utiles, le roi avait été placé en tutelle, dépouillé de quelque autorité réelle.
MADDICOTT, préc. au par. 486, pp. 163-164.
Par. 493 Henri III a renié sa parole aussitôt qu’il s’est cru suffisamment fort pour se battre et vaincre ses adversaires. Il a d’abord dénoncé les concessions arrachées à Oxford en s’adressant au pape Urbain IV pour être relevé de son serment de les respecter. Ce serment ayant été obtenu sous la contrainte, il devenait illégitime, plaidera Henri. Le roi de France Louis IX a été choisi par le pape pour arbitrer le litige entre Henri et ses barons. Ce fut la cause d’une nouvelle épreuve de force qui a débuté en 1263. Louis IX a convoqué les belligérants à sa Cour pour les entendre. Mais Simon de Montfort a bien sûr refusé de s’y rendre. Quelques mois plus tard, en janvier 1264, Louis a rendu un jugement sans surprise en faveur d’Henri qui annulait la totalité des Provisions d’Oxford. Les Lusignan ont été rétablis dans leurs droits. La reprise des hostilités devenait inévitable.
MADDICOTT, id., p. 216; I.J. SANDERS (éd.), Documents of the Baronial Movement of Reform and Rebellion 1258-1267, Oxford, Clarendon Press, 1973, pp. 258-261.
Par. 494 Simon de Montfort et ses alliés ont remporté la bataille de Lewes le 14 mai 1264. Leur victoire apparaissait cependant incomplète, car le roi Henri et son héritier le prince Édouard avaient réussi à s’échapper. Des négociations ont été menés. Un accord de principe a renouvelé les Provisions d’Oxford tout en admettant le besoin de les réviser. Les escarmouches ont néanmoins rompu la trêve. Et Henri III a finalement été capturé. C’est alors, en ce jour du 14 décembre 1264, que Simon de Montfort obligea le roi à convoquer le célèbre Parlement qui a commencé ses travaux le 20 janvier et se prolongea jusqu’en mars 1265. La convocation rédigée par ses soins démontrera qu’il entendait bien consulter toute la nation (community of the nation).
Par. 495 Ce Parlement de 1265 fera date car, afin de compenser la perte de plusieurs appuis chez les barons, Montfort, en plus des hauts barons et des prélats, y a invité les membres de la gentry à participer à ses travaux. Certes, il pouvait se fonder sur de rares précédents pour organiser des élections dans les comtés, mais il innovait en le faisait également pour les bourgs, les cités et les ports de mer. On a procédé à l’élection de deux bourgeois ou citoyens par agglomération urbaine et de deux chevaliers par comté. Toutes les communautés du royaume se trouvaient ainsi associés aux décisions sur la gouvernance du royaume. Il va sans dire que les parlementaires mirent à l'agenda la confirmation de la Magna Carta dans sa version de 1225. Pour le reste, on connaît très peu le contenu de leurs travaux.
MADDICOTT, id., 307-309; SANDERS, id., pp. 51-53. Lire également S.T. AMBLER, « Magna Carta : It's Confirmation at Simon de Montfort's Parliament of 1265 », (1215) vol. 130 The English Historical Review 801-830.
Par. 496 L’avantage de Simon de Montfort n’a pas duré. Le prince héritier Édouard, toujours en liberté, aidé du 7ecomté de Gloucester, Gilbert de Clare, a repris l’initiative en remportant la bataille d’Evesham, le 4 août 1265, au cours de laquelle Montfort a été tué. Les vestiges de l’armée rebelle, repliés dans la forteresse de Kenilworth, ont capitulé en 1266 contre la promesse du roi de leur pardonner et de respecter les libertés et les chartes antérieures. Montfort n’aura donc pas connu d’autre Parlement. Toutefois, il avait posé les fondements de ce qui allait devenir cette institution pour les siècles à venir.
Par. 497 Outre les expériences parlementaires de 1227, 1254 et 1265, Henri III a innové au printemps de 1234 en mettant sur pied une autre cour centrale de common law, la Cour du banc du roi (Court of King’s Bench en anglais), à qui il incombait d’entendre les litiges intéressant la Couronne. S’il est besoin d’une date plus précise, le premier registre de la Cour du banc du roi remonterait au 19 juin 1234. Mais elle n’a atteint sa maturité pour en faire l’égale de la Cour des plaids communs qu’au printemps de 1236. Henri a également suivi l’exemple de Montfort lorsqu’il a convoqué son Parlement d’avril 1268. En effet, il a invité les cités et les bourgs à élire des représentants avec le pouvoir de lier leur circonscription. L’exigence d’un tel mandat de la part des électeurs constituait également une nouveauté depuis 1254. Nous reviendrons plus loin, aux parties 10.4 et 10.5, sur ces évolutions judiciaire et législative.
TURNER, préc. au par. 383, pp. 248-251; W. STUBBS, The Constitutional History of England, vol. 2, 4e éd., Londres, Oxford, Clarendon Press, 1896, pp. 146-147; J.R. MADDICOTT, « The Earliest Known Knights of the Shire : New Light on the Parliament of April 1254 », (1999) vol. 18 Parliamentary History 109, pp. 111-112.
Par. 498 Les six dernières années du règne d’Henri III se sont déroulées sans incident majeur. Il les a consacrées pour une large part à enseigner le dur métier de roi à son aîné Édouard. Henri est mort le 16 novembre 1272. Son fils, maintenant Édouard Ier, surnommé Longues Jambes (Longshanks), a été couronné le 21 novembre 1272.
Portrait fictif du roi Édouard Ier
Abbaye de Westminster
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 499 Édouard Ier (règne 1272-1307) a prononcé le serment habituel en début de règne de protéger les droits du peuple et de l’Église, de prévenir la rapacité et l’oppression, de faire justice de manière impartiale et avec clémence, tout comme de maintenir les lois de ses prédécesseurs. Il a ajouté à cette liste la promesse de protéger les droits de la Couronne. Ce n’est qu’en 1297, donc après quelque hésitation, qu’il a ordonné le maintien de la Magna Carta concédée par son grand-père Jean et confirmé par son père Henri III, une action qui a été colligée dans le tout nouveau registre des statuts du Parlement.
H.G. RICHARDSON, « The English Coronation Oath », (1941) vol. 23 Transaction of the Royal Historical Society 129, p. 131; The Great Charter of the Liberties of England, And of the Liberties of the Forest, Confirmed by King Edward, in the Twenty-Fifth Year of his Reign, 25 Edw. I, 1297, dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 114-124.
Par. 500 Édouard a convoqué pour les 22 avril et 13 octobre 1275 ses deux premiers Parlements. Ils étaient composés de lords, les hauts barons et les prélats, ainsi que de représentants élus, ces chevaliers, bourgeois et citoyens ayant le mandat de parler au nom de leur communautés, à l’image du Parlement de Montfort dix ans plus tôt. La seule différence tenait au nombre de représentants : les brefs d’élections prévoyaient qu’il devait y avoir quatre chevaliers par comté et de quatre à six bourgeois ou citoyens par agglomération urbaine. Édouard a continué sur sa lancée en convoquant régulièrement des Parlements. Il était rare que deux ans s’écoulent sans qu’il en réunisse un à nouveau. On en a même compté trois dans une même année. Mais ils duraient peu, parfois seulement une ou deux semaines, normalement trois ou quatre semaines, rarement davantage, et ils étaient toujours limités à une seule session, juste le temps de régler quelques affaires urgentes. Les parlementaires se rencontraient un peu partout, surtout à Westminster, mais aussi à Londres, Oxford, Winchester, Northampton, Gloucester ou Shrewsbury.
STUBBS, vol. 2, 4e éd. 1896, préc. au par. 497, pp. 113-114 et p. 234, note infrapaginale 5; P. BRAND, « The Development of Parliament, 1215-1307 », dans C. Jone (éd.), A Short History of Parliament, Boydell Press, Woodbridge (Suffolk), 2009, pp. 11-12.
Par. 501 Ces fréquentes réunions du Parlement ont été l’une des caractéristiques du règne d’Édouard Ier, ce qui a conféré une grande légitimité à l’institution. Parfois Édouard ne convoquait que les pairs du royaume et ses ministres, autrement dit sa Cour féodale en formation plénière, parfois il y ajoutait des représentants élus des communes, uniquement des chevaliers ou des chevaliers et des bourgeois en plus ou moins grand nombre. Quand il y en avait, leur nombre pour chaque circonscription pouvait varier d’un Parlement à l’autre, entre deux et six, pour se fixer à deux lors de l’assemblée de 1295, celle que l’on a surnommé le Parlement modèle. C’était selon les besoins du moment et les souhaits du roi.
Par. 502 Toutefois, il devenait de bonne politique pour le roi de consulter davantage la petite noblesse, les paysans aisés, les bourgeois et les commerçants, parce que ceux-ci, la classe sociale de la gentry, accaparaient une part grandissante de la richesse du pays. Le roi Édouard Ier et son fils Édouard II les ont donc associés progressivement à l’exercice du pouvoir, tant au sein de leur gouvernement que de leurs Parlements, dès lors que des questions politiques ou constitutionnelles d’importance étaient abordées. On sait, en effet, qu’environ un tiers des Parlements d’Édouard Ier ont compris des élus. Cette proportion a augmenté par la suite, sous le règne d’Édouard II (1307-1327), jusqu’au jour, peu après l’avènement de leur successeur Édouard III, en 1327, où il était devenu impensable de convoquer une assemblée répondant au nom de Parlement sans y inclure des députés des communes.
STUBBS, id., pp. 113-114, pp. 113-165; JENKINSON, « The First Parliament of Edward I », (1910) vol. 25, The English Historical Review 231, p. 233; G. LAPSLEY, « Knights of the Shire in the Parliaments of Edward II (Continued) » (1919) The English Historical Review 152, p. 171; W.A. MORRIS, « The Beginning of the House of Commons », (1933) vol. 2 Pacific Historical Review 141, p. 153.
Par. 503 Le Parlement a réclamé pour lui les pouvoirs législatif et judiciaire exercés par la Cour du roi, l’organe dont il était issu. Autour de l'année 1290, on a pris l’habitude d’appeler ses lois des statuts et convenu qu’il fallait tenir des registres (statute rolls) pour les conserver en mémoire. Ces registres, dont le plus vieux ayant survécu remonte justement à 1290, seront plus tard compilés et réorganisés sous la forme d’un ouvrage comprenant plusieurs volumes intitulés The Statutes of the Realm, d’abord publiés en 1810 par ordre du roi George III, puis réimprimés en 1963.
9.2 Prétentions anglaises sur le pays de Galles et l'Écosse
Par. 504 Dès l’intronisation d’un nouveau roi, l’usage féodal commandait à tous ses vassaux de lui prêter serment. Le prince du pays de Galles, Llevelyn le Dernier (Llywelyn ap Gruffudd en gaélique), dont le territoire dépendait de la Couronne d’Angleterre au moins depuis le Traité de Montgomery du 29 septembre 1267, a pourtant refusé de se présenter aux Parlements d’octobre 1275 et de novembre 1276 afin de renouveler son allégeance. Il faut savoir que les Gallois, un peuple farouche, avaient réussi à conserver leur indépendance de l’Angleterre tant bien que mal durant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, quoique sur une portion rétrécie de leur principauté. Certes, Henri III avait réclamé et reçu l’hommage des seigneurs gallois en 1247. Il n’était question cependant que d’une sujétion plus théorique que réelle. Pour sa part, Llevelyn, avant de prendre le titre de prince de Galles, s’était montré plus ennuyé par les querelles intestines avec les seigneurs de son pays que par les ambitions de son voisin plantagenêt. Toutefois, lorsqu’il a refusé de se rendre en Angleterre afin de rendre l’hommage dû à son fils Édouard Ier, ce dernier en a pris prétexte pour remettre en cause l’autonomie galloise.
Par. 505 Le 12 novembre 1276, avec le soutien de son Parlement, Édouard s’est décidé à déclarer la guerre à Llevelyn et à son héritier le prince David. La conquête de la Galles a été achevée en quelques mois. Ses habitants se sont révoltés contre l’occupant cinq ans plus tard, ce qui a obligé Édouard à y retourner. Son succès a été aussi rapide. Bien décidé à stabiliser la situation et à consolider son emprise, le roi anglais a procédé cette fois à une réorganisation administrative du pays pour l’incorporer à son royaume. Il a sanctionné, en mars 1284, les Statuts de Galles, aussi connu comme les Statuts de Rhuddlan, des lois galloises qui reconnaissaient sa souveraineté sur ce territoire et le divisait en shires, à l’image de son royaume anglais. Les habitants, maintenant des sujets anglais, étaient désormais soumis à la common law anglaise. Le pays de Galles demeurait néanmoins un territoire distinct de l’Angleterre. Il se comparait à une marche. Pour l’attacher définitivement à sa Couronne et à celle de ses successeurs, Édouard a conféré le titre de prince de Galles à son fils aîné, lui aussi prénommé Édouard, le futur Édouard II. Depuis, il est devenu coutume pour un roi d’Angleterre d’accorder ce titre à son héritier présomptif. L’actuel prince de Galles est le fils aîné du roi Charles III, autrefois William Windsor, devenu William de Galles ou William of Wales après sa nomination le 8 septembre 2022.
The Statutes of Whales (Statuts de Rhuddlan), 1284, reproduits dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 55-68. L’intégration complète du pays de Galles à l’Angleterre devra cependant attendre l’adoption par le Parlement de l’Acte du pays de Galles de 1536 (An Acte for Lawes & Justice to be ministred in Wales in like fourme as it is in this Realme), 27 Hen. 8, c. 26, Statutes of the Realm, vol. 3, 1817, réimpression de 1963, pp. 563-68.
Par. 506 L’Écosse a représenté un autre point chaud pendant le règne d’Édouard Ier. Plus encore que le pays de Galles, l’Écosse avait conservé une indépendance à peu près complète de l’Angleterre. Le roi des Écossais. Alexandre III, a attendu 1278 avant de prêter l’hommage à son seigneur Édouard, non pour son royaume mais seulement pour les terres qu’il possédait en Angleterre. En effet, Alexandre ne semblait pas prêt à reconnaître qu’il tenait sa Couronne du roi anglais. Édouard n’en a pas pris ombrage, contrairement à son attitude à l’égard du prince gallois.
Par. 507 Alexandre est mort en 1286 sans héritier direct. De nombreux postulants ont revendiqué son trône parmi lesquels Jean Balliol, Robert Bruce, ainsi que Marguerite de Norvège, la petite-fille du roi défunt, une enfant âgée de trois ans. Il n’empêche, Marguerite a été reconnue comme son héritière légitime en 1284, avant que sa mort prématurée en 1290 ne relance le débat sur la succession écossaise.
G.W.S. BARROW, Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland, Edinburgh University Press, Édimbourg, 1988, pp. 13-29.
Par. 508 Après avoir mentionné son supposé titre de suzerain du royaume d’Écosse, une nouvelle prétention de sa part, Édouard a jugé qu’il aurait cette fois le dernier mot sur l’identité de l’héritier. Ceux encore dans la course ont finalement accepté son arbitrage, d’abord avec bienveillance, parce qu’elle permettait d’éviter une guerre civile entre les clans écossais. Tous les seigneurs de ces hautes terres ont finalement accepté de voir en Édouard leur suzerain, possiblement le 11 juin 1292, lors d’une cérémonie où ils lui ont juré fidélité. Édouard avait donc réussi à prendre le contrôle de l’Écosse sans même avoir tiré son épée. Il a rapidement mis sur pied une cour de justice pour évaluer la légitimité de chacun des protagonistes. Au terme de son enquête, les 5 et 6 novembre 1292, Édouard a reconnu le droit de John Balliol. Mais il a immédiatement exigé du nouveau roi qu’il lui rende l’hommage et le reconnaisse comme le suzerain d’Écosse, ce qui a été fait. Édouard en a aussi profité pour l’avertir que s’il ne gouvernait pas sagement, son suzerain se réservait le droit d’intervenir. En raison de son nouveau statut, Édouard a également réclamé le droit de tenir une cour lui permettant de juger les affaires écossaises, comme d’exiger des seigneurs écossais qu’ils accomplissent leur service militaire à ses côtés. Les Écossais considèreront qu’Édouard avait dépassé les limites de l’acceptable. Après trois ans et demi de résistance passive, au cours desquelles le roi des Écossais a été traité avec mépris par Édouard, les Écossais feront alliance avec la France. Un Édouard mécontent a alors envahi l’Écosse en mars 1296 et provoqué l’abdication du roi Jean Balliol le 10 juillet suivant.
BARROW, id., pp. 30, 35, 39, 47-53 et 95.
Par. 509 Édouard a conquis l’Écosse en quelques semaines, sans pour autant briser le moral des vaincus. La résistance des Écossais s’est organisée autour de la personne de William Wallace, un humble seigneur qui a remporté plusieurs victoires et même menacé sérieusement le sol anglais. Mais Édouard a finalement défait Wallace à la bataille de Falkirk le 22 juillet 1298. Wallace a aussitôt été remplacé comme chef de la résistance par Robert Bruce et John Comyn conjointement. Bruce était le petit-fils de l’autre Robert Bruce qui avait été l’un des prétendants au trône d’Écosse à la mort du roi Alexandre. À la suite d’un différent, d’un vieil antagonisme et de jalousie de part et d’autre, l’héritier de la famille Bruce tuera Comyn devant l’autel d’une église, le 10 février 1306. Quant à Wallace, il sera éventuellement capturé par Édouard et mis à mort cruellement en août 1305.
BARROW, id., pp. 95-103 et 146-148.
Par. 510 Le jeune Robert Bruce a remporté plusieurs victoires avant l’arrivée attendue du roi anglais. Édouard s’apprêtait à combattre son ennemi en personne lorsqu’il est mort sur la route avant d’avoir foulé le sol de l’Écosse. C’était le 7 juillet 1307. Édouard Ier, dit Longues Jambes, avait 68 ans, un âge vénérable pour l’époque.
Par. 511 L’aîné du roi défunt, Édouard, prince de Galles, lui a succédé. Édouard II règnera pendant 20 ans (1307-1327). Son caractère était très différent de celui de son père. Il n’a démontré aucune sagesse. Sa seule ambition a été de se servir de sa position pour s’amuser et enrichir au passage ses amis de jeu. Le nouveau roi, qui étalait aux yeux de tous son homosexualité, ou tout au moins sa bisexualité, ne goûtait pas les loisirs de ses barons, soit les banquets, la chasse, les tournois et autre activités martiales de la noblesse de son temps. Il préférait les passe-temps plébéiens et les travaux manuels. Édouard a donc évité, autant qu’il le pouvait, les contacts avec ses vassaux, ses conseillers naturels, avec lesquels il n’éprouvait aucune affinité. Il a préféré s’entourer de gens bien à lui, des amis sans fortune et sans position de naissance, auxquels il est demeuré fidèles toute sa vie. À un autre moment et en un autre lieu, cette fidélité aurait été considérée comme une qualité. Mais plus que des amis, un roi féodal a besoin d’alliés forts. Or, bien au contraire, Édouard II a tout fait pour se brouiller avec les riches et les puissants. Cela lui coûtera éventuellement la vie. La méfiance des hauts barons s’est manifestée dès la cérémonie de couronnement du 25 février 1308. En plus de son adhésion à la Magna Carta, ils ont obligé le roi à promettre le maintien des lois que le peuple se choisirait, une référence claire aux statuts du Parlement naissant.
Note : Un contemporain a décrit ainsi le caractère d’Édouard II : « [Traduction] Le roi Édouard (…) était certes élégant de corps et remarquable par sa force, mais, comme on le dit souvent, d’un caractère bien différent. En effet, méprisant la compagnie des nobles, il s’entourait de chanteurs, de tragédiens, de constructeurs de chars, de navires et autres artisans, se fiant davantage aux conseils d’autrui qu’aux leurs. Prodigue, fastueux et somptueux dans ses réceptions, vif d’esprit et d’une grande élégance de parole, la malchance l’accablait lorsqu’il faisait face à l’ennemi. Féroce avec les membres de sa maisonnée, le roi idolâtrait cependant un proche en particulier (i.e. son amant Pierre Gaveston) plus que tout autre, qu’il respectait, enrichissait et préférait, et dont l’absence lui était insupportable. Il le vénérait plus que tout autre. De là vinrent le déshonneur pour l’amant, le déshonneur et la ruine pour l’aimée, la ruine du peuple et le dommage causé au royaume. »W. STUBBS (éd.), Chronicles of the Reigns of Edward I and Edward II, vol. 2, Londres, Longman & Co., 1883, p. 91.
Par. 512 En ce jour du couronnement, la question exacte qui lui fut posée a été : « [traduction] Sire, acceptez-vous de maintenir et de préserver les lois et justes coutumes que la communauté du royaume aura choisi (shall have chosen), et défendrez-vous et appliquerez-vous ces lois et justes coutumes en honorant Dieu au meilleur de vos capacités ? » Et la réponse du roi a été : « J’accepte et promet ».
The coronation oath of Edward II, 1308, E.H.D., vol. 3 (1189-1327), éd. 1975, p. 525.
Portrait fictif du roi Édouard II
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 513 Édouard II a poursuivi la guerre de son père contre l’Écosse, une entreprise où il a lamentablement échoué. En effet, Robert Bruce, employant autant que faire se peut la tactique de la guérilla, soit la rapidité, la surprise, la mobilité et les petits engagements, a défait les lieutenants d’Édouard les uns après les autres, jusqu’à la bataille ultime de Bannockburn les 23 et 24 juin 1314. Aidés de leurs piquiers pour faire face à la cavalerie anglaise, les Écossais ont remporté une victoire écrasante, malgré la supériorité numérique de leurs ennemis. Anglais et Écossais signeront une trêve à Bishopthorpe en 1323. L’Écosse ne sera jamais plus conquise par les armes. En 1603, par droit d’hérédité, le roi Jacques VI d’écosse deviendra également le roi Jacques Ier d’Angleterre (règne 1603-1625). Il réunira ainsi les deux royaumes sous une même Couronne sans qu’une goutte de sang ne soit versée. Toujours dans le calme, la Loi sur l’union avec l’Écosse de 1706 réalisera leur union politique et législative en créant le nouveau royaume de Grande-Bretagne.
BARROW, préc. au par. 507, pp. 187-188 et 203-232; An Act for the Union of the Two Kingdoms of England and Scotland, 1706, 6 Ann., c. 11, Statutes of the Realm, vol. 3, 1817, réimpression de 1963, pp. 566-577.
Bataille de Bannockburn
Des piquiers écossais brisant une charge de cavalerie anglaise
Image de source inconnue

9.3 Remise en question du caractère sacré de la royauté anglaise
Par. 514 Le compagnon favori et ami d’enfance du roi Édouard, Pierre Gaveston, un chevalier gascon, l’a rejoint après son couronnement en 1307. Avant que le corps de son père n’ait refroidi, Édouard a élevé Gaveston à la dignité de comte de Cornouailles et lui a donné sa nièce en mariage, Marguerite de Clare. Il l’a nommé régent du royaume (keeper of the realm) an janvier de l’année suivante, juste avant son départ pour la France d’où il devait ramener sa promise, la princesse Isabelle, fille de Philippe IV le Bel. Les hauts barons ont ressenti comme autant d’insultes toutes ces faveurs accordées au Gascon. Celui-ci a empiré le climat d’hostilité entre eux en les ridiculisant. Gaveston paiera plus tard pour son arrogance. Pressé par la noblesse du pays, le roi sera contraint d’exiler son favori en juin 1308, un exil par trop court au goût de ses ennemis qui l’ont capturé et assassiné à son retour en Angleterre le 19 juin 1312, au grand déplaisir d’un Édouard accablé par le chagrin. La mort de Gaveston rendait désormais impossible toute réconciliation lui et ses barons.
J.R. MADDICOTT, Thomas of Lancaster, 1307-1322; A Study in the Reign of Edward II, Oxford University Press, Oxford, 1970, pp. 70-71, 89, 110, 128-130; W.R. CHILDS (éd.,), Vita Edwardi Secundi (The Life of Edward the Second), Oxford, Clarendon Press, 2005, pp. 5-17, 23, 27 et 29.
Par. 515 Le chef informel de l’opposition à Édouard II était son cousin Thomas Plantagenêt, le comte de Lancastre. Lancastre et trois autres comtes ont refusé de le suivre pour aller combattre les Écossais en 1314. Édouard s’est quand même rendu en Écosse avec le résultat que l’on sait. Après ce désastre, qui l’avait considérablement affaibli aux yeux de la noblesse, Édouard a été contraint d’abandonner le gouvernement du royaume à son ennemi lancastrien. Il était devenu un roi de paille. Après quelques années, et l’affaiblissement progressif de la mainmise de Lancastre sur le royaume après l’année 1316, Édouard a cherché à reprendre le contrôle et à se venger avec l’aide d’Hughes le Despenser, le comte de Winchester, et de son fils, aussi prénommé Hugues. En 1321, Lancastre, soutenu par le Parlement tenu en juillet et août, a cependant réussi à exiler à leur tour les père et fils Despenser. Nul besoin de procès ni de preuve pour les condamner : le Parlement a adopté un bill ou projet de loi d’attainder que le roi a été contraint de sanctionner. C’était le premier usage de ce type de loi qui permettait de condamner un homme sans le besoin de tenir un procès.
MADDICOTT, id., pp. 73 et 279; CHILDS, id., pp. 52-53; The exile of Hugh Le Despenser Father and Son, 1321, 15 Edw. II, Statutes of the Realm, vol. 1, 1817, réimpression de 1963, pp. 181-184. Voir aussi J. FROISSART, Chroniques de Jean Froissart, tome I (1307-1340), Siméon Luce (éd.), Chez Jules Renouard, Libraire de la Société de l’histoire de France, Paris, 1869, pp. 12-14, ainsi que T.F.T. PLUCKNETT, « The Origins of Impeachment », (1942) vol. 24 Transactions of the Royal Historical Society 47.
Par. 516 Édouard a finalement réussi à briser Lancastre en jouant les barons les uns contre les autres. Son ennemi a été fait prisonnier, puis exécuté en 1322. Édouard avait vengé le meurtre de Gaveston. Les Despenser sont revenus à la Cour plus puissants que jamais.
MADDICOTT, id., p. 312; CHILDS, id., p. 61.
Par. 517 La Victoire d’Édouard sur Lancastre en 1322 ne lui a procuré qu’un court répit. Les mécontents se sont tournés vers une autre personne encore plus dangereuse pour le roi, son épouse Isabelle, fille de Philippe Le Bel, plus tard surnommée la Louve de France.
Par. 518 Édouard et Isabelle ne se sont jamais vraiment aimés. Leur relation avait pris un mauvais départ dès l’arrivée de la promise en Angleterre. Au jour de son couronnement, le 25 février 1308, on raconte qu’Édouard avait préféré la couche de Gaveston à celle d’Isabelle. L’insulte a été aggravée par l’attention constante dont le roi a entouré son favori pendant les mois suivants. Sa jeune épouse n’a pas manqué de s’en plaindre à son père. Celui-ci, non sans s’assurer d’alliés anglais parmi les comtes rebelles, a alors servi un ultimatum à Édouard, le 12 mai de la même année : si Gaveston ne quitte pas l’Angleterre immédiatement, la France poursuivra ceux qui soutiennent le Gascon comme autant d’ennemis mortels, a-t-il intimé. Gaveston a donc été immédiatement exilé. Il sera assassiné quelques années plus tard, comme mentionné plus tôt. Édouard a retrouvé le lit conjugal avec suffisamment de régularité pour faire quelques enfants à Isabelle, dont Édouard, le prince de Galles, né le 13 novembre 1312. Il n’empêche, l’humiliation d’Isabelle n’a pas cessé pour autant, parce qu’Édouard, qui multipliait les amitiés masculines, ne s’est guère montré discret.
MADDICOTT, id., pp. 83-84.
Par. 519 En mars 1325, lors d’une visite à la Cour de son frère le roi de France, Charles IV, Isabelle s’est éprise d’un baron anglais exilé sur le continent : Roger Mortimer. Ils se connaissaient depuis plusieurs années. Mais rien ne prouve qu’ils avaient entretenu une relation intime avant. Ils y ont imaginé et préparé un projet d’invasion de l’Angleterre pour l’année suivante. Édouard, mis au courant de rumeurs à ce sujet, a réclamé leur retour en terre anglaise au printemps de 1326. Peine perdue ! Isabelle a mis pied sur la côte du Suffolk le 24 septembre avec une petite armée d’au plus 1 500 hommes. Le royaume, fatigué de son roi comme de ses favoris, les Despenser, a accueilli Isabelle et Mortimer les bras ouverts. Mieux encore, aucune résistance ne s’est manifestée. Les rares alliés du roi ont été pris et exécutés. Édouard lui-même, qui s’était enfui et caché dans quelque recoin du pays de Galles, plus précisément dans une abbaye cistercienne, a finalement été capturé le 13 novembre 1326 et emprisonné au château royal de Kenilworth.
CHILDS, préc. au par. 514, pp. 244-245, note infrapaginale 512; P.C. DOHERTY, Isabella, Queen of England, 1296-1330, Thèse de doctorat, Oxford, 1977, pp. 81-88; N. FRYDE, The Tyranny and Fall of Edward II, 1321-1326, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 96, 147, 181, 185 et 189-193.
Par. 520 Édouard II ne quittera jamais sa prison. Que faire avec lui, se sont demandés Mortimer et Isabelle et les hauts barons ? Certes, il fallait s’en débarrasser. Et que la méthode employée, serait-elle illégale, apparaisse néanmoins comme légitime aux yeux de la population. Tous étaient donc bien embêtés. Édouard demeurait leur roi, au surplus un souverain consacré. Les dirigeants de facto ont alors attendu et encore attendu avant de trancher. Ils ont d'abord pensé à la tenue d’un procès. Donner la parole au roi à la fois devant son fils et la noblesse du pays présentait cependant un danger. Commençons par réunir tout ce monde. On verra après.
Par. 521 Une assemblée, dont on ne peut dire qu’elle constituait un Parlement parce qu’elle n'avait pas été convoquée par le roi Édouard, mais par Isabelle et ses alliés au nom du prince de Galles, s’est mise à la tâche le 7 janvier 1227. On ne connaît pas la teneur exacte de ses travaux. On sait cependant qu’à sa demande, les évêques Adam Orleton et Jean de Stratford se sont rendu au château de Kenilworth afin d'y rencontrer Édouard, probablement avec l'espoir de convaincre le roi de renoncer au trône. Ce fut apparemment sans résultat. L’assemblée a repris ses travaux au retour des évêques, le 13 janvier. Un plaidoyer contenant 13 articles a alors été lu justifiant la déposition du monarque : celui-ci déclarait qu’Édouard n’aurait jamais dû régner en raison de son incompétence, des destructions causées à l’Église et aux pairs du royaume, du non-respect des promesses contenues dans sa charte de couronnement, ainsi que de sa propension à suivre les avis de conseillers maudits. Pour la première fois, il a été suggéré de le remplacer par son fils aînée, le prince de Galles. Une seconde délégation de l’assemblée s’est ensuite rendue au château de Kenilworth. Elle devait encore convaincre le roi du bien-fondé de son retrait, parce que le peuple le souhaitait, tout en faisant valoir que le prince de Galles lui succéderait et non quelque autre candidat n’appartenant pas à sa famille. Pour être clair, Édouard avait le choix entre abdiquer ou être destitué. Il a d’abord refusé de renoncer au trône volontairement, et puis, non sans hésitation, il a finalement cédé. Était-ce donc une abdication ou une destitution ?
FRYDE, id., pp. 195-200; D. BILESTONE et R. KOUAMENAN, Le roi, son favori et les barons, Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2021, pp. 276-277.
Par. 522 Au retour des émissaires du soi-disant Parlement, l’évêque de Winchester Jean de Stratford, qui faisait partie de la première comme de la seconde ambassade, a prononcé un sermon dans lequel il demandait au peuple d’approuver la démarche entreprise. L’acclamation attendue de l’auditoire a suivi. On ne sait où Stratford a prononcé ce sermon qui a fait grand bruit, possiblement devant la même assemblée. Quoi qu’il en soit, Walter Reynolds, archevêque de Cantorbéry, en a conclu que le peuple avait parlé et que « sa voix (…) était la voix de Dieu ». Un précédent aurait donc été créé selon lequel les hauts barons et prélats avaient destitué un roi avec l’assentiment du peuple. Après tout, si Henri Ier et Étienne, d’après leur charte de couronnement, avaient admis avoir été élus grâce à l’appui des hauts barons et l’acclamation par le peuple, les mêmes acteurs pouvaient donc les déposer.
Par. 523 Toutefois, lorsque la paix d’Édouard III fut proclamée le 24 janvier 1327, il a été annoncé qu’Édouard II, le précédent souverain, sur l’avis et avec l’accord des prélats, des nobles et du royaume dans son ensemble, avait plutôt renoncé au gouvernement et exigé qu’il soit confié à son fils aîné et héritier. La proclamation émise par le nouveau roi, lors de son accession au trône le 1er février suivant, mentionnait également que le père avait abdiqué en faveur de son fils. Peut-être a-t-on voulu ainsi faire croire à une version plus consensuelle (l’abdication) que conflictuelle (la destitution) du changement de régime. Nul ne sait.
Par. 524 Qu’importe ! Les deux interprétations pouvaient se défendre. Car avouons qu’il n’y a pas une si grande différence entre une destitution et une abdication obtenue par la contrainte.
Proclamation d’Édouard III, S. B. Chrimes et A. L. Brown (éds.), Select Documents of English Constitutional History, 1307-I485, Toronto, MacMilland & Co., 1961, 38 (no. 24); B. WILKINSON, « The Deposition of Richard II and the Accession of Henry IV », (1939) vol. 54 English Historical Review 215, pp. 224-230; W.H. DUNHAM Jr et C.T. WOOD, « The Right to Rule England : Depositions and the Kingdom’s Authority, 1327-1485 », (1976) vol. 81 The American Historical Review 738, p. 739; C. VALENTE, « The Deposition and Abdication of Edward II », (1998) vol. 113 The English Historical Review 852, pp. 861-869.
Par. 525 Édouard II a probablement été assassiné dans une cellule du château de Berkely sur l’ordre de Roger Mortimer au cours du mois de septembre 1327. C'est du moins ce que les chroniqueurs de l'époque ont crû et écrit, notamment Adam Murimuth, le vicaire de l'évêque de Londres au moment des évènements. La mort du roi déchu s’imposait afin d’écarter tout danger d'une guerre civile. Il représentait effectivement un point de ralliement pour les mécontents du nouveau régime. Encore qu’il existe une thèse, quoique improbable, fondée sur des rumeurs, des contradictions dans les témoignages, ainsi que l’absence d’examen du corps du roi après son décès, voulant qu’il ait échappé à ce funeste destin pour vivre à l’écart dans quelque lieu tenu secret. Ce qui semble certain est que plus aucun roi ne pourra se sentir invulnérable en raison du caractère sacré de sa fonction.
E.M. THOMPSON (éd.), Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, Robertus de Avesbury de Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii, Londres, Eyre and Spottiswoode imprimeurs, 1889, pp. 53-55, dont l'extrait de la chronique a été cité et traduit en anglais par W.J. ASHLEY, Edward III and his Wars, Londres, David Nutt, 1887, pp. 16-17. Voir aussi I. MORTIMER pour la thèse opposée, dans « The Death of Edward II in Berkely Castle », (2005) vol. 120 The English Historical Review 1175, pp. 1175 et 1193-1195.
9.4 Début de la guerre de Cent Ans (1337-1453)
Par. 526 Édouard III (règne 1327-1377) n'avait que 14 ans au moment de monter sur le trône d’Angleterre. Son couronnement, le 25 janvier 1327, a suivi les formes prescrites par la tradition. Le jeune roi a confirmé la Magna Carta et réitéré la plus récente promesse de son père de respecter les lois que le peuple se choisirait. Comme l’évêque de Rochester Hamo de Hethe (ou de Hythe) l’a expliqué, Édouard n’aurait pas jamais été couronné s’il n’avait pas souscrit au même engagement. Celui-ci représentait un contrat solennel entre le peuple et son roi auquel Édouard ne pouvait normalement se soustraire, croyaient ses contemporains.
RICHARDSON, préc. au par. 499, p. 65.
Portrait fictif du roi Édouard II
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par 527 Édouard était encore trop jeune pour tenir les rênes de son gouvernement. La conduite des affaires du royaume aurait dû échoir à un conseil de régence, mais ce conseil a été écarté au profit d’Isabelle et de son amant Roger Mortimer. Le couple a concentré entre ses mains la totalité du pouvoir.
Par. 528 Le règne d’Édouard II a débuté par une trêve avec la France. Celle-ci restait bien fragile. On voyait déjà poindre les germes d’un nouveau conflit. En effet, le 1er février 1328, la France avait perdu son roi, Charles IV, le dernier de la lignée de Capétiens. Le plus proche parent français du roi défunt dans la lignée masculine devenait alors Philippe de Valois, un petit-fils de Philippe III le Hardi (règne 1270-1285), un neveu de Philippe IV le Bel (règne 1285-1314), et le cousin des trois derniers rois de France, Louis X le Hutin (règne 1314-1316), Philippe V le Long (règne 1316-1322) et Charles IV le Bel (règne 1322-1328). Le Valois a donc succédé à son cousin Charles pour devenir le roi Philippe VI de France, dit le Fortuné (règne 1328-1350).
Par. 529 Édouard III d’Angleterre était pourtant le neveu et donc un plus proche parent survivant du dernier roi français par sa mère Isabelle, la sœur de Charles IV et le dernier enfant survivant de Philippe IV le Bel. D’après la coutume de primogéniture, qui réglait l’ordre de succession depuis la mort d’Hughes Capet en 996, le trône de France aurait pu revenir à Édouard, mais les Français n’ont rien voulu savoir de lui. Qu’importe s’il parlait mieux le français que l’anglais ? Édouard demeurait un étranger. Le conseil des pairs du royaume, responsable de toute question litigieuse en manière de succession, avisés par ses juristes et l’existence d’un précédent, a eu tôt fait d’y faire obstacle. D’après eux, les femmes ne pouvaient régner ni transmettre le droit à la Couronne de France.
Par. 530 Rien n’était encore sûr à cet égard au début du XIVe siècle. L’hypothèse n’avait jamais été examinée sérieusement. Les hauts barons ont commencé à y penser à la mort de Louis X le Hutin, en 1316, alors que sa veuve Clémence de Hongrie était enceinte. Sans en exclure la possibilité, ils ont refusé de trancher la question de son droit de régner, si une fille devait naître. Mais Clémence a mis au monde un fils, Jean Ier, dit le posthume, qui n’a cependant vécu que cinq jours. Il n’empêche, sa demi-sœur, Jeanne, fille de Louis X et de sa première épouse Marguerite de Bourgogne, et donc la plus proche parente du roi défunt, aurait pu être sur les rangs. Son oncle et le régent du royaume Philippe, le désormais Philippe V le Long, a cependant crû que la Couronne lui revenait. Les hauts barons, à nouveau réunis en conseil, ont ratifié son coup et déclaré « que Femme ne peut accéder au royaume de France ». La Bourgogne a bien sûr protesté de voir sa princesse ainsi écartée du trône, avant de s’incliner devant le fait accompli.
E. BARNAVI, « Mythe et réalité historique : le cas de la Loi salique », (1984) vol. 3 Histoire, Économie et Société 323, p. 331.
Par. 531 Le principe de l’exclusion des femmes de la succession dans le royaume de France était donc acquis depuis au 1316. Lorsque Charles IV le Bel mourra à son tour sans descendance mâle, en 1328, la situation se comparera presqu’en tous points à celle vécue douze années plus tôt, à une différence près sur laquelle nous reviendrons plus bas. Il n'était pas besoin de s'interroger, dirons les juristes et les barons français ; Isabelle, reine d’Angleterre et sœur du roi défunt, ne pouvait transmettre quelque droit de régner sur la France à son fils Édouard. Celui-ci, encore dominé par sa mère et son amant, les véritables maîtres de l’Angleterre pour le moment, a semblé se résigner. Le temps n’était pas encore propice au renouvellement des hostilités contre la France. À la cathédrale d’Amiens, en 1329, Édouard a d’ailleurs rendu l’hommage à Philippe VI le Fortuné pour sa terre française de Guyenne, probablement à l'insistance de Mortimer, un geste par lequel il reconnaissait son cousin de Valois comme le légitime roi de France.
The instrument of homage made by Edward III to Phillip VI of France at Amiens, 1329, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 51-52; W. WARBURTON, Edward III, New York, Charles Scribner’s Sons, 1899, pp. 38-39.
Édouard III, roi d'Angleterre, prêtant hommage à Philippe VI, roi de France
Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Français 2813 folio 357v

Par. 532 Si Roger Mortimer souhaitait vraiment poursuivre la trêve avec l’Écosse, il s’est montré fort maladroit lors des pourparlers de paix en ne s’adressant pas à Robert Bruce comme son roi, un signe que l’Angleterre entretenait toujours des rêves de conquête. Or, Bruce, dont la santé déclinait, pressait l’Angleterre pour qu’elle signe un traité permettant de garantir l’indépendance de son royaume et de protéger l’héritage de ses enfants. Mais Mortimer s’y refusait. Le jour même où Édouard III a été couronné, le roi d’Écosse s’est donc décidé à rompre la trêve en attaquant le château de Norham dans le comté anglais de Northumbrie, près de la frontière nord qui séparait les deux royaumes.
Par. 533 Mortimer, accompagné du roi Édouard III, a quitté York le 10 juillet 1327 avec une armée considérable pour se rendre combattre. Les Écossais se sont dérobés. Épuisés par une poursuite qui prenait des semaines, les Anglais les ont finalement rejoints le 1er août. Les Écossais ont encore refusé le combat de front, cette fois pour lui préférer une attaque surprise de courte durée dans la forêt du parc Stanhope, dans le comté de Durham, avant de repartir en douce aussi rapidement. Plusieurs centaines d’Anglais ont péri. Ils n’étaient pas préparés à la tactique de guérilla, une négligence incroyable si l’on considère que Bruce l’avait toujours privilégiée dans ses précédents combats. Mortimer et Édouard sont rentrés à Londres humiliés. Le Traité d’Édimbourg-Northampton des 17 mars et 1er mai 1328, dans lequel Roger Mortimer et la reine Isabelle reconnaissaient la souveraineté de l’Écosse et les droits de la maison de Bruce, a conclu cette première guerre d’indépendance écossaise commencée en 1296 par Édouard Ier.
Isabella and Mortimer make peace with Scotland, 1328, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 49-50.
Par. 534 Robert Bruce est mort l’année suivante en laissant l’Écosse à son fils de cinq ans : le roi David II.
Par. 535 Roger Mortimer et la reine Isabelle ont gouverné l’Angleterre en multipliant les maladresses. Le Traité d’Édimbourg-Northampton a d’ailleurs été considéré par les Anglais comme l’une d’entre elles. Mortimer, comte de March depuis octobre 1328, se faisait acclamer plus haut et plus fort qu’Édouard III, le laissait debout en sa présence, marchait non seulement à ses côtés, mais parfois devant le roi. Personne n’osait l’affronter car Mortimer dispensait faveurs et punitions comme il l’entendait. Devenir son ennemi pouvait s'avérer dangereux, serait-ce quand on comptait parmi les membres de l'élite du royaume. Le bruit courait même au sein de la noblesse et dans le peuple que Mortimer souhaitait détruire la lignée royale et se déclarer lui-même roi. Vrai ou faux ? Qu’importe ! Car son arrogance n’avait aucune limite. Édouard, qui a eu vent de ces rumeurs, a donc entrepris d’agir contre l’amant de sa mère avant qu’il ne soit trop tard, ont commenté Geoffrey le Baker et Henry Knighton, des chroniqueurs anglais de la première moitié du XIVe siècle.
D. PREEST (traducteur), The Chronicle of Geoffrey le Baker, Woodbridge, The Boydell Press, 2012, p. 41; H. KNIGHTON, Of the fall of Roger Mortimer, 1330, dont l'extrait de la chronique a été cité et traduit en anglais par ASHLEY, préc. au par. 525, pp. 27-29.
Par. 536 Après une première tentative maladroite, en 1328, un nouveau coup s'est préparé. Le 19 octobre 1330, Édouard, enfin prêt, aidé du comte de Lancastre Henri Plantagenêt, a capturé Mortimer au château de Nottingham, l'a fait juger par le Parlement et exécuter sans délai. Le jeune roi vengeait ainsi son père assassiné. Il a cependant épargné sa mère, tout en la tenant à l'écart de l'exercice du pouvoir.
PREEST, id., pp. 41-43; The judgment of Roger Mortimer, 1330, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 53-54.
Par. 537 Après s’être débarrassé de sa mère et de son amant, Édouard III entendait dénoncer l’humiliant accord conclu avec l’Écosse. Son conseiller juridique, le juge en chef de la Cour du banc du roi, Geoffroy Scrope, aurait plaidé devant le Parlement réuni à York en 1332 que le Traité d’Édimbourg-Northampton avait été négocié contre la volonté et le jugement du jeune roi, alors qu’il n’avait pas l’âge d’offrir un consentement et avait été mal conseillé. Toutefois, Édouard ne dénoncera jamais formellement le traité. Mais peu lui importait ! Un traité ne vaut que si les deux parties le respectent. Or, Édouard a pris la décision de l’enfreindre et d’attaquer en janvier 1333, malgré l’opposition des parlementaires. Quoiqu’il ait connu quelques victoires, notamment à la bataille de Halidon Hill le 19 juillet, il n’a pas réussi à vaincre la résistance des Écossais. Ces derniers, animés par une grande foi patriotique, n’ont pas cessé de s’opposer à ce roi étranger, et avec un certain succès à partir de 1335, en partie parce que les Écossais refusaient toujours le combat de front, en partie parce que la France avait rallié leur cause dès 1336 pour ses propres raisons. Édouard se trouvait désormais occupé par une autre guerre, ce qui l’a obligé à mettre sur pause sa campagne contre les Écossais.
WARBURTON, préc. au par. 531, pp. 28-32 et 58; Unsuccessful expeditions of Edward into Scotland, 1334-1336, MURIMUTH, extrait de la chronique cité et traduit en anglais par ASHLEY, préc. au par. 525, pp. 35-38.
Par. 538 Après la mort de Mortimer en 1330, Édouard avait d’abord voulu rétablir de bonnes relations avec la France. Dans ce but, il a signé un document dans lequel il reconnaissait avoir rendu l’hommage plein et lige à Philippe VI pour la Guyenne. Une paix de six années s’ensuivit. L’affaire écossaise a gâché leur bonne entente, bien qu’elle n’aurait peut-être été qu’une excuse pour le roi de France.
WARBURTON, id., pp. 34 et 41.
Par. 539 En effet, à l’été 1335, Philippe VI a écrit au pape Benoît XII, alors à Avignon, en disant qu’il était obligé de porter assistance aux Écossais en vertu des traités. Philippe évoquait la Vieille Alliance, l’Auld Alliance en gaélïque, dont la première trace écrite est un traité signé à Paris le 23 octobre 1295 entre le roi Jean Balliol d’Écosse et Philippe IV le Bel. Ce traité prévoyait que chaque partie viendrait au secours de l’autre en cas d’attaque par l’Angleterre. Certes, le pape a mis en garde le Français, en offrant plutôt son aide comme médiateur entre les deux royaumes. Mais Philippe VI a préféré poursuivre la politique de ses prédécesseurs, au moins depuis les règnes de Louis VII le Jeune (1137-1180) et de Philippe Auguste (1180-1223), qui était de soumettre toutes les provinces françaises, incluant la Guyenne, afin de créer un royaume unifié sous leur seule Couronne.
WARBURTON, id., pp. 42-43; H. FENWICK, The Auld Alliance; Scotland and France Through Twelve Centuries, Kineton (Warwickshire), The Roundwood Press, 1971, p. 2.
Par. 540 Le Valois Philippe VI a envoyé ses soldats effectuer plusieurs raids sur les côtes de l’Angleterre, au point que ses habitants ont craint une invasion au printemps de 1336. Quelques mois plus tard, Édouard III a interdit toute exportation de laine anglaise à destination de la Flandre, alors sous juridiction française, afin de ruiner son industrie du drap. Philippe a riposté en confisquant au Plantagenêt son duché de Guyenne, une possession anglaise depuis le mariage d’Henri II d’Angleterre avec Aliénor d’Aquitaine. Édouard aurait pu négocier. Il a préféré riposter, avec l’appui de la noblesse du royaume réuni en Parlement, ainsi qu’avec les encouragements de Robert d’Artois, un seigneur français qui s’estimait avoir été injustement dépossédé du comté du même nom, en réclamant le trône de France dont il s’estimait maintenant avoir été injustement dépossédé. Nous étions déjà le 29 septembre 1337.
How king Edward was conselled to make war against the French king, 1337, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, p. 60.
Par. 541 La session du Parlement terminée, l’évêque de Lincoln et chancelier d’Angleterre, Henry Burghersh, avec mandat d’agir à titre d’ambassadeur d’Édouard, s’est rendu à Paris vers la fin octobre 1337. Il portait un message à l’intention de Philippe dans lequel Édouard dénonçait son serment prêté à Amiens et déclarait la guerre à son cousin. Dans le français de l’époque, la langue encore en usage à la Cour d’Édouard III, on pouvait lire : « Édouard, par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre et d’Irlande, à Philippe de Valois écrivons. Comme ainsi soit que par la succession de notre cher oncle monseigneur Charlon, roi de France, nous soyons héritier de héritage et couronne de France par trop plus prochain degré que vous ne soyez, qu’en la possession de notre héritage vous êtes mis et le tenez et tenir voulez de force, si le vous avons-nous par plusieurs fois montré et fait remontrer pas si digne et spécial avis, comme celui de l’Église et le saint collège de Rome, et à l’entente du noble empereur, chef de toutes juridictions; auxquelles choses et demandes vous n’avez mie voulu entendre, mais vous êtes tenu et tenez en votre opinion fondée sur tort. Pourquoi nous vous certifions que le nôtre héritage de France nous requerrons et conquerrons par la puissance de nous et des nôtres; et de ce jour en avant défions-nous et les vôtres de nous et des nôtres, et vous rendons foi et hommage que sans raison nous avons fait; et remettons la terre de Ponthieu avec notre autre héritage en la garde de Dieu, non en la vôtre, qu ennemi et adversaire vous tenons. Donné à notre palais à Wesmoustier, présent notre général conseil, le dix-neuvième jour du mois d’octobre. »
FROISSART, préc. au par 515, pp. 401-404. Et pour la citation, voir B. ZELLER, responsable de la publication, L’histoire de France racontée par les contemporains, Philippe VI et Robert d’Artois, les commencements de la guerre de Cent Ans 1328-1345, Paris, Librairie Hachette, 1885, pp. 98-99.
Par. 542 Cet épisode a marqué le début de la guerre de Cent Ans entre l’Angleterre et la France, un conflit qui s’est prolongé en réalité de 1337 à 1453, avec des périodes de calme relatif.
Par. 543 La principe de l’exclusion des femmes de la succession à la Couronne de France était acquis depuis le précédent de 1316. Sans doute, le roi Édouard était prêt à admettre l’incapacité des femmes à régner sur la France, mais il a insisté qu’étant le neveu de Charles IV, il demeurait un plus proche parent du roi défunt que Philippe. Pour écarter la candidature d’Édouard, et installer le Valois sur le trône, il fallait donc compléter le principe de la masculinité par l’exigence d’une filiation masculine. Les légistes et barons français ne se sont pas gênés pour accomplir ce saut qualitatif, sans s’expliquer davantage. Mais nul n’était dupe; la vraie raison de leur décision était la sauvegarde de l’unité française. Le continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis a remarqué à ce propos : « [traduction] Ceux du royaume de France ne se seraient pas vus d’un bon œil soumis au gouvernement des Anglais. » Contrairement à ce qu’a pu laisser entendre le romancier Maurice Druon dans sa célèbre suite Les rois maudits, le Code des francs-saliens, rédigé vers 510, voulant que femme ne puisse hériter n’a jamais été invoqué par ces légistes et barons pour justifier les décisions de 1316 ou de 1328. Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle que des clercs astucieux ont dépoussiéré la loi salique.
ZELLER, id., pp. 3-4; BARNAVI, préc. au par. 530, p. 332.
Par. 544 Édouard III a maintenu sur pied une armée de conscrits et s’est acheté des alliés en début de campagne. Le coût a été conséquent. À court d’argent, Édouard s’est donc tourné vers le Parlement le 13 octobre 1339. Lords et communes, après avoir hésité avant de puiser dans les poches des Anglais, en ont accepté le principe après y avoir mis diverses conditions : retrait d’une taxe illégale sur la laine, nomination d’officiers pour entendre le plaintes, mandat des shérifs raccourci à un an, uniformisation des poids et mesures, conditionnalité de toute aide à un vote de tous les états (lords et communes) du Parlement, etc. Celui-ci, satisfait, a finalement versé à Édouard les sommes considérables demandées. Mais les succès sur le terrain français se faisaient néanmoins attendre.
Par. 545 Après la destruction de la flotte française le 24 juin 1340, et une courte trêve de deux ans, jusqu’en juin 1342, les années passèrent : 1342, 1343 et 1344. Pas de grande victoire ni de cruelle défaite ! L’argent s’épuisait à nouveau et l’impatience chez les parlementaires croissait. Édouard a donc modifié son approche. Il s’est reposé dorénavant sur ses troupes régulières qu’il a missionnées pour de courtes campagnes. Le sort des armes lui a été finalement favorable, surtout à partir de 1345. Sa chevauchée de 1346 avec un débarquement dans le Contentin, sa prise de Caen, sa victoire à la bataille de Crécy, ainsi que sa prise de Calais en 1347, ont marqué des avancés décisives. Édouard a cependant peiné pour tirer partie de ses victoires en raison des vagues d’épidémie de peste bubonique qui ont dévasté l’Europe peu après. Elle marquera une longue pause ou tout au moins un ralentissement dans la guerre pour quelques années, marquée par plusieurs trêves successives, faute d’hommes en état de combattre.
WARBURTON, préc. au par. 531, pp. 75-78; ZELLER, préc. au par. 541, pp. 64-70 et 95.
Par. 546 Les uns et les autres ne songeront plus qu’à se prémunir des effets des épidémies sur leur population et leur royaume. Car la peste bubonique, communément appelée peste noire, a d’abord atteint la France en 1348, puis l’Angleterre méridionale à partir de 1349. Possiblement originaire du Moyen-Orient, mais identifiée une première fois dans l’armée du khan de Kiptchak alors qu’il assiégeait une colonie génoise en Crimée au cours de l’année 1346, elle a pénétré en Europe occidentale par les ports méditerranéens, pour se répandre sur tout le continent en suivant les principales voies commerciales. Près de 50% de la population totale aurait été fauchée au cours des cinq premières années, bien qu’elle n’ait pas frappé l’Europe de façon uniforme. Devenue endémique, la peste est revenue régulièrement en se mêlant à d’autres fléaux génération après génération, quoiqu’avec moins d’intensité, car ceux qui survivaient acquéraient une immunité naturelle. Le creux démographique sera atteint vers 1460. Il faudra attendre l’année 1600 pour que la population revienne à son niveau antérieur.
Y. RENOUARD, « Conséquences et intérêt démographique de la Peste noire de 1348 », (1948) vol. 3 Population (Éditions française) 459-466. Pour la plus récente étude scientifique, lire de A. IZDEBSKI, P. GUZOWSKI et AUTRES, « Palaeoecological data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic », (2022) vol. 6 Nature Ecology & Evolution 297-306.
Par. 547 La guerre a repris avec férocité sous la direction du fils aîné du roi d’Angleterre, lui aussi prénommé Édouard, mais que l’on connaîtra sous son surnom de Prince Noir pour rappeler la couleur de son armure. Le prince a débarqué à Bordeaux le 20 septembre 1355 à la tête d’une puissante armée, certes bien décidée à protéger son duché de Guyenne, mais aussi avec l’intention de piller et ruiner tout le sud-ouest de la France afin de briser le moral des Français. Il se rendra jusqu’à Poitiers où il remportera une brillante victoire le 19 septembre 1356 contre Jean II le Bon, roi de France, qu’il fera prisonnier avec son héritier Charles, avant de les rançonner.
The campaign and battle of Poitiers, 1356, chronique de Geoffroy le Baker reproduite dans E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 92-99.
Bataille de Poitiers
Bibliothèque Nationale, ms. no 2643)

Par. 548 Ce qui a été un triomphe pour l’Angleterre a représenté inversement une catastrophe pour la France. La fine fleur de la chevalerie française est tombée : comtes, chevaliers, écuyers et simples soldats, en tout près de 6 000 morts et le double de prisonniers, d’après le chroniqueur Jean Froissart. Pis encore, les Français ne faisaient plus confiance à leurs dirigeants. L’anarchie s’est installée; on assista, à partir du 28 mai 1328 dans la région de la Picardie, autour de Beauvais, au début d’un mouvement populaire de révoltes et d’émeutes appelé la Grande Jacquerie, mouvement qui s’étendit à la commune de Paris, à la Champagne, à l’Artois et à la Normandie. Immédiatement réprimé, il fut de courte durée. Il n'empêche, la France se retrouvait dans un état de grande faiblesse. Cette défaite et cette faiblesse la mena à souscrire au Traité de Brétigny du 8 mai ou de Calais du 24 octobre 1360. Dans ce Traité, la France de Jean II a dû finalement reconnaître la mainmise anglaise sur le Pas-de-Calais et la Guyenne, ainsi que sur le Poitou, le Périgord, le Limousin, l’Angoumois et la Saintonge. C’était considérable, près d’un tiers du royaume de France.
ZELLER, préc. au par. 540, pp. 138-158. Voir aussi J. FROISSART, Commencement de la Jacquerie, dont la chronique est citée par B. ZELLER, id., pp.104-108; The Treaty of Calais, 1360, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 103-108.
Par. 549 Notons cependant que ce même traité, dans sa version de Calais, avait abrogé les articles 11 et 12 où la France reconnaissait la souveraineté anglaise sur ces territoires. La paix de 1360 prévoyait d'ailleurs l'adoption de conventions subsidiaires dans lesquelles le régent et dauphin Charles s'était formellement réservé le ressort et la souveraineté. Tous ce qui avait fait l'objet du traité relevait donc toujours de la Couronne de France. On peut y voir la main de Charles, décidément très versé dans les questions juridiques. Bref, les Anglais n'avaient pas compris qu'ils avaient été joués. Ils s'en rendront compte quelques années plus tard quand le désormais roi Charles V reprendra le contrôle des provinces perdues.
CH. PETIT-DUTALIS et P. COLLIER, La diplomatie française et le Traité de Brétigny, Paris, Librairie Émile Bouillon, éditeur, 1897, pp. 26, 27, 32 et 34.
Carte 12
Traité de Brétigny 1360
En rose foncé : territoire contrôlé par Édouard III avant le traité
En rose pâle : territoire cédé par la France à l’Angleterre par le traité
En blanc : territoire du duché de Bretagne, allié aux Anglais

Par. 550 Le Prince Noir est demeuré à Bordeaux où il a tenu sa cour. Élevé à la dignité de prince d’Aquitaine par son père Édouard III le 19 juillet 1362, le jeune Édouard multipliera les taxes pour financer le luxe dont il aimait s’entourer. Tous convenaient qu’il était un guerrier compétent et un brillant stratège. Mais il s’avérait être un piètre administrateur, au surplus ignorant des us et coutumes des peuples qu’il gouvernait, ce qui fragilisera son emprise sur sa nouvelle principauté.
Par. 551 Et puis, Charles V, le nouveau roi de France depuis 1364, que l’on surnommera le Sage en raison de son intelligence, n’était pas dépourvu lui-aussi de qualités quand il voulait faire parler ses armes. Il commença par s’assurer de lever des impôts réguliers et de mettre sur pied une armée de professionnels. Sa stratégie a été de conclure des alliances, avec la Bretagne de Jean IV, mais surtout avec Henri (Enrique) de Trastamare, un prétendant au trône et futur roi de Castille, opposé à son demi-frère Pierre Ier (Pedro Ier) de Castille, soutenu par l’Angleterre. Charles a pu ainsi porter la guerre au sud-ouest du continent. Le roi de France avait un atout dans sa manche : le turbulent Gaston Phébus, vicomte de Béarn, un seigneur doté d’un grand courage et d’une grande habileté, qui avait réussi à faire de son Béarn une terre souveraine, donc ne relevant d’aucun autre seigneur.
The alliance between Pedro of Castile, Charles de Navarre and Edward Prince of Wales, 1366, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 109-110.
Par. 552 Le Prince Noir s’est montré incapable de soumettre ce Gaston Fébus. Le 6 décembre 1365, un Édouard humilié s’est finalement résolu à demander l’intervention du nouveau roi de France, Charles V, pour résoudre ce conflit avec celui qu'il considérait comme son vassal. Car, en tant que souverain, ce que le traité de 1360 reconnaissait, Charles et sa Cour demeuraient compétents pour entendre un litige entre deux seigneurs sous leur juridiction. Mais le roi de France avait un autre projet en tête que celui d’aider son ennemi à faire respecter les termes du traité de Brétigny-Calais.
Par. 553 Appuyé par les guerriers béarnais, Charles V a envoyé son armée en Espagne porter secours à Henri de Trastamare. Elle a franchi les Pyrénées en plein cœur de l’hiver 1365-1366. Édouard en a fait autant en février 1367 afin d’aider Pierre Ier, l’allié de l’Angleterre. Après quelques combats et un retournement de situation qui a permis aux deux Espagnols d’occuper successivement le trône de Castille, ceux-ci se sont affrontés au corps à corps lors de l’ultime bataille du 14 mars 1369 à Burgos, qui s’est terminée par la victoire d’Henri et la mort de Pierre. Henri II est alors devenu, pour de bon cette fois, le souverain de la Castille.
The Black Prince’s expedition to Castile, 1367, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 110-114.
Par. 554 Le Prince Noir avait grandement aidé Pierre Ier dans un premier temps, surtout lors de sa victoire à Nájera, le 3 avril 1367. Victoire, certes, mais victoire couteuse ! L'Angleterre avait usé le meilleur de ses forces. C’est d’ailleurs pourquoi le Prince patienta quelques mois à Burgos pour y recevoir la récompense promise par Pierre, avant de retourner dans son duché de Guyenne sans avoir obtenu son dû, sûrement très déçu de la parole reniée. D'autant plus qu'Édouard s'était porté grant auprès des soldats. Cette ingratitude explique l’absence du prince à Burgos, lorsque le sort de la Castille s’est joué. Il en avait eu assez de Pierre. Le problème est que le prince avait vidé ses caisses pour défrayer les coûts de l’expédition. Il se voyait maintenant ruiné, incapable de payer ses troupes et de défendre son duché de Guyenne. Les ressources de la Guyenne ne lui suffisaient pas. Les Gascons se sont même rebellés. Son père, Édouard III, a bien voulu lui venir en aide, mais le parlement de Westminster s’est refusé à lui consentir une somme à la hauteur des besoins. Malade, le prince retournera définitivement en Angleterre au début de 1371. Charles V, aidée par une Castille reconnaissante, profitera de la pingrerie du parlement anglais et de la révolte des Gascons, entre 1369 et 1375, pour reprendre la quasi-totalité des terres cédées par le traité de Brétigny-Calais.
Ibid. ; E. DÉPREZ, « La bataille de Najera; le communiqué du Prince Noir », (1921) T. 136 Revue historique 37, pp. 54 et 59; A. VILLALON et D.J. KAGAY, To Win and Loose a Medieval Battle: Najera (April 3, 1367), a Pyrrhic Victory for the Black Prince, Leiden/Boston, Koninklijke NV, 2017, pp. 272-278, 289n et 292-295.
Par. 555 Pendant ce temps, le mécontentement grandissait en Angleterre. Il s’est notamment manifesté lors du Parlement de 1376, surnommé le Bon Parlement (Good Parliament). C’est alors que la Chambre des communes, qui siégeait séparément des pairs à cette époque, a mis en accusation des ministres de la Couronne par une procédure appelée l’impeachment, une autre première dans l’histoire de l'institution. Le chambellan du roi, William de Latimer, et son sénéchal, John Neville, ont compté parmi ses premières victimes. Les chefs d’accusation étaient la corruption et le détournement de fonds publics. Vu que le Prince Noir était décédé peu avant, c’est Jean de Gand, duc de Lancastre et troisième fils d’Édouard III, qui a défendu les membres du gouvernement. Il s’est opposé avec succès à l’initiative des communes et a sévèrement puni les principaux responsables. Toutefois, un précédent avait été créé : la Chambre des communes avait mis en accusation des ministres du roi, afin de les faire juger après devant les lords du Parlement.
Proceedings in the Good Parliament of 1376, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 117-121. Notons que la procédure d'impeachment pour mettre en accusation des officiers gouvernementaux est tombée en désuétude en Angleterre depuis l'avènement du gouvernement responsable au XIXe siècle. Elle demeure d'actualité aux États-Unis d'Amérique où elle a été codifiée à l'article 1, section 2, paragraphe 5 et à l'article 1, section 3, paragraphes 6 et 7 de la Constitution de 1789.
Par. 556 Parmi les autres nouveautés du règne d’Édouard III, mentionnons l’arrivée des juges de paix (justice of the peace). C’est un statut du Parlement de 1327 qui a prescrit la nomination dans chaque comté d’hommes bons et respectueux des lois comme gardiens de la paix. Ils ne prendront toutefois le nom de juges de paix qu’en 1361, lors de l’adoption d’un autre statut du Parlement. Les juges de paix remplaceront les shérifs pour devenir les principaux officiers de la Couronne dans les comtés.
Justice of the Peace Act (1327), 1 Edw. 3, Stat 2, c. 16, Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 257; Justice of the Peace Act (1361), 34 Edw. 3, c. 1, Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 364-365.
Par. 557 Retenons également que les communes du Parlement, qui ont délibéré séparément des lords en 1332, avant leur séparation définitive en deux chambres distinctes dès 1341, se sont vues reconnaître le droit d’approuver toute modification aux droits de douane, notamment ceux connus après 1373 sous les noms de tunnage (montant calculé d’après le volume de la marchandise) et de poundage (montant calculé d’après le poids de la marchandise). Ces divers droits, perçus dans les ports de mer depuis le début du XIIIe siècle et même avant, quoique selon d’autres modalités, étaient exigés des marchands qui importaient ou exportaient des biens d’Angleterre. Les importations portaient principalement sur le vin et les tissus de luxe, alors que les exportations portaient surtout sur la laine, les peaux et les cuirs.
S. DOWELL, A Sketch of the History of Taxes in England, vol. 1 (To the Civil War, 1642), Londres, Longmans, Green, and Co., 1876, pp. 156-168 et 259; W. STUBBS, The Constitutional History of England, vol 3, 5eéd., Oxford, Clarendon Press, 1903, p. 445.
Mesures de tunnage et poundage au port de mer
Gravure tirée du Livre d’Heures de Marguerite d’Orléans. Paris, c. 1430. BnF, Mss, Latin 1156 B f. 174

9.5 Absolutisme de Richard II
Par. 558 Édouard III est mort le 21 juin 1377. Un statut du Parlement adopté sous son règne avait confirmé la coutume de primogéniture. Celle-ci comprenait le droit d’accéder à la Couronne par représentation, ce qui signifie qu’un enfant dont le père était mort avant de devenir roi pouvait néanmoins hériter de son grand-père, exactement comme si son père avait régné. Voilà pourquoi Richard II (règne 1377-1399), le fils du Prince Noir, a pu succéder au roi Édouard III.
Status of Children Born Abroad Act (1350), 25 Edw. 3, stat. 2, Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, p. 310.
Portrait fictif du roi Richard II
National Portrait Gallery
Il est fictif parce que réalisé longtemps après sa mort, possiblement d'après les descriptions données par ses contemporains

Par. 559 Le pauvre Richard ne savait pas ce qui l’attendait. En effet, son grand-père Édouard avait enrichi considérablement ses enfants, tout en les maintenant sur un pied de guerre. Il avait de la sorte créé quatre grandes familles de Plantagenêts disposant chacune d’une armée privée. On trouvait à leur tête Lionel, duc de Clarence, Jean de Gand (John of Gaunt), duc de Lancastre, Edmond de Langley, duc d’York, et Thomas de Woodstock, duc de Gloucester. Richard II a donc dû se confronter toute sa vie à des oncles ou à des cousins presque aussi riches et puissants que lui. Lionel étant mort avant son père, c’est le troisième fils du défunt roi Édouard, Jean de Gand, qui a pris l’ascendant sur les autres. Cela a été une bénédiction pour le jeune Richard, car son oncle de Lancastre sera de loin son parent le plus dévoué et le plus fidèle. Les autres ne mériteront pas autant d’éloges.
Arbre généalogie 3
Déjà reproduit au paragraphe 373

Par. 560 Richard II a été couronné le 16 juillet 1377 à l’abbaye de Westminster, fondée par Édouard le Confesseur, imitant ainsi tous les rois d’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Richard a juré, dans son serment de Couronnement, de maintenir les lois et les coutumes de ses ancêtres, de protéger l’Église et son clergé, puis de rendre justice à tous. Il s’est également engagé à respecter les lois que le peuple se choisirait, comme l’avaient promis ses grand-père et arrière-grand-père Édouard III et Édouard II. Toutefois, les conseillers de Richard ont nuancé la portée de son serment, lorsqu’ils l’ont colligé par écrit, en ajoutant les mots justes et raisonnables afin de qualifier les lois auxquelles le roi obéirait. Enfin, Richard a été oint de l’huile sacré qui a fait de lui le représentant de Dieu sur terre.
The coronation of King Richard II, 1377, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 404-405.
Par. 561 Pas plus qu’Henri III ou Édouard III, Richard, âgé de 10 ans, n’a pu assurer la gouvernance le royaume avant d’atteindre l’âge adulte. Son oncle Jean de Gand, le duc de Lancastre, en a pris charge à sa place, d’ailleurs avec talent et probité, sans qu’aucun conseil de régence n’ait été nommé pour le seconder. D'ailleurs aucun conseil du genre n'avait été prévu. On a tout simplement fait comme si Richard avait été réellement compétent pour gouverner. Il commencera lentement à s’émanciper pendant sa quatorzième année, mais toujours sous l'oeil bienveillant de son oncle pour encore quelques années.
N. SAUL, Richard II, Yale University Press, Londres, 1999, p. 108.
Par. 562 Le roi Richard a immédiatement démontré une certaine habileté dans la direction des affaires. Son talent pour se tirer d’un mauvais pas s’est manifestée lors d’un soulèvement des paysans anglais causé par un impôt honni : la capitation ou poll tax. Le gouvernement de Richard avait obtenu du Parlement en 1380 le droit de percevoir cet impôt par tête à taux unique. Quelle que soit sa fortune, chacun devait verser le même montant au trésor public. L’impôt frappait donc plus durement les pauvres que les riches si l’on tenait compte de leurs moyens respectifs. Un impôt semblable avait déjà été prélevé en 1377, puis en 1379, mais à un tiers du nouveau taux. Cette fois, la coupe débordait. Les plus déshérités ont éprouvé le sentiment d’avoir été traités injustement. Pour la première fois dans l’histoire de l’Angleterre, la masse des paysans s’est révoltée.
The Poll Tax of 1380, Registre du parlement traduit en anglais, dans G.B. ADAMS et H.M. STEVENS, Select Documents of English Constitutional History, Londres, MacMillan Co., 1901, pp. 142-144. Pour un compte-rendu détaillé des événements, voir The Peasant's Revolt, 1381, The Anonimalle Chronicle, reproduit dans E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 127-140.
Par. 563 Le roi Richard a été brillant et sans peur à cette occasion, il faut l’avouer, en cherchant à gagner du temps, de manière à préparer une contre-offensive. Sa politique a été d’avoir recours à la conciliation, en faisant appel à la raison, mais non sans arrière-pensée.
Par. 564 Richard, après avoir pris conseil de ses ministres, alors réunis à la Tour de Londres le jeudi 13 juin 1381, avait accepté de rencontrer les chefs rebelles à Mile End, un quartier de Londres aux mains des insurgés. Il fallait du courage au roi pour consentir à ce qui aurait pu être un guet-apens, voire une prise d’orage. Des ministres ont certainement manifesté leur inquiétude ou leur opposition. Mais le roi s’est quand même rendu à Mile End le lendemain 14 juin pour annoncer aux chefs rebelles qu’il acceptait la plupart de leurs demandes de réforme, soit l’abolition de la servitude, un loyer plus bas pour les terres tenues en censive, et une amnistie générale des rebelles. Alors que cette rencontre se déroulait, les paysans ont pénétré dans la Tour de Londres, puis ont tué le lord chancelier Simon Sudbury et le trésorier Robert de Hales.
Par. 565 Le 15 juin, le roi Richard a quitté Londres pour se rendre cette fois à Smithfield, un lieu champêtre situé juste au nord de la Cité, afin d’y rencontrer à nouveau les insurgés, notamment leur chef de file, un certain Wat Tyler (l’homme avait cogné un peu trop fort le percepteur de taxes venu quelques semaines plus tôt à sa maison). Leurs demandes ressemblaient à celles mentionnées à Mile End. En autant que l’on sache, Richard entendait poursuivre sa politique de conciliation. La suite a fait l’objet de plusieurs versions dépendant des chroniqueurs. Il semble, néanmoins, que les esprits se soient échauffés par suite d’actions et de paroles menaçantes et provoquantes du chef rebelle, alors sur son cheval et armé. Le maire de Londres, craignant pour la sécurité du roi, l’aurait alors frappé et fait tomber de sa monture. Un ou plusieurs écuyers ont ensuite tiré leur épée et tué l’homme désormais sans défense. Le roi, apparemment surpris, car il n’avait rien à gagner à cet assassinat, car sa vie était vraiment en jeu, a approché calmement les insurgés et leur aurait déclaré qu’il était leur véritable capitaine et guide. Cela a suffi pour créer la confusion dans leurs rangs et permettre au roi de rejoindre ses troupes en armes.
B. WILKINSON, « The Peasants’ Revolt of 1381 », (1940) vol. 15 Speculum 12, pp. 20-29; P. de Vericour, « Wat Tyler », (1873) vol. 2 Transactions of the Royal Historical Society 77, pp. 88-92.
Mort de Wat Tyler
Illustration, Bibliothèque Nationale, Paris, MS Fr. 2644, f. 159

Par. 566 Richard ordonna ensuite de réprimer la révolte paysanne dans le sang. De nombreuses exécutions ont eu lieu. Au moyen d’une proclamation, le roi, en accord avec le Parlement, a abrogé toutes les concessions faites aux insurgés. Et un pardon royal a enfin été accordé à tous ses loyaux sujets pour les exactions commises par les deux parties au conflit, donc autant la noblesse que les paysans, une condition jugée nécessaire s'il voulait rétablir la paix dans le royaume.
The Peasant's Revolt, 1381, The Anonimalle Chronicle, préc. au par. 562, p. 140. Voir aussi Parliament supports the repeal of concessions made to the peasants and demands reforms in the government of the realm, 1381, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 142-143, ainsi que The King’s Pardon to those that repressed or punished his Rebels (1381), 5 Ric. II, stat. 1, c. 5, Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, p. 20.
Part. 567 Cette expérience a encouragé Richard II à devenir encore plus actif dans la gouvernance du royaume, notamment lors du Parlement d'avril 1384 tenu à Salisbury. Il avait maintenant 17 ans. Toutefois, Richard n’avait pas l’habilité du Prince Noir dans l’art de combattre, ni celle de son grand-père Édouard III dans la gestion des affaires du royaume. Le jeune roi a donc rapidement démontré son incompétence. Pour commencer, il a distribué les insultes à tout vent, menaçant ici un archevêque, vouant là un comte aux flammes de l’enfer. Le chancelier et archevêque de Cantorbéry, Thomas Arundel, admettra candidement que Richard ne savait pas tenir sa langue. Et si ce n’était pas assez, une expédition militaire désastreuse contre les Écossais en 1385 a miné encore davantage son crédit auprès de la noblesse. Rien ni personne ne pouvait cependant l’atteindre tant que le puissant Jean de Gand le protégeait.
Précisons cependant que Arundel a prononcé ces paroles à l'occasion d’un sermon le 30 septembre 1399, donc après la déchéance de Richard. Il n’aurait jamais osé faire usage d’une telle liberté de parole avant. Lire ARUNDEL, cité par C. FLETCHER, dans « Manhood and Politics in the Reign of Richard II », (2005) Past and Present 3, p. 5. Lire également, du même auteur, Richard II, Manhood, Youth, and Politics, 1377-1399, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 20, 48, ainsi que N. SAUL, Richard II, New Haven (CT), Yale University Press, 1999, pp. 130-131.
Par. 568 Après le départ en juillet 1386 de Jean de Gand pour la péninsule ibérique, et plus précisément pour la Galice qu’il souhaitait conquérir, le Parlement, surnommé le Parlement Extraordinaire (Wonderful Parliament), en a profité pour s’attaquer au chancelier Michael de la Pole, comte de Suffolk. Le roi Richard, pris de peur, a congédié son ministre sans attendre. Non satisfaites du seul congédiement, les communes ont également procédé à la mise en accusation (impeachment) de l’ancien chancelier en invoquant les motifs de détournement de fonds, de négligence et de mauvaise administration. Seul le premier motif a été retenu par les lords au moment du procès, ce qui a suffi pour condamner le malheureux à la prison où il est resté jusqu’à la Noël 1386.
The impeachment of Michael de la Pole and the appointment of the Commission of Reform, 1386, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 150-152.
Portrait fictif de Jean de Gand, duc de Lancastre,
l'ancêtre commun de tous les rois et reines d'Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni
Peinture de 1593 réalisée sur commande de sir Edward Hoby pour le château de Queensborough dans le Kent
Son auteur s'est probablement inspiré de l'effigie sur sa tombe dans la vieille cathédrale Saint-Paul de Londres

Par. 569 Toujours d’humeur maussade, le Parlement a créé une commission de 14 membres auquel il a confié la responsabilité de superviser les dépenses de Richard, et proposer des recommandations sur la gestion de la maison du roi. Ils jugeaient celui-ci trop prodigue et mal servi par ses conseillers. La commission, dont le mandat a été prolongé jusqu’en novembre 1387, donc pour une durée d’un an après la fin du Parlement, s’est appropriée tous les leviers du gouvernement aux dépens d’un roi impuissant à l’empêcher.
Recital of the Commission granted by the King, by assent of the Parliament, to certain Prelates, Lords, &c., to be of his continual Council for One Year, 1386, 10 Ric. 2, c. 1, Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, pp. 40-43.
Par. 570 L’opposition a repris l’offensive dès le 3 février 1388, lors du Parlement suivant tenu cette fois à Westminster, celui connu sous le nom de Parlement Impitoyable (Merciless Parliament). Sur l’avis de ses conseillers, le roi avait proposé peu avant de redonner quelques châteaux et cités à La France, plutôt que de poursuivre la guerre en taxant davantage ses sujets. En outre, des rumeurs couraient que ces mêmes conseillers projetaient d’éliminer physiquement leurs adversaires à la Chambre des lords. L’atmosphère s’appesantissait. Le roi, inquiet, s’est alors informé de ses appuis au sein de la population de la capitale. Les lords ont immédiatement réagi en déclarant l’état d’urgence et en demandant l’arrestation des principaux conseillers du roi.
The development of the crisis of 1388 according to the Monk of Westminster, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 154-156.
Par. 571 Cinq ministres ou favoris de Richard II ont été mis en accusation par les communes pour trahison et condamnés par les lords à la peine de mort. Il s’y trouvait toujours l’ancien chancelier Michael de la Pole, auquel s’était rajouté le chambellan Robert de Vere, le juge en chef Robert Tresilian, l’ancien maire de Londres Nicholas Brembre, et enfin l’archevêque d’York Alexandre Neville. De la Pole, Neville et de Vere ont pu enfuir avant leur arrestation, tandis que Brembre et Tresilian ont été capturés et exécutés. Un Richard résigné a dû ratifier ces condamnations à son corps défendant parce qu’il n’avait pas encore les moyens de se défendre.
The Merciless Parliament of 1388, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 156-160; The Merciless Parliament according to Thomas Favent, 1388, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 161-163.
Par. 572 Le calme est revenue avec le retour de Jean de Gand au pays en novembre 1389. Un Richard II, âgé de 22 ans, a de suite convoqué et réuni les lords dans la chambre du conseil pour leur annoncer qu’il n’avait plus besoin de tuteurs et dirigerait désormais son royaume en toute liberté. En conséquence, a-t-il ajouté, « [Traduction] je vais renvoyer ces derniers de mon gouvernement, et, en tant qu’héritier ayant l’âge légal, je vais nommer ceux de mon choix pour les remplacer, et conduire mes propres affaires ». Et dans l’instant, il a nommé un nouveau chancelier et neuf autres conseillers, en plus de créer cinq nouveaux juges.
The king takes the government into his own hands, 1389, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 164-165.
Par. 573 Le roi Richard a patienté huit longues années avant d’assouvir sa vengeance. Nous étions en 1397. Cela dit, la vengeance ne constituait peut-être pas le seul motif. Le roi, constamment l’objet de critiques, pouvait craindre un autre coup de force des barons. Quoi qu’il en soit, il a fait exécuter ou bannir tous ses ennemis du Parlement Impitoyable, dont l’archevêque de Cantorbéry Thomas Arundel, le duc de Gloucester Thomas de Woodstock, le comte de Warwick Thomas Beauchamp et le comte d’Arundel Richard Fitzalan. Henri Bolingbroke, le fils de son protecteur Jean de Gand, comptait même parmi les exilés. Ayant enfin brisé ses chaînes, Richard a entrepris de gouverner en monarque absolu, donc sans aucune retenue, et surtout sans se soucier d’obéir aux lois du royaume.
The confession of Thomas Duke of Gloucester, 1397 et The arbitrary rule of Richard II, 1397-9, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 170-172 et 172-174.
Par. 574 Richard a alors prélevé des impôts arbitraires, dépensé beaucoup et mal, en plus d’emprisonner ceux qui osait le contrarier. Son vieux et fidèle protecteur Jean de Gand est mort en février 1399. Au lieu de pardonner à son fils Henri, désormais le nouveau duc de Lancastre, Richard a modifié sa peine pour le bannir à vie et lui confisquer toutes ses terres anglaises. Cela a été une très grave erreur. Plus aucun baron ne s’est senti en sécurité. Henri de Lancastre a alors décidé de conduire la rébellion en Angleterre en réunissant autour de lui tous les mécontents. Et ils étaient nombreux. Henri, peu après son débarquement sur les côtes anglaises, a capturé Richard, l’a emprisonné à la Tour de Londres, puis l’a contraint à abdiquer avant de lui prendre sa Couronne. Il est devenu le roi Henri IV d’Angleterre (règne 1399-1413), premier souverain plantagenêt de la famille de Lancastre.
The oppressions of Richard II, 1399, The revocation of Henry of Lancaster’s rights of inheritance, 1399, Henry of Bolingbroke usurps regal powers soon after his landing, August 1399, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 177-178, 178-179 et 179.
Par. 575 Encore ici, y-a-t-il vraiment eu abdication de Richard II ? Ou ne serait-ce pas plutôt la destitution d’un roi par le Parlement ? L’ambiguïté a persisté, comme au temps d’Édouard II. Nous y reviendrons.
The preparation of Richard II’s deposition, 1399, The deposition of Richard II according to a supporter of his, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, pp. 179-180 et 180-184.
9.6 Langues du droit et de l'Administration publique
Par. 576 L’Angleterre (le Royaume-Uni aujourd’hui) et la France sont deux États qui se sont constitués en suivant un mouvement inverse l’une de l’autre; en effet, l’Angleterre a d’abord été une nation, bien sûr composée d’Anglo-Saxons, que ses rois ont rapidement unifiée pour en faire un État, alors que les rois de France, après des siècles d’effort et la poursuite d’une politique assumée, ont plutôt constitué leur État à partir de plusieurs nations distinctes, desquelles une nouvelle nation a émergé. L’Angleterre, puissante en raison de son unité culturelle et politique, a donc pu rivaliser avec une France certes beaucoup plus populeuse, également assujettie à une seule Couronne, mais demeurée pendant longtemps un assemblage de peuples divers : basque, gascon, provençal, catalan, breton, gallo, alsacien, etc., chacun avec sa langue et ses coutumes. Comme cette évolution a souvent accompagné l’usage des langues anglaise et française, nous évoquerons les principaux faits ayant marqué leur progression ou leur régression au sein des élites et du gouvernement de chaque pays, en portant bien sûr notre attention sur l’Angleterre.
Par. 577 Après la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie, on a parlé le français à la Cour d’Angleterre, bien qu’il faudrait préciser qu’il s’agissait d’un français mâtiné d’influences scandinaves, un héritage des vikings. Guillaume et ses hommes ne connaissaient pas l’anglo-saxon. Cela les a certainement empêchés d’établir de véritables relations humaines avec le peuple anglais. La première génération de Normands, retranchée dans ses châteaux et ses places fortes, s’en est peu souciée. Sa connaissance de l’anglo-saxon est donc demeuré rudimentaire. Mais le bilinguisme a rapidement fait des progrès chez les Normands de seconde et troisième génération, essentiellement parmi les classes sociales supérieures.
Note : Les Français du Moyen Âge se moquaient parfois de la langue orale de leurs interlocuteurs vivant de l’autre côté de la Manche. Ils disaient notamment du patois normand des Anglais, de ce français d’Angleterre, qu’il était « rêche », « incorrect » et « pénible » pour les oreilles habituées aux dialectes de nos régions. Ch. V. LANGLOIS, « Les Anglais du Moyen-Âge, d’après les sources françaises », (1893) T. 52 Revue historique 298, p. 311.
Par. 578 Quoique le Français, depuis l’arrivée des Normands, soit devenu la langue de la Cour, des officiers de la Couronne, du clergé, ainsi que de la noblesse, aucune preuve ne vient étayer l’idée qu’il soit également devenu la langue du droit. Parce que Guillaume Ier s’est présenté comme l’héritier légitime de son prédécesseur, Édouard le Confesseur, il n’a pas voulu bouleverser les habitudes des habitants. Les lois devaient demeurer ce qu’elles étaient. Bien sûr, l’introduction et la généralisation du féodalisme normand, de ses titres de noblesse et des fonctions gouvernementales associées, a requis une certaine adaptation et la réception d’un vocabulaire approprié. Cela mis à part, les cours locales de shire et de hundred ont certainement maintenu leurs activités comme avant. Ruraux et citadins ont eux-aussi continué leur vie en communiquant dans la langue du pays, sans ressentir le besoin d’y changer quoi que ce soit. Il reste que les quelque 20 000 Normands et autres Français qui se sont établis outre-manche avec leur bagage lexical influenceront durablement l’anglo-saxon parlé et écrit par les autochtones.
G.E. WOODBINE, « The Language of English Law », (1943) vol. 18 Speculum 395, pp. 405 et 433-434; S. ALBERT, Analyse diachronique du Trésor de la langue française et de l’Oxford English Dictionary : le traitement des emprunts, Thèse de doctorat, Linguistique, Université de Cergy-Pontoise, 2018, pp. 54-55 et 84.
Par. 579 La séparation de l’Angleterre et de la Normandie pendant la seconde moitié du règne d’Étienne, entre 1144 et 1154, a isolé une première fois la noblesse anglaise de souche normande de celle restée sur le continent. Anglais et Normands vivant dans la grande île ont conséquemment vécu plus près les uns des autres. Les mariages mixtes se sont normalisés. Il devenait alors plus difficile de dire de distinguer l’Anglais du Normand de naissance. C’était l’amorce d’une réconciliation entre les deux races, au point sinon d’oublier, du moins d’apaiser le traumatisme de la conquête de 1066. En somme, la noblesse normande, certes toujours consciente de ses racines, de son identité normande, qui lui conférait un sentiment de supériorité, se transformait lentement en Anglais, et ce avec d’autant plus de conviction que ses biens et ses terres se trouvaient en Angleterre et non en France. Par la suite, le français est devenu pour elle une langue seconde que l’environnement politique et culturel l’a obligé à conserver.
H.M. THOMAS, The English and the Normans : Ethnic Hostitily, Assimilation and Identity, 1066-1220, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 71 et 77-79; S. LUSIGNAN, La langue des rois au Moyen-Âge; Le Français en France et en Angleterre, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, p. 6. Lire également N. WEBER, The Evolution of Norman Identity 911-1154, Woodbridge, The Boydell Press, 2005.
Par. 580 Dans la seconde moitié du XIIe siècle, un français différent, d’origine poitevine, aquitaine et provençale, a fait son entrée à la Cour d’Angleterre avec l’arrivée des Plantagenêts et d’un renouvellement d’une grande partie des élites en provenance du continent. Dans une forme transformée, spécifique à l’Angleterre, elle restera la première langue apprise et comprise des souverains d’Angleterre jusqu’à l'arrivée d'Henri IV en 1399. À partir de 1250, ou dans ses environs, ce français particulier à l’Angleterre est devenu le véhicule de la volonté royale, la langue de la common law, des débats parlementaires, ainsi que de la culture. Dès lors, les hauts barons et les membres de la gentry n’ont guère eu de choix : la satisfaction de leurs ambitions personnelles passait par la maîtrise du français. Comme l’a si bien rappelé un auteur canadien, le politologue Léon Dion, « Le statut d’une langue dans une société est exactement celui de ceux qui parlent cette langue. Si les parlants, ceux qui parlent une langue, ont un statut social inférieur, la langue dans cette société aura un statut inférieur et inversement, quels que soient les nombres, quels que soient les autres facteurs. »
ALBERT, préc. au par. 578, p. 55; W. ROTHWELL, « Language and Government in Medieval England », (1983) Bd. 93, H. 3 Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 258, p. 262; L. DION, Journal des débats, Assemblée nationale Québec, 3 février 1981, p. B-1367.
Par. 581 Les premiers Plantagenêts ont conservé l’usage du latin pour la rédaction des chartes royales et l’ont adopté pour l’écriture des brefs de justice. Ces actes, authentifiés par le grand sceau d’Angleterre, ont continué d’être en latin lors des règnes suivants, et l’étaient toujours en 1509 pour les chartes et en 1702 pour les brefs de justice. Des traductions françaises ou anglaises étaient néanmoins produites lorsqu’un document devait être lu publiquement par les shérifs dans les cours de comté. On sait aussi que la Magna Carta de 1215 a été immédiatement traduite dans le français de l’époque pour être mieux comprise des barons rebelles. Les clercs de la Chancellerie, responsables de leur rédaction, employaient donc rarement le français. Seul le clerc détaché aux affaires du Parlement écrivait régulièrement dans cette langue, ce qui allait de soi puisque les débats se déroulaient en français dans son enceinte.
WOODBINE, préc. au par. 578, p. 435, note infrapaginale 1. Voir également ANONYME, Magna Carta, Incipit référence de l’œuvre : « Johan par la grace de Deu roi d’Engleterre as axceveskes as eveskes… », Bibliothèque patrimoniale Villon de Rouen, cote Ms 1232, folio 81r-87v.
Par. 582 Le français est effectivement devenue la langue du Parlement au cours du XIIIe siècle. À partir de 1275, ses statuts ont été adoptés dans le désordre en français ou en latin, avant que le français ne s’impose définitivement dès le début du règne d’Édouard III en 1327. Quoique la langue des lois ait continué d’être le français jusqu’en 1488, son déclin au sein du Parlement au profit de l’anglais avait commencé bien avant. Un premier projet de loi présenté sous la forme de pétition adressée au roi et rédigée en anglais avait déjà été déposé en 1414. Les pétitions dans cette langue sont devenues majoritaires après 1436. L’anglais a même été employé au Parlement bien avant, soit en 1362, lorsque le roi Édouard III y a prononcé son discours d’ouverture, voire aussi tôt qu’en 1337, lorsqu’un clerc licencié en droit s’est exprimé dans la langue du pays sur le sujet de la guerre qui s’annonçait afin de se faire mieux comprendre, « à la fin que il fust mieuls entendus de toutez gens » a écrit le chroniqueur Jean Froissart. On peut donc raisonnablement supposer que les parlementaires n’avaient jamais complètement cessé de parler anglais lors leurs débats en alternance avec le français.
FROISSART, préc. au par. 515, p. 360; WOODBINE, préc. au par. 578, pp. 401-402, note infrapaginale 4; G. DODD, « The Rise of English, the Decline of French : Supplications to the English Crown, c. 1420-1450 », (2011) vol. 86 Speculum 117, pp. 124 et 135 note infrapaginale 64; W.M. ORMROD, « The Use of English : Law, and Political Culture in Fourteenth-Century », (2003) vol. 78 Speculum 750, p. 778. La dernière loi adoptée en français a été promulguée par le roi Henri VII en 1487 : Loi sur les fiduciaires, 3 Hen. 7, c. 16, Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, p. 523.
Par. 583 Le français d’Angleterre s’est également imposé dans les cours royales de justice lors du règne des premiers plantagenêts. Il n’y avait rien de surprenant. Henri II (règne 1154-1189) et ses fils Richard Ier (règne 1189-1199) ou Jean (règne 1199-1216) parlaient à peu près uniquement le français. Les juges nommés, presque tous recrutés dans des familles d’origine françaises, devaient évidemment communiquer avec leur maître. Sans doute utilisé à l’oral dès la création de la Cour de l’Échiquier, des Plaids communs et du Banc du roi, le français est aussi devenu la langue écrite de ces tribunaux dès que la common law a atteint sa première maturité et que des professionnels du droit ont commencé à y œuvrer, soit aux environs des années 1260-1270. À la même époque, on a crû nécessaire de compiler des comptes rendus des décisions les plus importantes, dont ces mêmes professionnels allaient se servir à titre de précédents et pour l’enseignement du droit. Pareillement, les plus anciens documents écrits en français, qui traitent uniquement de procédure, et servant aux professionnels du droit, datent de la fin du règne d’Henri III, toujours entre 1260 et 1270.
LUSIGNAN, préc. au par. 579, p. 42; J. VISING, Anglo-Norman Language & Litterature, Londres, Oxford Univerisity Press, 1923, p. 12; G.E. WOODBINE, Four Thirteenth Century Law Tracts, New Haven, Yale University Press, 1910, pp. 11 et 20.
Par. 584 Et pourtant la connaissance du français spécifique à l’Angleterre a décliné avec les années, à tel point qu’au milieu du siècle suivant, il se trouvait peu de personnes qui le maîtrisaient en dehors du cercle restreint des praticiens du droit. D’après le chroniqueur Jean Froissart, l’apprentissage du français avait été tellement négligé que le roi Édouard III, au début de la guerre de Cent Ans, en septembre 1337, aurait demandé aux nobles et aux bourgeois de son Parlement qu’ils apprennent cette langue à leurs enfants. Ils seraient ainsi plus aptes à comprendre leurs ennemis et à les combattre : « par quoy ils en fuissent plus able et plus coutummier ens leurs gherres ». Mais c’était peine perdue ! Le mouvement vers l’unilinguisme anglais paraissait irréversible. Réagissant à cela, Édouard, en 1362, donc la même année où il a prononcé son discours d’ouverture du Parlement dans la langue du pays, a promulgué une loi faisant de l’anglais la langue officielle des tribunaux. Son propos liminaire mentionnait les torts causés aux justiciables, parce que ceux-ci ne pouvaient comprendre les plaidoiries des sergents du droit et des attorneys, pas plus que les décisions des juges, quand elles étaient rendues en français.
LUSIGNAN, ibid.; FROISSART, préc. au par. 515, p. 402 (certains auteurs contestent ici l’exactitude du récit de Froissart); Statut des plaidoiries, 36 Edw. 3, c. 15, dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, pp. 375-376.
Par. 585 Malgré le statut de 1362 sur l’usage de l’anglais devant les tribunaux, l’attachement au français n’a pas cessé. Cela s’explique par le fait que les plus importantes décisions de justice, celles plaidées à titre de précédents et qui servaient à l’apprentissage du droit, avaient toutes été rédigées en français depuis 1268. Et elles comportaient des termes de vocabulaire ayant chacun un sens très précis qui s’avérait intraduisible en anglais. Ces décisions, par ailleurs les fondements de la common law, seront éventuellement compilées à partir du XVIe siècle dans des recueils de jurisprudence connus sous le nom de Year Books. Le français qu’on y trouvait était cependant de plus en plus méconnaissable. Il était devenu une langue archaïque et sclérosée remplie d’expressions désuètes, une sorte de jargon technique accessible aux seuls initiés. On l’a appelé le french law. Une loi du Parlement mettra fin définitivement à l’emploi du french law dans les cours de justice anglaise en 1731.
VISING, préc. au par. 583, p. 23; An Act, That all Proceedings in Courts of Justice, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language, (1731) 4 Geo. 2, c. 26.
Par. 586 Le statut quasi hégémonique du français à la Cour d’Angleterre ne pouvait survivre à l’époque même où la conscience d’une appartenance nationale a pris racine dans le pays, parallèlement à celui qui s’est développé en France, presqu’en symbiose. Durant tout le XIVe siècle, les dirigeants, de part et d’autre de la Manche, exalteront cette conscience nationale afin d’atteindre leurs objectifs politiques et militaires.
Par. 587 Édouard Ier (règne 1272-1307) a été le premier roi à jouer la carte de l’identité anglaise à des fins politiques. C’était en1295. Les Français effectuaient des raids sur les côtes anglaises. Plusieurs craignaient une invasion. Édouard a alors appelé ses sujets à défendre leur langue et leur nation contre le roi de France. Il s’est toutefois gardé de trop les enflammer, parce qu’il entretenait toujours des ambitions de l’autre côté de la Manche.
M. PRESTWICH, Edward I, New Haven, Yale University Press, 1997, pp. 283 et p. 283 note infrapaginale 21.
Par. 588 Un tournant décisif s’est produit sous le règne de son petit-fils, le roi Édouard III (règne 1327-1377). Pour faire oublier la conquête normande et exalter les racines autochtones de la royauté, Édouard a fait revivre le mythe du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde en créant en 1348 le Très Noble Ordre de la Jarretière (The Most Noble Order of the Garder en anglais), auquel il a cependant donné une devise française : « Honni soit qui mal y pense ». Aujourd’hui encore, l’Ordre ne compte que 24 membres en dehors du roi Charles III et du prince William. Édouard III a également entrepris d’angliciser l’appareil gouvernemental en milieu de règne. Puisqu’elle formait ses futurs cadres, l’Université d’Oxford s’est lentement convertie à l’usage de l’anglais à partir de 1349, un mouvement qui s’est accéléré en 1385. Même les nobles ont cessé d’enseigner le français à leurs enfants comme première langue, a écrit John Trevisa, un professeur (fellow) à l’Université d’Oxford de 1372 à 1376.
J. TREVISA, The Language of Britain, 1387, document reproduit par K. SISAM, dans Fourteenth Century Verse & Prose, Oxford, Clarendon Press, 1921, réimpression 1964 (avec corrections), pp. 148-149; R. INGHAM, « Middle English and Anglo-Norman in Contact », (2012) vol. 81 Études Médiévales Anglaises 1, p. 8; M. HÄCKER, « French-English Linguistic and Cultural Contact in Medieval England : The Evidence of Letters », (2011) vol. 36 AAA:Arbeiten aus Anglitik und Amerikanistik 133, pp. 138-139.
Par. 589 La progression de la langue anglaise s’est confirmée en 1362, lorsque le roi Édouard a prononcé dans cette langue le discours d’ouverture du Parlement et qu’il a tenté, sans succès cependant, de faire de la langue du pays la langue des tribunaux. Il va sans dire que toute la noblesse d’Angleterre a suivi le mouvement. Certes, en cette fin de siècle, voire jusqu’au milieu de XVe siècle, le français est demeuré une langue prestigieuse que toute personne bien née devait connaître, mais apprise après l’anglais, seulement comme langue seconde. On ne parlait plus le français en famille.
Par. 590 Ces changements introduits par Édouard III coïncidaient, et ce n’était pas un hasard, avec le début de la guerre de Cent Ans (1337-1453), une période au cours de laquelle le discours antifrançais s’est intensifié. Le roi y a contribué, aux cours des années 1344, 1346 et 1377, en jouant la carte de l’identité menacée, notamment en reprenant l’argument de son grand-père Édouard Ier, à savoir qu’une victoire française entrainerait la destruction de la langue anglaise : ses mots de 1377, très violents, étaient que les ennemis du roi conspiraient « to blot out the English tongue and name from under heaven ». De la sorte, Édouard affermissait le sentiment, déjà présent parmi le peuple, que leur langue représentait le principal facteur de leur identité nationale. Son sentiment semblait honnête. Mais ce n’était pas totalement sans arrière-pensée; Édouard espérait ainsi convaincre le Parlement de lui voter les crédits nécessaires au financement de sa guerre.
ORMROD, préc. au par. 582, p. 780; W. COBBETT, Cobbett’s Parliamentary History of England, vol. 1, Londres, R. Bagshaw, 1806, p. 144. Lire aussi I. MORTIMER, The Fears of Henri IV; The Life of England’s Self-Made King, Londres, Vintage Books, 2013, pp. 14 et 23.
Par. 591 Paradoxalement, certainement en apparence, Édouard III a ajouté sur ses armoiries des fleurs de lys, symbole de la royauté française, puis a adopté une devise française, qui souvent les accompagnaient : « Dieu et mon droit ». C’était une manière d’asseoir sa légitimité quand il s'est fait proclamer roi de France lors d'une cérémonie dans la cité de Ghent en janvier 1340. Richard Cœur de Lion en a été l’auteur. Il s’agissait en réalité d’un simple mot de passe imaginé par Richard à l’occasion de la bataille de Gisors en 1198. Sa signification était qu’Henri V et son aïeul Richard ne devaient leur position qu’à Dieu et à leur hérédité, qu’ils n’étaient donc assujettis à aucun autre pouvoir sur terre. Les armoiries ont évolué avec les années et les règnes, mais la devise d’Édouard III est demeurée celle des rois et reines d’Angleterre, de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, dans sa version originale française. On la retrouve aujourd’hui ornant les armoiries du roi Charles III, sans les fleurs de lys qui ont bien sûr été abandonnées après l’abolition de la monarchie française le 21 septembre 1792.
Sur l’origine de la devise et des nouvelles armoiries, lire W. DETHICK, principal roi d’armes de la Jarretière de 1586 à 1612, « On the Antiquity of Motts, & c. in England », 28 novembre 1600, discours reproduit dans T. HEARNE (éd.), A Collection of Curious Discourses written by Eminent Antiquaries Upon Several Heads in the English Antiquities, vol. 1, Londres, T. Evans, 1773, p. 275; E. LE POITEVIN DE LA CROIX, Histoire des expéditions militaires d’Édouard III et du Prince Noir, Anvers, P. Tessaro, 1854, pp. 88-89; T.F. TOUT, The Political History of England, From the Accession of Henry III to the Death of Edward III (1216-1377), vol. 3, Londres, 1904, p. 344. Plus récemment, lire J. BARKER, Agincourt : Henry V and the Battle that Made England, New York, Little, Brown, and Co., 2006, p. 12.
Note : La devise du roi Édouard III, en français de l’époque, était Diev et mon droict. Elle sera réécrite Dieu et mon droit. En réalité, nous émettons cette hypothèse, on devrait lui préférer la formulation Dieu est mon droit. Le respect de la tradition, chère aux Britanniques, l’a empêché d’apporter ce correctif.
Armoiries du roi Édouard III de 1337
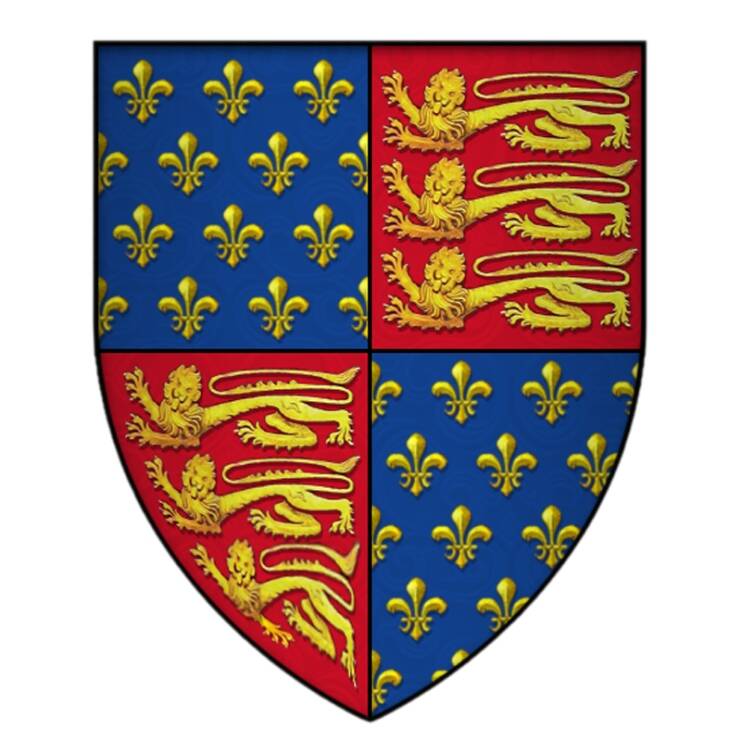
Armoiries du roi Charles III de 2024

Par. 592 Une littérature nationale a pris forme. Elle a trouvé ses lettres de noblesse avec Geoffroy Chaucer, l’auteur des Canterbury Tales (Contes de Cantorbéry), publiés en 1387, un ouvrage qui l’a fait connaître partout en Europe. La langue anglaise y est apparue métamorphosée, certainement si on la comparait à l’anglo-saxon d’avant la conquête de 1066. C’était désormais une langue métissée, le résultat d’une fusion progressive des apports anglo-saxons, normands et français en un parler spécifique. Ce nouvel anglais était devenue non seulement le véhicule d’une littérature naissante, mais également une langue de l’enseignement. En effet, depuis 1385, les professeurs de grammaire latine parlaient maintenant l’anglais lorsqu’ils se trouvaient en classe, d’après John Trevisa. Assurément, le français avait toujours sa place à l’université et dans les écoles de droit, mais l’anglais y était devenu une langue acceptable et qui sera de plus en plus acceptée dans le monde des études.
TREVISA, préc. au par. 588, pp. 148-149; J. BOWEN, A History of Western Education, vol. 1, New York, Routledge, 1972, p. 312; R. WALDRON, « John Trevisa and the Use of English », (1988) vol. LXXIV Proceedings of the British Academy 171, p. 172.
Par. 593 Sa mère étant morte avant qu’il n’ait fêté son second anniversaire de naissance, le futur Henri IV (règne 1399-1413), fils du duc de Lancastre Jean de Gand, a grandi sous la garde de sa grand-tante, la duchesse Blanche Lady Wake, puis de Katherine Swynford, la gouvernante, maîtresse et troisième épouse du duc. Beau-frère du célèbre écrivain Geoffroy Chaucer, Jean de Gand se révéla être un formidable mécène, protecteur des arts et des lettres et lui-même un artiste, au point de demander à Blanche et à Katherine que son fils soit élevé dans un environnement privilégiant la culture autochtone, et devienne ainsi le premier membre de la famille royale de langue maternelle anglaise. Henri, devenu adulte, était et se sentait donc comme un véritable anglais. Il continuera apparemment d’encourager la production d’œuvres littéraires dans la langue du pays. Son père ne l’aurait pas désavoué à cet égard. Histoire d’être bien compris, et d’annoncer clairement ses intentions dès le départ, il s’était adressé à son auditoire en anglais le jour de son intronisation, le 13 octobre 1399. Cela, croyait-il sûrement, lui permettrait d’être mieux accepté comme nouveau souverain, tant par le Parlement que par le peuple, au lieu d’être accusé d’avoir volé son trône à son prédécesseur Richard II (règne 1377-1399) à la suite d'un coup d'État.
ORMROD, préc. au par. 582, p. 784; C. BARBER, The English Language; A Historical Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 143; W.A. KRETZSCHMAR Jr., The Emergence and Development of English; An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 100; J.H. FISHER, « A Language Policy for Lancastrian England », (1992) vol. 107 Publications of the Modern Language Association (PMLA) 1168, p. 1170.
Par. 594 On ne parlait plus que l’anglais à la Cour lors du règne de son fils Henri V (règne 1413-1422). Lui-aussi inspiré par ses prédécesseurs immédiats, Henri V a encouragé la production d’œuvres littéraires en anglais. Certes, par respect de la tradition, le jeune roi a continué d’employer le français ou le latin dans sa correspondance en début de règne, mais il est passé définitivement à l’anglais lors de la reprise de la guerre avec la France en juillet 1417. Il en faudra peu, à partir de là, pour que le gouvernement opère désormais presque tout le temps dans la langue des autochtones.
ORMROD, id., p. 752, 775, 786; DODD, préc. au par. 582, p. 117 et 124.
Par. 595 Sauf comme un reliquat de son ancienne gloire dont on verra les traces sur les armoiries du roi, lors des plaidoiries et dans les décisions des cours de justice, et pour quelques années encore dans la rédaction des statuts du Parlement, l’histoire du français en Angleterre s’est arrêtée avec la signature du Traité de Picquigny, le 29 août 1475, qui a clos pour de bon la guerre de Cent Ans.
Par. 596 L’Angleterre et la France étaient devenues deux nations distinctes conscientes de leur identité respective. Ni l’une, ni l’autre, n’a plus toléré d’être soumise à l’autorité d’un souverain étranger.
Timbre poste français commémorant la signature du Traité de Picquigny de 1475

10. Constitution anglaise après la Grande Charte
10.1 Succession : statut ambigu de la Loi salique en Angleterre
Par. 597 L’ordre de succession ne semblait plus faire de doute parmi les contemporains d’Édouard III, car une longue lignée de rois qui se sont succédé depuis Jean sans Terre paraissait avoir consacré la coutume de primogéniture, d'après laquelle le premier-né de la branche aînée de la famille royale héritait de la Couronne.
Par. 598 Cette coutume, qui garantissait le droit d’hériter de la Couronne par l’ordre de naissance, a été implicitement reconnue en Angleterre à partir du règne d’Édouard Ier (règne 1272-1307). Avant lui, la paix du roi, cette principale source du droit criminel anglais, mourait en même temps que l’occupant du trône, jusqu’à ce que le prochain roi la fasse revivre par une déclaration lors de son couronnement. Entre-temps, l’anarchie s’installait. Un homme ayant commis une infraction du vivant du roi, mais qui passait en justice après sa mort, se trouvait ainsi libéré de toute charge. La situation est devenue intolérable après le décès d’Henri III, le 16 novembre 1272, parce que son fils et successeur, Édouard Ier, se trouvait le même jour en Palestine pour participer à la Croisade. Les grands du royaume, craignant des désordres prolongés, ont alors cru nécessaire d’émettre une proclamation de paix en son nom. Leur acte a transformé le concept de paix du roi : celle-ci a cessé d’être considérée comme la propriété personnelle du souverain pour devenir un attribut de l’État anglais, représenté ici par la notion abstraite de Couronne. La paix du roi et la protection qu’elle conférait a ainsi évoluée en une paix publique qui n’avait plus de commencement ni de fin.
Order for the Proclamation of the King’s Peace, A.D. 1272, dans STUBBS et DAVIS, préc au par. 451, pp. 438-439. Lire aussi F. POLLOCK, « The King’s Peace in the Middle Ages », (1899) vol. 13 Harvard Law Review 177, pp. 184-185, ainsi que nos paragraphes 105 à 108, 260, 306 et 448-449.
Par. 599 La manière dont la succession s’opérait a également subi une profonde mutation. À partir du moment où c’était l’hérédité qui seule déterminait le droit de succéder, la cérémonie de couronnement devenait une simple formalité et non une condition de la naissance d’un règne. C’était le constat posé par les hauts barons et prélats composant le Conseil du roi dans leur proclamation du 20 novembre : « [traduction] le gouvernement du royaume nous a été transmis par succession héréditaire », ont-ils écrit au nom de leur seigneur. Édouard Ier a conséquemment daté le début de son règne en 1272, l’année du décès de son père, et non pas 1274, l’année de son retour de croisade et de son couronnement. Aucun statut ni décret n’a été adopté. On a reconnu de facto la règle selon laquelle le droit de succéder au trône s’acquérait à la naissance. À la mort d’Édouard Ier, son fils Édouard II est devenu roi à son tour, sans que son droit ne soit jamais questionné. Il n’y avait plus d’interrègne. Ou comme le dira l’adage français, probablement employée une première fois le 11 novembre 1422 à l’occasion de la cérémonie funéraire de Charles VI : « Le roi est mort ! vive le roi ! » (The king is dead ! Long live the king !).
Order for the Proclamation of the King’s Peace, A.D. 1272, id., p. 439; R.E. GIESEY, The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève, Librairie E. Droz, 1960, pp. 125-132, où l'auteur a rédigé une analyse détaillée des évènements et des contradictions des les récits des chroniqueurs de l'époque.
Par. 600 Édouard Ier n’a pas douté un seul instant que sa Cour, les hauts barons et les prélats reconnaîtraient le droit de son fils et prince de Galles Édouard Plantanegêt. Il craignait par contre qu’ils n’en feraient pas autant pour ses filles, advenant la mort prématurée de leur frère. Le 17 avril 1290 à Amesbury dans le Wiltshire, 13 jours avant le mariage de sa seconde fille Jeanne avec Gilbert de Clare, comte de Gloucester, Édouard a demandé à son futur beau-fils de jurer sur les Saints Évangiles qu’il respecterait le droit de ses filles. S’il arrivait malheur au jeune prince de Galles, le roi a stipulé que la Couronne passerait à sa fille aînée Éléonor et à ses enfants, et que si celle-ci ne lui survivait pas et n’avait pas d’héritier, ce serait seconde fille Jeanne et ses enfants qui ceindraient la Couronne. Édouard Ier reconnaissait ainsi une première fois le droit des femmes d’hériter du trône d’Angleterre.
Concernant les filles du roi Édouard, Gilbert a juré dans le français de cette époque : « Ke nostre Seygnur le Rey voyt è ordeyne ke, si Sire Edward, sun fitz, ou autre fitz, ke il avera, motgent sauns Heyr de lur cors engendre; Dunk apres la mort le Rey avauntdit, le Reaume d’Engleterre, e la Tere de Irlaunde demurge a Dame Alianor, sa filie eyne, è as Heyrs de sun cors engendrez, E, si meymes cele Dame Alinor murge saunz eyr de sun cors engendre; dunkes le Reaume, e la tere avauntdite demurgent a Dame Johan, filie le Rey avauntdyt, è as Heyrs de sun cors engendrez. » De Succession ad Coronam Anglie, Gilberti Comitis Gloucestrie Jur amentum, 17 avril 1290, dans T. RYMER, Foedera, Tome 1, 3e édition (Hagae Comitis), Neaulme, 1739, pp. 75-76.
Par. 601 Vers la fin de 1376 ou au début de 1377, Édouard III, à la demande des députés des communes du Bon Parlement, a adopté une charte dont l’objet était également d’empêcher tout litige concernant sa succession. Son fils aîné le Prince Noir étant décédé, il a désigné comme héritier l’enfant du prince, son petit-fils Richard. Le vœu d’Édouard et des communes a été exaucé puisque Richard II (règne 1377-1399) a ceint la Couronne. Cela ne coulait pas de source. En effet, la succession par représentation, où le petit-fils devient roi après son grand-père comme si son père avait régné, n’avait pas encore été testée. La charte d’Édouard III aura eu au moins l’utilité d’assurer une succession sans heurt.
Demand for the recognition of Richard of Bordeaux as heir apparent, E.H.D., vol. 4 (1327-1485), éd. 1969, p. 122; Charte de 1376-1377 rédigée dans le français de l’époque, British Library, Cotton Charter XVI.63, dont les extraits pertinents ont été reproduits par M. BENNETT, « Edward III’s Entail and the Succession to the Crown, 1376-1471 », (1998) vol. 113 The English Historical Review 580, pp. 582-583.
Par. 602 Cela dit et fait, le roi Édouard III ne s’est pas contenté de désigner son petit-fils. Dans l’hypothèse où Richard mourrait sans descendance, Édouard a énuméré tous ceux qui devaient le suivre dans l’ordre de succession. Seuls les fils qui avaient eux-mêmes hérité de leur père étaient mentionnés. Les femmes et leurs enfants se trouvaient écartés, ce qui signifie que le droit à la Couronne devrait suivre obligatoirement une lignée masculine. Édouard III s’appropriait donc la règle française, l’équivalent de la Loi salique, qu’il avait pourtant rejetée en début de règne pour réclamer la Couronne de France. Et s’il n’y avait que cela, mais le roi contredisait également la position défendue par son grand-père Édouard Ier qui souhaitait préserver le droit des femmes. Comment l’expliquer ?
Par. 603 Rappelons que Jean de Gand, duc de Lancastre et troisième fils d’Édouard III, dominait à ce moment le Conseil du roi. Son opinion aurait pesé lourdement lors de la rédaction de la charte successorale, à moins qu’il n’ait tout simplement trempé sa plume pour la rédiger lui-même. Puisque Lionel, duc de Clarence et second fils d’Édouard III, était mort en ne laissant qu’une fille, Philippa, désormais écartée de la succession, Jean de Gand devenait l’héritier présomptif si le petit Richard décédait prématurément. L’ambition de Jean de Gand pourrait donc expliquer la volte-face de son père. Et pourtant, son histoire démontre que Jean n’était pas dévoré par l’ambition. Il s’est effectivement montré d’une fidélité sans faille envers son neveu le roi Richard II. Une autre explication, toute aussi convaincante, serait cette fois que la charte d’Édouard III reflétait l’opinion personnelle du roi. Réclamer la Couronne de France n’aurait donc été pour lui qu’un prétexte lui permettant de négocier un arrangement favorable avec ses ennemis du continent, plutôt que le résultat de son interprétation de la coutume en matière de succession.
Par. 604 En tout état de cause, que peut-on dire de la légalité de la charte d’Édouard III ? Est-ce que le roi pouvait, de sa seule autorité, modifier ainsi la coutume ou fallait-il une loi du Parlement ? C’est pourtant ce même Édouard qui avait promis le jour de son couronnement de respecter les lois que le peuple se choisirait, y compris le statut de 1350 qui enchassera plus tard la coutume de primogéniture. Or, le statut ne distinguait pas du tout entre le droit des femmes et le droit des hommes à la Couronne. Il mentionnait seulement le droit des enfants, sans en dire plus. Ses extraits pertinents, dans sa version originale française, se lisaient : « les enfantz des Rois Dengleterre, queu part qils soient neez en Engleterre ou aillo’s, sont ables & deivent porter heritage, apres la mort lour auncests; la quele lei nre Seign’ le Roi, les ditz Prelatz, Countz, Barons, & auts g’ntz, & tote la Coe assemblez el dit plement, approevent & afferment p’ touz jours ».
Status of Children Born Abroad Act de 1350, préc. au par. 558, Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, p. 310.
Par. 605 La coutume de primogéniture avait donc acquis la force d’un statut du Parlement, à une époque où plusieurs doutaient déjà du pouvoir du roi de modifier seul quelque statut que ce soit. Peter de la Mare, le premier orateur de la Chambre des communes était l’un d’eux. Il a déclaré à ce propos lors du Bon Parlement de 1376 que ce qui avait été fait par un statut du Parlement ne pouvait être défait que par un autre statut du Parlement : « (…) ceo qest fait en parlement par estatute ne serra poynt defait saunz parlement ». Si la coutume de primogéniture garantissait le droit de femmes d’hériter de la Couronne et de la transmettre à leurs enfants, comme l’ont d’ailleurs affirmé Édouard Ier et aussi Édouard III en début de règne, ce dernier ne saurait la modifier sans la collaboration du Parlement. Voilà qui jetait au moins un doute sur l’effet de sa charte et sur l’état du droit des successions. Heureusement, Richard II ayant régné pendant 22 ans, la charte de son père Édouard III est tombée dans l’oubli.
V.H. GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle 1333 to 1381, Manchester, The University Press, 1927, p. 86.
10.2 Portrait d’ensemble des pouvoirs du roi : amorce de décentralisation.
Par. 606 La lettre sinon l’esprit de la Magna Carta concédée par Jean sans Terre a influencé l’évolution du droit constitutionnel lors des règnes de ses successeurs immédiats. Car l’un après l’autre, Henri III, Édouard Ier, Édouard II, Édouard III et Richard II, sur une période de plus de 183 ans, ont confirmé la charte du roi Jean dans sa version de 1225 et promis de gouverner selon les principes qui la sous-tendent.
Par. 607 Pendant le règne de ces Plantagenêts, le roi est demeuré le seul représentant du royaume, de l’État anglais naissant. Il possédait toujours les principaux pouvoirs associés à la puissance publique : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qu’il exerçait au sein de plusieurs institutions distinctes. Toutefois, quoiqu’il ait conservé la haute main sur son gouvernement, le contrôle de la législation et de la justice commençait à lui échapper. Est apparue une séparation de fait dans l’exercice de ces pouvoirs. Le Parlement, une émanation de la formation plénière de la Cour du roi à laquelle des représentants de la petite noblesse et des bourgeois s’étaient ajoutés, a réclamé le droit exclusif de légiférer lorsqu’il fallait lever de nouveaux impôts ou taxes. Il s’est en outre arrogé le pouvoir de mettre en accusation, par les communes, et de juger, par les lords, des ministres de la Couronne. Quant aux juges royaux de la Cour de l’Échiquier, de la Cour des plaids communs et de la plus récente Cour du banc du Roi, ils se sont graduellement distancés de leurs géniteurs, ces rois qui les avaient mis en place, en travaillant de plus en plus de manière autonome.
Par. 608 Certes, aucun juge n’aurait prétendu exercer quelque pouvoir indépendant de son maître. L’évolution récente allait plutôt dans le sens contraire, certainement si l’on en croît les plus grands jurisconsultes de l’époque. Henri de Bracton, qui a rédigé son œuvre sous le règne d’Henri III (1219-1272), donc aux débuts de la common law, a défendu la thèse voulant que le roi soit la source de toute justice (fountain of justice) dans son royaume. Tout pouvoir de juger découlait par conséquent d’une délégation du souverain. Conformément à la nouvelle doctrine, Henri III et à sa suite Édouard Ier ont exigé de tous ceux qui prétendaient exercer quelque autorité judiciaire de prouver leur droit, soit par la présentation d’une charte royale, soit en démontrant l’exercice de ce droit sur une longue période, un moyen indirect d’établir la délégation, a ajouté Bracton. Or, un pouvoir délégué, par nature, peut être révoqué en tout temps. Il aurait suffi que le roi exerce pleinement sa juridiction pour écarter tous les autres tribunaux. La plupart des Anglais n’y voyaient pas grand mal, à la condition que la justice royale continue de s’affranchir des interventions inopportunes de l’occupant temporaire du trône. Cela viendra, en temps utile.
BRACTON, préc. au par. 428, tome 2, pp. 166-167.
Par. 609 L’idée que le roi était soumis aux lois de son royaume et qu’il devait gouverner en conséquence commençait à prendre forme, tout comme le sentiment que ses sujets possédaient également des droits. La Magna Carta n’en était que la première expression publique et solennelle. Avec un regard rétrospectif, il est possible d’y voir l’annonce du principe de la primauté ou du règne du droit, ce qui sera appelé en langue anglaise la rule of law.
BRACTON, id., pp. 33 et 305-306.
10.3 Exercice du pouvoir exécutif : apparition du Conseil du roi
Par. 610 Le Conseil du roi, ou Consilium regis en latin, a été l’organe principal du gouvernement de l’Angleterre à partir du XIIIe siècle. C’était ni plus ni moins qu’une formation réduite de la Cour du roi, le conseil restreint déjà évoqué au paragraphe 483. Bien que présent sous les rois de la maison de Normandie, il deviendra cette fois une institution permanente, un statut qu’il n’avait certainement pas avant l’avènement d’Henri III en 1219. Le juriste William Stubbs a écrit à ce propos : « [Traduction] C’est à partir de ce moment que nous pouvons observer distinctement les actions d’un conseil restreint (inner council), distinct de la Curia regis en existence sous Henri II, aussi bien que du Conseil commun du royaume ». D’autres auteurs ont été plus prudents dans leur conclusion en mentionnant qu’il s’agissait plutôt d’un pas important dans le développement d’une nouvelle institution appelée le Consilium ordinarium (le Conseil ordinaire). Mais peu importe le moment précis, certainement au plus tard à la fin du règne d’Henri III en 1272, les conseillers personnels du roi siégeront bientôt officiellement au sein d’un organisme enfin reconnu et légalement constitué. Il apparaîtra sous différents noms à différents moments dans les archives : Regale consilium (Conseil royal), Familiare consilium (Conseil familial), Supremum ou supernum consilium (Conseil suprême), Nobile consilium (Conseil noble), Prudens consilium (Conseil prudent), Secretum consilium (Conseil secret), et ainsi de suite.
STUBBS,vol. 2, préc. au par. 497, pp. 40-41; TOUT, préc. au par. 591, p. 29; J.F. BALDWIN, The King’s Council in England During the Middle Ages, Oxford, Clarendon Press, 1913, pp. 16-21 et 36.
Par. 611 Lors des séances de ce Conseil du roi, les participants échangeaient des informations, se consultaient les uns les autres, prenaient même des décisions, mais il revenait Parlement, à la Chancellerie, à l’Échiquier ou autres tribunaux de veiller à leur application. En effet, le Conseil du roi, en son nom propre, ne jouissait normalement d’aucun pouvoir autonome qui lui aurait permis de mettre en œuvre ses politiques. Il n’était donc pas un véritable gouvernement au sens moderne de ce terme. Son autorité reposait exclusivement sur la confiance que le roi avait placé en ses ministres pris individuellement et sur la mesure d’autonomie qu’il était prêt à leur reconnaître. Ce principe connaissait cependant des exceptions, de fort nombreuses exceptions : lorsque le roi n’était pas en âge de gouverner, qu’il était frappé par la maladie, qu’il devenait usé par l’âge ou qu’il se rendait à l’étranger, le Conseil du roi opérait le plus souvent comme un véritable gouvernement, le centre du pouvoir où se prenaient toutes les décisions concernant la gestion des affaires publiques. Et c’est sans compter tous ces autres moments, pensons aux nombreuses luttes pour le pouvoir, où le roi perdait la liberté de choisir librement ses ministres en raison de la conjoncture. L’autorité réelle se déplaçait alors vers le Conseil et les plus illustres seigneurs du pays.
Baldwin, id., pp. 16-21, 29, 35-36 et 41-68.
Par. 612 L’avènement d’Henri III apparaît donc comme un moment clé dans l’apparition d’un nouvel organisme au sommet de l’État. La raison, qui s’imposait d’évidence, était la minorité du jeune roi. Voilà pourquoi un conseil regroupant ses ministres a commencé à se réunir régulièrement pour s’occuper des affaires du royaume. Ce sont notamment les membres du Conseil qui ont apposé leur sceau sur le Traité de Lambeth de 1217 négocié avec le dauphin Louis de France. Et ils se sont également portés caution pour un emprunt de 6 000 marks en 1218. Tant qu’a duré la minorité du roi, donc jusqu’en 1227, leur sanction s’est révélée indispensable pour tout acte d’importance engageant la responsabilité de l'Angleterre.
Baldwin, id., pp. 18.
Par. 613 Certes, une fois devenu majeur, Henri III a pu enfin s’assurer la direction de son gouvernement et choisir les officiers de son Conseil comme il l’entendait. Nommer ou congédier un ministre se faisait sans formalité. La discrétion du roi était en principe absolue, bien que, répétons-le, les aléas politiques du moment aient pu lui forcer la main. C’est ce qui s’est produit en 1237, lorsqu’Henri a rappelé au Conseil plusieurs conseillers impopulaires, considérés comme des étrangers parce que français (poitevins en réalité), provoquant de la sorte la colère des hauts barons et des prélats réunis en Parlement. Craignant leur réaction, et celle du peuple, le roi a préféré reculer en congédiant ses ministres. Le Parlement a immédiatement réagi en lui en imposant 12 autres. Tous ont prêté serment de conseiller fidèlement le roi. Celui-ci a juré en retour de suivre leurs conseils. C’était la première fois que des conseillers de la Couronne étaient formellement nommés et assermentés.
Dans une version de ses chroniques rédigées en latin, Matthieu Paris rapporte ainsi les propos d’Henri III à ses nouveaux conseillers : « [Traduction] Le roi leur fit jurer de ne jamais s’écarter du droit chemin, ni par des présents ni d’aucune autre manière, mais de prodiguer au roi lui-même des conseils judicieux et salutaires pour le royaume (…) » R. de WENDOVER (éd.), Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora, vol. 3, Londres, Longman, 1872, p. 383. Lire également BALDWIN, id., p. 27.
Par. 614 Cependant, une fois le Parlement dissout, soit après quelques semaines, plus rien n’a empêché le roi de remplacer ces nouveaux conseillers par ses favoris, ce qu’il s’est empressé de faire, jusqu’à ce que de nouvelles crises l’oblige à nouveau au compromis, d’abord en 1257-1258, puis à nouveau en 1265, en raison des actions de Simon de Montfort et de ses soutiens parmi les barons, dont nous avons déjà raconté les exploits aux paragraphes 486 et suivants.
Par. 615 En 1257, le clergé du royaume, réuni à l’initiative de l’archevêque Boniface, a contribué à la réflexion sur le besoin d’une réforme du gouvernement, comme les barons le ferons après en obligeant le roi à ratifier les Provisions d’Oxford l’année suivante. Les efforts des prélats ont notamment porté sur la rédaction d’un serment que tous les membres du Conseil du roi ainsi que ses juges devraient prononcer. Ce texte a été conservé dans les archives. On le doit aux Annales de Burton, une chronique rédigée et mise à jour par les moines de cette abbaye entre 1004 et 1263. Le brouillon des prélats sur l'exigence du serment a d'ailleurs servi lors de la composition d'un nouveau Conseil du roi en 1258. Considérant l’importance du document, voici un résumé le plus fidèle possible des principales dispositions :
- Les membres du Conseil doivent d’abord jurer de conseiller fidèlement le roi chaque fois qu’ils croiraient cela bénéfique.
- Ils doivent également jurer de ne pas révéler les conseils donnés au Roi s’ils estiment que cela pourrait causer un tort.
- De même, ils ne doivent pas aliéner quoi que ce soit qui relève de l’ancien domaine de la Couronne.
- De même, ils veilleront à ce que justice soit rendue à tous, riches et pauvres, grands et petits, selon les coutumes et les lois du royaume.
- Ils s’engagent également à ce que justice soit rendue librement à quiconque la demande, pour eux-mêmes, leurs amis et leurs proches. Ils s’opposeront à ce que la justice soit rendue par prière, par l’argent, par la faveur ou par la haine, mais veilleront de bonne foi à ce que les grands comme les petits soient jugés selon la loi et la coutume du royaume. Ils ne soutiendront ni ne défendront ceux qui commettent l’injustice, en actes ou en paroles.
- De plus, ils accepteront de toute personne dont ils savent qu’elle a des affaires à la Cour du roi ou à celle de ses baillis, tout don ou service, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, de quelque manière ou par quelque procédé que ce soit, en une telle occasion.
- De même, si un membre du Conseil sait avec certitude, ou qu’il a entendu dire de personnes dignes de confiance, qu’un autre conseiller a reçu un présent ou un cadeau, autres que de la nourriture ou des boissons, il devra en informer l’ensemble du Conseil. S’il est reconnu coupable de ce délit, il sera exclu définitivement du Conseil et perdra ses terres et ses revenus, ou le produit de la vente de ses biens, pendant un an. S’il n’a pas perçu de tels revenus, il sera puni d’une autre manière, à la discrétion des conseillers.
Pour en connaître le libellé exact dans sa version latine, lire les Annales de Burton dans H.R. LUARD (éd.), Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages, Londres, Longman, Robert and Green, 1864, aux pp. 395-397.
Par. 616 La composition et le fonctionnement du Conseil sont plus ou moins demeurés sous le contrôle du Parlement, des hauts barons et de Simon de Montfort, à l’exception de la période allant de 1260 à 1263, car le pouvoir alterna entre les deux factions pendant ces années. Simon, un soldat rude et compétent, ce qu'il avait prouvé maintes fois, s'est repris et a rétabli son autorité en remportant la victoire contre les forces royales à la bataille de Lewes en 1264. Ses soutiens étaient toutefois de plus en plus fragiles. Il succombera en août 1265 lors d'une autre bataille menée par le fils du roi, le futur Édouard Ier, à Evesham.
Par. 617 Après la défaite et la mort de Montfort à la bataille d’Evesham, et la capitulation des forces rebelles l’année suivante, l’ordre naturel a été restauré : le roi a repris la maîtrise de son Conseil, bien que cette fois avec la collaboration des hauts barons, ses conseillers naturels. Les anciens favoris d’origine française, ou plus précisément du Poitou, les Lusignan, honnis par le peuple et ses élites, avaient été écartés.
Voir supra au par. 488. On peut également lire de H.R. RIDGEWAY, « Foreign Favorites and Henry III’s Problems of Patronage », (1989) vol. 104 The English Historical Review 590.
Par. 615 Henri III n’a plus été ennuyé. Il a dirigé les affaires de l’État et son Conseil tant qu’il en a eu la force. Lui-même a mentionné, à propos de la contribution de ses ministres, que « [Traduction] certains nous assistent et suivent les Conseils desquels les affaires de notre royaume sont organisées » (quidam nobis assistentes, quorum consilio regni nostri negotia disponmitur). Mais le temps avait fait son œuvre. En effet, en 1271, donc vers la fin de son règne, la vieillesse d’Henri et l’éloignement de son héritier Édouard, lequel guerroyait en Terre Sainte, l’ont contraint à se reposer à nouveau sur son Conseil pour gouverner. Nous savons que ses membres, cette fois encore, ont prêté serment comme en 1237, 1257 et 1265. La différence, avec ces périodes de turbulence, était que le roi a choisi de poursuivre cette expérience, à laquelle il s’était d’abord soumis sous la contrainte.
BALDWIN, préc. au par. 610, pp. 34-36.
Par. 616 À la mort d’Henri III, le 16 novembre 1272, le Conseil du roi était devenu une véritable institution permanente composée de membres assermentés qui se réunissaient régulièrement. L’importance du serment, outre qu’il représentait une formalité pour y siéger, était de mieux définir les droits et les devoirs des nouveaux ministres : conseiller honnêtement le roi; garder le secret sur les délibérations du Conseil; ne pas aliéner les biens de la Couronne; recevoir les dons et services rendus à la Couronne; et refuser les pots de vin qui leur seraient offerts en échange de leurs services. Ce n'était pas des clauses de style qu’ils pouvaient commodément oublier, surtout à cette époque. Des ministres ont effectivement été accusés par les communes d’avoir violé leur serment, dont Michael de la Pole, ministre de Richard II en 1386, qui s’était porté acquéreur de propriétés du roi à vil prix. Ce même serment, ou tout au moins son équivalent, oblige toujours les ministres à conserver le secret sur tout sujet discuté au Cabinet, l’institution qui exerce aujourd’hui le pouvoir exécutif au nom de la Couronne.
Baldwin, id., pp. 35, 71, 125 et 127. Notons cependant que des membres informels du Conseil siégeaient souvent aux côtés des membres réguliers.
Par. 617 Avec la croissance de ses effectifs, l’administration gouvernementale a dû se fixer en un lieu précis. Ce fut à Westminster, là où se trouvaient déjà l’Échiquier, le Trésor et les cours royales de justice. L’Échiquier avait été déplacé de Winchester à Westminster dès les premières années du règne d’Henri II, donc peu après 1154. Le Trésor a suivi avant la mort de Jean en 1216. Tout ce qui concernait les finances de la Couronne a ainsi constitué le premier département ou ministère du gouvernement, avec son personnel et sa suite, régi par ses propres façons de faire. La séparation de l’Angleterre de la Normandie sous le règne de Jean a accéléré le mouvement. Ce fut au tour des cours royales de justice, née sous les règnes d’Henri II, de Richard, de Jean et de Henri III, d’acquérir une identité propre et distincte les unes des autres, une évolution commencée avec l’arrivée des Plantagenêts en 1154. La Chancellerie, composée d’un Secrétariat, ainsi que d’une seconde composante responsable de l’administration de la justice, s’est également sédentarisée à Westminster, mais beaucoup plus tard, car des forces s’exerçaient en sens contraire pour qu’elle suive le roi. Même le personnel de l’Échiquier accompagnait parfois le roi. Ce n’est qu’en 1338, au début de la guerre de Cent Ans, qu’Édouard III a ordonné, pour des raisons pratiques, de cesser tous ces déplacements. Le statut de Westminster comme centre administratif du royaume semblait désormais assuré. Ce fut la richesse du sud du pays et la proximité de la métropole Londres qui incita les rois à faire de Westminster leur première capitale.
TOUT, préc. au par. 286, vol. 3, pp. 254-261.
Carte 13
Emplacement de la cité de Westminster en relation avec la métropole Londres

Par. 618 Au temps d’Édouard Ier, d’Édouard II et d’Édouard III, le Conseil du roi était devenu une institution reconnue et acceptée par ces souverains comme faisant partie de de la routine gouvernementale. D’après un chroniqueur de l’époque, auteur des Modus tenendi Parliamentarum, les membres du Conseil étaient « [Traduction] le chancelier d’Angleterre, le trésorier, le chambellan, les barons de l’Échiquier, les justiciers (i.e. les juges royaux), ainsi que les clercs et les soldats du roi (i.e. les principaux secrétaires et chevaliers), ensemble avec les sergents du droit (i.e. les plaideurs devant les tribunaux) ». S’y ajoutaient des évêques, des comtes, des barons et toute autre personne que le roi jugeait bon de convoquer.
De Modo Parliamenti, dans T.D. HARDY (éd.), Modus tenendi Parliamentarum: An Ancient Treatise on the Mode of Holding the Parliament of England, Londres, G.E. Eyre and Spottiswoode, 1846, p. 27.
Par. 619 Malgré ce qui qui vient d’être dit et écrit, il est probable que tout ce monde ne faisait pas partie des membres permanents du Conseil. Ces derniers, les hommes auxquels le roi demandait de prêter serment, dont le chancelier et le trésorier, constituaient le noyau de ses ministres et ses plus proches collaborateurs. Cela expliquerait l’apparition de nouvelles expressions sous Édouard II (1307-1327) tels que Secretum consilium et Privatum consilium servant à désigner un Conseil du roi de taille plus modeste. Cela expliquerait également pourquoi les archives mentionnaient fréquemment « le chancelier, le trésorier, et autres personnes » pour désigner ses participants.
BALDWIN, préc. au par. 610, pp. 71-73.
Par. 620 Sous le règne des trois Édouard, de 1272 à 1377, le trésorier ou le chancelier dirigeait normalement les séances du Conseil, une indication claire de leur préséance sur les autres membres et la raison de leur mention dans les archives. Le roi avait d’ailleurs pris l’habitude de leur faire parvenir des lettres, sous son sceau privé (privy seal) et plus tard sous son signet (signet aussi en anglais), leur ordonnant de convoquer leurs collègues afin qu’ils s’occupent d’une ou plusieurs questions jugées importantes par le souverain.
BALDWIN, id., p. 73.
Par. 621 D’autres hommes, quoique moins à l’avant-scène que les trésorier et chancelier, s’assoyaient également à la table du Conseil du roi Édouard Ier. C’étaient les officiers de son palais, son personnel mi-domestique mi-politique du household parmi lesquels se trouvaient notamment le chambellan (chamberlain) (déjà mentionné par le chroniqueur cité plus haut), le sénéchal (steward) et le gardien de la garde-robe (keeper of the wardrobe). À en croire le traité de droit appelé Fleta, rédigé sous le règne d’Édouard Ier, eux-aussi prêtaient un serment qui les habilitaient à siéger au Conseil du roi. La participation au Conseil des officiers du palais était une caractéristique de tous les gouvernements du Moyen Âge, à cette époque où l’on ne distinguait pas vraiment entre les besoins personnels du monarque et les affaires de la nation.
Note : En effet, le traité de droit Fleta nous informe que : « [Traduction] La fonction de trésorier de la garde-robe (i.e. le gardien de la garde-robe) est de recevoir l’argent, les présents et les cadeaux reçus du Roi, de faire des dépenses raisonnables et de les acquitter à partir de ces biens, de tenir un rapport détaillé des dépenses et d’en rendre compte au trésor à chaque année, à la fête de Sainte Marguerite, sans avoir à accomplir le serment, car il est déjà assermenté par le Conseil du Roi, et à partir duquel celui-ci doit ensuite rendre compte séparément et publiquement de tous les reçus dans un seul registre. »
FLETA, Seu Commentarius Juris Anglicani sic Nuncupatus, sub Edwardo Rege Primo…, Londres, Typis S.R., Prostant apud H. Twyford, T. Basset, J. Place, & S. Keble, bibliopolas in vicis Fleetstreet & Holborn, 1685, livre 2, chap. 14, p. 78.
Par. 622 Au fur et à mesure que l’Administration publique grandissait, vers la fin du règne d’Édouard III, le secrétaire principal du roi et le gardien de son sceau privé ont gagné en importance. Le gardien du sceau privé est d’ailleurs devenu le troisième officier en importance, après le chancelier et le trésorier. Il lui arrivera même de présider les séances du Conseil en leur absence.
Par. 623 L’embonpoint menaçait sérieusement le Conseil du roi. Avec l’ajout des eschators, amiraux, juges, barons de l’Échiquier et clercs de la Chancellerie, ses effectifs ont grimpé au-delà de 30 ou 35 membres sous le règne d’Édouard III. Le Conseil s’était transformé progressivement en une bureaucratie composée de professionnels de la gestion. Pareille évolution, apparemment voulue par son grand-père Édouard Ier, a cependant créé des mécontents parmi les hauts barons. En 1326, lors de leur rébellion contre Édouard II, les hauts barons ont non seulement cherché à contrôler les nominations au Conseil, mais également à réduire le nombre total de conseillers. Il était prévu que son fils, le futur Édouard III, serait entouré d’un Conseil de 14 personnes, quatre prélats, quatre comtes et six barons, avec à leur tête Henri, 3e comte de Lancastre. Leur tentative ayant échoué, ils sont revenus à la charge à l’occasion du Bon Parlement de 1376, entre le 28 et avril et le 6 juillet. Les lords, auxquels se sont joints les députés des communes, y ont esquissé à grands traits une réforme du Conseil du roi. Celle-ci prévoyait un Conseil comprenant de 10 à 12 membres. Les ministres devaient occuper leur charge sans interruption. Toute affaire importante leur serait soumise et exigerait leur consentement, ce qui requérait la présence continue d’au moins quatre conseillers en un lieu précis. Toujours, tel que prescrit dans leur serment, ils promettaient d’être fidèles, discrets et d’une honnêtement irréprochable. Les conseillers ont été nommés. L’affaire semblait conclue. Mais ce Conseil continuel ne dura pas plus que trois mois. L’orateur des communes Peter de la Mare a été convoqué devant le tribunal de Sa Majesté et emprisonné. Un changement de personnel s’ensuivit au Conseil du roi. Et tout ce qui avait été accompli par la Bon Parlement a été anéanti.
FRYDE, préc. au par. 519, p. 207; BALDWIN, préc. au par. 610, pp. 118-119; STUBBS, vol. 2, préc. au par. 497, pp. 448-449, 452-453, 455 et 460; G. HOLMES, The Good Parliament, Oxford, Clarendon Press, 1975, pp. 158-160.
Par. 624 Malgré tout, l’expérience ne fut pas sans lendemain. Dès le décès d’Édouard III le 21 juin 1377, et que son fils Richard II a ceint la Couronne, Peter de la Mare a été libéré et les principaux acteurs du Bon Parlement ont été réhabilités. Des députés des communes ont rapidement rédigé une pétition adressée au jeune roi de dix ans. Celle-ci l’enjoignait de nommer des conseillers fidèles et irréprochables pour un mandat de deux ans, non renouvelable, afin d’éviter qu’une oligarchie ne monopolise l’exercice du pouvoir. Le lendemain de son couronnement, le 17 juillet suivant, on a annoncé le choix des membres de son Conseil conformément aux vœux énoncés par les députés. Les serments habituels des conseillers furent alors prêtés en présence de Richard. S’y trouvaient, en plus des chancelier et trésorier, deux évêques, deux comtes, deux bannerets et quatre bas chevaliers. Ils devaient tous recevoir un salaire. Trois jours plus tard, le roi a confirmé leur nomination par lettres patentes. Tant l'octroi d'un salaire que la nomination au moyen de lettres patentes représentaient des innovations qui seront retenues. Le Conseil du roi a par la suite exercé en son nom tous les pouvoirs de Richard durant le temps de sa minorité.
BALDWIN, id. pp. 120-121; STUBBS, id., pp. 461-463.
Note : C’est donc par lettres patentes émises au nom du souverain à son palais de Westminster et datée du 20 juillet 1377 que la nomination des nouveaux conseillers a été actée : « En tesmoignance de quele chose Nous avons fait faire cestes noz Lres Patentes a durer a nre volante. Don' a nre Paleys de West', le xx jour de Juyl ». Les lettres patentes (letters patent), expression employée au pluriel, étaient et sont encore un document public émis par le roi permettant de conférer un droit à une personne. Ce document de 1377 rédigé en ancien français a été reproduit dans GRANDE-BRETAGNE, PARLEMENT, Rotuli Parliamentorum; ut et Petiones, et Placita in Parliamento, Tempore Ricardi R. II, vol. 3, 1767, p. 386, sous l'entête Appendix.
Par. 625 Le choix des conseillers relevait toujours de la prérogative royale. Il incombait à Richard, après qu’il eut pris les rênes de son gouvernement en 1381, de déterminer la composition du Conseil. Des décisions malheureuses et des maladresses ont cependant ruiné la réputation de son gouvernement, ce qui entrainera une réaction attendue : les députés des communes, au moyen de la procédure d’impeachment, ont réussi à se débarrasser des conseillers impopulaires, une première fois en 1386 lors du Parlement Extraordinaire, une seconde fois en 1388 lors du Parlement Impitoyable. Ce dernier a même imposé au roi de nouveaux conseillers. Richard, après avoir annoncé qu’il était en âge de gouverner seul, les a immédiatement écartés, mais s’est montré mesuré dans le choix de ses nouveaux ministres. La paix régnait enfin. Pour cette raison, des taxes modérées ont été levées régulièrement, à un taux à peu près inchangé. Cette période de prospérité a duré quelque huit années au cours desquelles Richard a été un souverain populaire. Malheureusement, la paix ne s’est pas prolongée au-delà.
STUBBS, vol. 2, préc. au par. 497, pp. 506-509 et 515.
Par. 626 Le renouvellement des hostilités avec la France au début de 1397 a fait revivre les tensions entre le roi et sa noblesse, ainsi que les attaques des communes contre le gouvernement, voire contre le roi lui-même, bien que n’allant pas jusqu’à contester son droit de régner : « (…) les ditz suppliant, ou leurs successours, ou en ascune mane attemptount ou empugnout le title du Roi ». Ce dernier n’a pas apprécié, il va sans dire. Des arrestations ont eu lieu. Sa tentation d’exercer un pouvoir autoritaire devenait plus réelle et plus visible avec les semaines. Pendant le Parlement de septembre 1397, Richard est véritablement passé à l’action en déclarant son intention de rétablir ses droits dans leur intégralité, notamment par l’abrogation de toutes les mesures les ayant diminués. Les accusations et les procès se sont multipliées, parfois pour actes datant de dix ans passés, durant le Parlement Extraordinaire et le Parlement Impitoyable.
Rotuli Parliamentorum, vol. 3, préc. au par. 524, pp. 338-340, 348 et 408.
Note : En 1388, dans l’une de leurs pétitions, les députés des communes ont multiplié les reproches à l’égard des membres composant le Conseil du roi, parce qu’ils abusaient de la jeunesse du roi et le conseillaient mal, au mépris des seigneurs liges plus à même de gouverner : « (…) la tendresse de l’age de nre Sir le Roi, & la innocence de sa Roial persone, luy firent entendre come pur Verite tantz des fauces choses par eux contre loialte & bone foy ymaginez & controvez, et entierement eux lui firent de tout a eux doner son amour, & ferme foy & credence, & haier ses foialx Seigneurs liges, p queux il deust avoir este de droit plus governe. (…) Et ils ont mis le Roi pluis en servage, encontre son honour & Regalie, & encotre lour ligeance come Traitors. » En 1397, ils ont encore reproché au roi de ne pas écouter ses bons conseillers et de nommer à leur place des individus ni convenables pour le roi, ni pour le peuple : « nient covenables pur le Roi ne pur le poeple ». GRANDE-BRETAGNE, PARLEMENT, préc. au par 624, pp. 234, 235, 337, 338, 241 et 264.
Par. 626 Les lords et les communes se sont rendus compte à quel point il leur était difficile de constituer un gouvernement dont le roi ne voulait pas. Peu importe ce que faisait le Parlement, et l’identité des ministres qu’il cherchait à imposer, le roi pouvait leur ajouter d’autres conseillers qui lui permettait de les mettre en minorité, ou encore en prenant conseil auprès des seules personnes en qui il avait confiance, des ministres de l’ombre que leurs ennemis qualifiaient de faux conseillers (false concilliors) ou de conseillers maudits (evil concilliors). Malgré les efforts des parlementaires, Richard a donc réussi à conserver intact se prérogative de nommer les ministres de son choix. Le Parlement a su toutefois imposer sa discipline en cas de crise par l’emploi de la procédure d’impeachment ou par l’adoption d’un projet de loi d’attainder. S’il était incapable d’imposer les membres du Conseil du roi de son choix, le Parlement pouvait au moins écarter les ministres indésirables en les emprisonnant ou en ordonnant leur exil ou leur exécution. Un roi faible se révélait alors incapable de refuser sa sanction aux initiatives des parlementaires.
Voir supra les pars. 515, 555 et 568. Sur les origines de l’impeachment, lire PLUCKNETT, préc. au par. 515. Et pour une étude approfondie de l’attainder, lire W.R. STACY, The Bill of Attainder in English History, Thèse de doctorat, Histoire, University of Wisconsin, Madison, 1986.
Par. 627 Après la destitution ou l’abdication de Richard II et sa mort subséquente aux mains de son successeur Henri IV (règne 1399-1413), les rois de la famille de Lancastre ont continué de souffrir des attaques du Parlement, jusqu’au jour du 20 novembre 1459 où Henri VI a enfin compris qu’il lui fallait des alliés au sein des deux chambres, autant aux communes que parmi les lords. C’était à l’occasion de la tenue du Parlement de Coventry, surnommé le Parlement diabolique (diabolicum). Henri et ses proches ont donc encouragé l’élection aux communes des membres de la Maison royale (Household), de ses officiers, ainsi que de plusieurs ministres, quand ils n’étaient pas déjà des pairs du royaume siégeant avec les lords, afin d’y réduire l’influence de ses adversaires. Tous les moyens semblaient bons pour « arranger » les résultats, à commencer par la corruption, voire même en se passant d’élections tout court, comme ce fut le cas dans plusieurs shires en 1459. Les shérifs mandatés par le souverain veillaient alors à ce que les bons candidats remportent leur circonscription.
Note : Quelques années plus tôt, le 8 juin 1455, Élisabeth Talbot, la duchesse de Norfolk, avait écrit à ce propos à John Paston, nouvellement élu député pour le comté de Norfolk : « [Traduction] Et autant que cela soit nécessaire pour diverses raisons, il faudrait, à ce moment, que mon Seigneur (i.e. le roi) puisse compter au sein du Parlement sur des personnes qui le suivent et qui sont des serviteurs de sa maison … ». J. GAIRDNER (éd.), The Paston Letters, vol. 1 (Henry VI, 1422-1461), Édimbourg, John Grant, 1910, no. 244, pp. 337-338.
Voir aussi G.L. HASKINS, « Parliament in the Latter Middle Ages », (1947) vol. 52, The American Historical Review 667, p. 671; H.G. RICHARDSON, « The Commons and Medieval Politics », (1946) vol. 28 Transactions of the Royal Historical Society 21, pp. 41-42; et E.B. FRYDE, « Introduction », dans E.B. Fryde et E. Miller (éds.), Historical Studies of the English Parliament, vol. 2 (1399-1603), Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p. 10.
Par. 628 Moins de 30 ans après le Parlement de Coventry, Henri VII (règne 1485-1509), premier roi de la dynastie des Tudors, a même refusé d’élever à la pairie quelques-uns de ses conseillers les plus proches, et leur a plutôt demandé de se faire élire aux communes pour y agir en tant que porte-parole du gouvernement. Thornhagh Gurdon, antiquaire de profession et receveur général à la fin du XVIIe siècle, a écrit à ce propos : « [Traduction] Sous Henri VII et Henri VIII, les ministres d’État, les agents du revenu et autres courtisans trouvèrent un moyen de se faufiler à travers les (circonscriptions) des bourgs jusqu’à la Chambre des communes, pour s’y faire une place (…) ». La pratique se serait même intensifiée sous Henri VIII. D’après ce qu’il a été dit et écrit à l'époque, le Parlement de 1629 aurait été à ses ordres, « [Traduction] parce que la Chambre (des communes) se trouvait remplie de serviteurs du roi (the King’s servants) ». Une coutume parlementaire veut aujourd’hui que tous les ministres du gouvernement se trouvent un siège au Parlement, de préférence au sein de la Chambre des députés, sinon avec les lords. Toutefois, la raison n'est pas tant pas tant de s'assurer le contrôle du Parlement, mais plutôt de permettre aux ministres de répondre aux questions de l'opposition dans le cadre de la convention constitutionnelle du gouvernement responsable, une innovation datant du XIXe siècle.
T. GURDON, The History of the High Court of Parliament: Its Antiquity, Preheminence and Authority, and the History of Court Baron and Court Leet, vol. 2, Londres, R. Knaplock imprimeur, 1731, p. 355; W. COBBETT, Cobbett’s Parliamentary History of England, vol. 2, Londres, T.C. Hansard, 1808, p. 1269.
Par. 629 Nous avons vu que le roi et ses ministres employaient plusieurs sceaux dans l’exécution de leurs tâches administrative. Quelques explications expliqueront leur origine et leur raison d’être.
Par. 630 D’un usage remontant à la fin du Xe siècle en Europe de l’Ouest, un sceau représentait un cachet officiel où étaient gravés en creux l’effigie, les armes ou la devise d’un seigneur, et dont les empreintes apposées sur un morceau de cire permettaient d’authentifier ou de fermer de façon inviolable un document. Il faut savoir qu’un seigneur, à commencer par le roi d’Angleterre, n’écrivait pas ni ne signait de sa main les documents émis en son nom. Il laissait cette tâche à des clercs, le plus souvent des gens d’Église, et continuera de le faire au moins jusqu’à la fin du Moyen Âge. Le récipiendaire devait néanmoins s’assurer que l’identité de son auteur était bien son roi et qu’il convenait dès lors d’agir en conséquence. C’est de là que vient l’importance accordée au sceau du roi.
H. JENKINSON, « The Great Seal of England », (1953) Vol. 101 Journal of the Royal Society of Arts 550, pp. 551-552.
Par. 631 Trois sceaux royaux ont été utilisés en Angleterre : le signet, le sceau privé et le grand sceau (signet, privy seal et great seal of England). Le grand sceau du royaume était probablement le seul en usage pendant les règnes d'dopuard le Confesseur et de ses successeurs de la maison de Normandie, entre 1066 et 1154. Il était alors et restera après sous la garde de son chancelier. Plus tard, sous les Plantagenêts, donc à partir de 1154, le chancelier s’en servira pour authentifier les brefs et éventuellement les statuts du Parlement. Il va sans dire que le roi devait disposer du sceau à portée de main. Or, la Cour médiévale migrait constamment d’un endroit à un autre. Puisque le chancelier, depuis le XIIIe siècle, résidait désormais le plus souvent à Westminster au lieu de toujours se déplacer avec son maître, le roi devait disposer d’un autre sceau lui permettant de communiquer avec ses divers officiers et conseillers, incluant ceux demeurés à Westminster. Il a alors employé un nouveau sceau, d’abord appelé le secretum (la secrète), connu aujourd’hui comme le sceau privé, qui sera confié à un clerc de la suite du roi. Une série de décrets de 1311 l’ont identifié par son nouveau titre de Gardien du sceau privé (Keeper of the privy seal). Ses origines remonteraient au règne de Jean sans Terre (1199-1216). Lorsque ce secrétaire a été appelé à siéger au Conseil du roi dans les années 1350 et plus régulièrement à partir de 1376, et qu’il s’est trouvé lui aussi dans l’impossibilité d’accompagner le roi dans ses déplacements, un troisième sceau a été réservé à l’usage personnel du roi : le signet, apparu à la fin du règne d’Édouard III, autour de l’année 1367. Le roi Richard II a remis ce signet à son principal secrétaire au début de son règne en 1377.
JENKINSON, id., pp. 554-555. Lire également A. L. Brown, The Privy Seal in the Early Fifteenth Century, Thèse de doctorat, Université d’Oxford, 1955, ou encore S. SOBECKI, The Handwriting of Fifteenth-Century Privy Seal and Council Clercks, Thèse de doctorat, Université de Groningen, 2021, ainsi que J. OTWAY-RUTHVEN, The King’s Secretary & the Signet Office in the XVth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1939.
Grand sceau du roi Édouard le Confesseur (1042-1066)
Inscription: Sigillum Edwardi Anglorum Basilei
(Sceau du Basile Édouard, Roi d'Angleterre)
Note: Basilei ou Basile en français est un mot qui vient du grec Basileios qui signifie monarque, royal ou relatif au roi.

10.3 Exercice du pouvoir législatif : apparition du Parlement
Par. 632 La Magna Carta de 1215 concédée par Jean sans Terre, puis confirmée dans une version modifiée par ses successeurs Henri III, Édouard Ier, Édouard II, Édouard III et Richard II, a servi de fondement à la création d’un Parlement réunissant les archevêques, les évêques, les abbés, les comtes et les hauts barons du royaume, appelés lords spirituels et temporels, avec des représentants élus de la petite noblesse des comtés ruraux et des bourgeois des circonscriptions urbaines, appelés députés des communes ou chevaliers de comté (knights of the shire) dans le cas des comtés ruraux.
Par. 633 Étant l’institution qui a succédé à la formation plénière de la Cour du roi, la Curia regis, le Parlement, et plus précisément la Chambre des lords quand le Parlement s’est séparé en deux chambres à partir de 1341, s’est immédiatement affirmé comme la plus haute cour de justice du royaume. C’était sa principale activité car, avant l’arrivée des souverains de la maison des Tudors, en 1485, il n’était pas dans les mœurs du temps de légiférer. La Chambre des lords déclarait le droit plus souvent qu’elle ne faisait le droit, tout comme les rois d’autrefois lorsqu’ils adoptaient des chartes (le roi agissant seul), des assises (le roi agissant après consultation avec la noblesse) et des constitutions (le roi agissant après consultation avec le clergé). C’est pour décrire cette réalité que l’institution a été appelée en un autre temps la Haute cour du Parlement (High Court of Parliament). La première loi du Parlement naissant, tout au moins celle reproduite dans le livre Statuts du royaume, appelée les Provisions de Merton de 1235, déclarait d’ailleurs en préambule avoir été adoptée « in Curia Domini Regis » (à la Cour du seigneur Roi).
Provisiones de Merton, 1235, 20 Hen. 3, dans Statutes of the Realm, vol. 1, 1816, réimpression de 1963, p. 1.
Note : L’expression Haute cour du Parlement est devenue totalement désuète depuis le 1er octobre 2009, lorsque les lords du Parlement ont perdu leur compétence judiciaire en appel au profit de la nouvelle Cour suprême du Royaume-Uni. Sur l’histoire de la compétence judiciaire du Parlement depuis les origines de l’institution, lire C.H. McILWAIN, The High Court of Parliament and its Supremacy, An Historical Essay on the Boundaries Between Legislation and Adjudication in England, New Haven, Yale University Press, 1910, notamment aux pp. 109-110.
Par. 633 Voyons, en accéléré, les principales étapes de sa formation lors de la période étudiée, soit entre le début du règne d’Henri III en 1216, jusqu’à la fin de celui de Richard II en 1399, une évolution dont nous avons déjà esquissé les débuts aux paragraphes 482 à 485.
Par. 634 Le roi Jean sans Terre, quand il a réuni sa Cour le 15 novembre 1213, a demandé aux shérifs de veiller à ce que les shires délèguent des membres de la petite noblesse afin de traiter des affaires du royaumes, sans préciser la méthode devant être employée par les shérifs pour les choisir. Selon toutes les apparences, le roi connaissait déjà le principe de la représentation, soit le fait que des personnes puissent agir au nom d’un groupe plus large afin que leur action puisse les lier. Il est probable qu’il n’y ait pas eu d’élections, faute de temps entre l’émissions du bref ordonnant leur convocation et le moment de la rencontre. Toutefois, lors de l’assemblée de 1226 convoquée par Henri III, des élections ont été tenues dans chaque comté. Quatre chevaliers ont été élus par circonscription.
Summon to a Great Council (1213) et Writs for the Summoning of For Knights of the Shire (1226), dans STUBBS, préc. au par 451, pp. 281, 282 et 353.
Note : La convocation de 1213 était effectivement silencieuse sur le choix des chevaliers de chaque comté. Elle se lisait : « [Traduction du latin] LE ROI au vicomte (i.e. le shérif) d’Oxford. Nous vous ordonnons de faire venir à Oxford, armés, tous les soldats de votre bailli, dans les quinze jours suivant la Toussaint; mais avec les barons désarmés. Veuillez également faire venir quatre soldats (i.e. des chevaliers) discrets de votre comté, au même moment, pour nous parler des affaires de notre royaume. Fait à Wytten, le 7 novembre. Il en est de même pour tous les vicomtes. »
Par. 635 Quelques années plus tard, en 1236, Henri III a employé une première fois le terme Parlement dans un document officiel pour désigner la formation plénière de sa Cour : le Grand conseil du roi. Cela concernait l’ajournement de l’audition d’un procès qu’il fallait reporter à un prochain Parlement prévu pour janvier 1237. Vers 1290, le traité de droit Fleta avait adopté pour de bon la nouvelle appellation du Grand conseil : « [Traduit du latin] Car le Roi a raison d’être dans son Conseil, dans ses Parlements, devant les prélats, les comtes, les barons, les nobles et autres hommes d’expérience, où les doutes sur les jugements sont réglés, où de nouveaux recours sont établis pour de nouveaux préjudices, et où justice est rendue à chacun, selon ses mérites ».
Voir RICHARDSON et SAYLES, préc. au par. 482, pp. 747-749. Pour l’année 1290, lire De Differentiis Curiarum (Sur les différences entre les tribunaux), Liber Decundum, c. 2, dans FLETA, préc. au par. 621, p. 66.
Par. 636 Les modalités de la participation des chevaliers ont été précisées à l’occasion du Parlement de 1254. Ils y ont reçu le mandat d’agir à titre de représentants de tous et chacun dans leur comté respectif afin de déterminer le montant d’aide financière qu’il convenait d’accorder au roi. Si les prélats et hauts barons, ces pairs du royaume, étaient convoqués individuellement, qu’ils ne pouvaient donc que s’obliger personnellement, les élus liaient également, outre leur personne, tous les habitants de leur circonscription, d’où le nom de communes ayant servi à les désigner. Simon de Montfort a amélioré la représentativité de l’institution parlementaire, au moment de l’assemblée de 1265, en contraignant le roi à procéder à des élections dans « York, Lincoln et autres bourgs d’Angleterre », en plus des comtés ruraux. Non seulement la petite noblesse était-elle ainsi représentée, mais également la bourgeoisie. Deux chevaliers par comtés et deux bourgeois ou citoyens par agglomération urbaine ont conséquemment été choisis. Le déclenchement du scrutin s’est fait au moyen d'un bref adressé au shérif. Celui-ci jouait le rôle d'officier d'élections. Comme le Parlement ne commença sa session que le 26 avril, soit 70 jours après le déclenchement de la procédure, le délai était plus que suffisant pour l’organisation du scrutin. Encore aujourd’hui, le roi Charles III émet un bref lorsque, à la suggestion du Premier ministre, des élections sont tenues. Rappelons que le bref était et est encore un ordre concis du souverain rédigé dans la langue d’usage.
Writ of Summons for Two Knights of the Shire to Grant an Aid (1254) et Summons to the Parliament of 1265 (1264), STUBBS, préc. au par 451, pp. 365-366 et 403-404. Lire aussi J.R. MADDICOTT, « The Earliest Known Knights of the Shire : New Light on the Parliament of Aprils 1254 », (1990) vol. 18 Parliamentary History 109, pp. 109 et 114.
Note : Le bref de convocation des élections de 1254 démontrait l’importance grandissante des élus des comtés, bientôt appelés les communes, lorsqu’il s’agissait d’approuver la levée de nouveaux impôts. Ce même bref ne prévoyait rien concernant la qualité des personnes qui pouvaient voter et se présenter aux élections. D'après l'analyse des données faite par Maddicott, id., p. 125, il semble néanmoins que les élus ont été des hommes rompus aux tâches administratives, enracinés dans leur circonscription, mais qui connaissaient davantage que leur environnement immédiat.
Par. 637 Nous en savons peu sur l’organisation des élections des députés des communes ou sur l’approbation d’un projet de loi par le Parlement. Est-ce que la règle de la majorité relative ou absolue était respectée dès le commencement de l’institution ? On peut le croire. Différents indices semblent concluants. Dès 1115, ou dans les environs, donc bien avant la naissance du Parlement, le traité de loi Leges Henrici Primi nous apprenait que, tout au moins lors de la tenue d’un procès, la règle de la majorité prévalait : « [Traduction du latin] Mais si, au cours d’un procès, un désaccord survient entre les parties, donnant lieu à un différend, l’avis de la majorité prévaudra ». Plus tard, en 1215, à la signature de la Magna Carta par Jean sans Terre, les insurgés ont souhaité que la Commission de 25 barons chargée de la faire respecter décide également à la majorité : « Traduction du latin] En cas de désaccord entre les 25 barons sur quelque sujet relevant de leur compétence, la décision majoritaire de ceux qui sont présents devra être considérée comme ayant la même valeur que si elle avait été rendue par tous, peu importe si les barons étaient tous présents ou si certains de ceux qui ont été convoqués ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents ».
Leges Henrici Primi, 5,6, dans L.J. DOWNER (éd.), Leges Henrici Primi, Edited with Translation and Commentary, Oxford, Clarendon Press, 1972, p. 86; Magna Carta, version de 1215, art. 61, dont le texte est reproduit en Annexe.
Par. 638 Tout doute sera éventuellement levé sur le respect de la règle de la majorité, tant lors des votes au sein du Parlement que ceux tenus pour choisir les députés des communes. Mais cela prendra du temps. Les premières mentions de votes aux communes où une majorité des membres présents a été requise date de 1420. Et c’est seulement en 1429 qu’un statut du Parlement a reconnu pour la première fois que le gagnant d’une élection était le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix, « ceux qi ount le greindre nombre », pour citer le texte même dans sa version originale française.
M. McKISACK, The Parliamentary Representation of the Boroughs During the Middle Ages, Oxford, Oxford Univerisity Press, 1932, p. 142; Electors of Knights of the Shires shall have 40s. a Year Freehold, and be resident, 8 Hen. VI, c. 7, Statutes of the Realm, vol. 2, 1816, réimpression de 1963, p. 243. Lire également G. EDWARDS, « The Emergence of Majority Rule in English Parliamentary Elections », (1964) vol. 14 Transactions of the Royal Historical Society 175.
Par. 639 PPP
Textes de loi
MAGNA CARTA (1215)
(Notre traduction)
La Magna Carta a d’abord été rédigée en latin. Nous en avons fait une traduction en français moderne en nous aidant de plusieurs textes. L’un d’entre eux se trouve à la bibliothèque municipale de Rouen; il s’agit d’une première traduction en français contemporain qui date vraisemblablement de 1215. Nous avons également consulté plusieurs traductions en langue anglaise, notamment celles reproduites sur le site internet de la British Library et dans l’ouvrage de David Charles Douglas, English Historical Documents. Enfin, nous devons mentionner la traduction française récente réalisée par Claude J. Violette, déjà largement connue des historiens francophones. M. Huillard-Bréholles, qui a traduit en français la Grande chronique de Matthieu Paris, a aussi rédigé une excellente version française de la Magna Carta dans le tome 3 de la chronique, préc. au par. 404, pp. 7 à 22.
************
JEAN, par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, forestiers, shérifs, prévôts, ministres et à tous ses officiers et fidèles sujets, salutations.
Prenant Dieu à témoin, sachez que, pour le salut de notre âme et de celle de nos ancêtres et de leurs héritiers, pour l’honneur de Dieu et l’exaltation de la Sainte Église et pour la réforme de notre royaume, sur l’avis de nos vénérables pères Étienne, archevêque de Cantorbéry, primat de l’Église d’Angleterre et cardinal de la sainte Église romaine, Henri, archevêque de Dublin, Guillaume de Londres, Pierre de Winchester, Jocelin de Bath et Glastonbury, Hughes de Lincoln, Walter de Worcester, Guillaume de Coventry, Benoît de Rochester, évêques, maître Pandolphe, sous-diacre et membre du palais papal, frère Aimeric, maître de la chevalerie des Templiers en Angleterre, et les nobles hommes : Guillaume le Maréchal, comte de Pemproke, Guillaume, comte de Salisbury, Guillaume, comte Warren, Guillaume, comte d’Arundel, Alain de Galloway, connétable d’Écosse, Warin fils de Gérald, Pierre fils de d’Herbert, Hubert de Burgh, sénéchal du Poitou, Hugues de Neville, Mathieu fils d’Herbert, Thomas Basset, Alain Basset, Philippe d’Aubigny, Robert de Ropsley, Jean le Maréchal, Jean fils de Hugues, et autres loyaux sujets :
- En premier lieu, nous avons accordé à Dieu et l’avons confirmé par cette présente Charte, en notre nom et en celui de nos héritiers, à perpétuité, que l’Église d’Angleterre sera libre et qu’elle jouira de tous ses droits et libertés dans leur intégralité; et nous voulons qu’il soit constaté, que de notre propre volonté, avant même l’ouverture des hostilités entre nous et nos barons, nous avons concédé et confirmé par charte le droit considéré essentiel qu’est la liberté des élections au sein de l’Église d’Angleterre, acte qui a été ratifié par le pape Innocent III; nous respecterons ces libertés et souhaitons qu’elles soient de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. En notre nom et en celui de nos héritiers, nous avons également concédé à tous les hommes libres de notre royaume les libertés qui suivent, pour qu’eux et leurs descendants en jouissent à perpétuité.
- Si l’un de nos comtes ou de nos barons, ou aucun autre de nos tenanciers en chef qui doivent le service militaire, devait décéder, et qu’au moment de sa mort son héritier d’âge majeur doive le relief, il aura son héritage après le paiement du relief à l’ancien taux en vigueur, soit 100 livres pour une baronnie entière et au plus 100 shillings pour un fief de chevalerie, et quiconque possède moins devra payer moins, conformément à l’ancienne coutume aux fiefs.
- Toutefois, si l’héritier est d’âge mineur et encore sous tutelle, il aura son héritage au moment de son émancipation, sans avoir à payer le relief, ni aucune amende.
- Le baillistre des terres d’un héritier d’âge mineur ne prendra pour lui qu’une part raisonnable des fruits et des revenus provenant de ces terres, ceci sans détruire ni endommager les hommes ou les propriétés. Et si nous confions la garde des terres à un shérif, ou à quiconque devant nous rendre compte, et qu’il détruit ou endommage ce dont il a la charge, nous lui imposerons une amende à titre de compensation. La garde de ces terres sera alors confiée à deux hommes honnêtes et loyaux du même domaine qui répondront de leur gestion à nous ou à notre représentant.
- Aussi longtemps que le baillistre conserve la garde de telles terres, il fera l’entretien des maisons, parcs, réserves de chasse, étangs à poissons, moulins et autres propriétés sur ces terres, en se remboursant à partir des revenus qu’il en tire. Lorsque l’héritier deviendra majeur, il devra lui remettre la totalité de son domaine, tel qu’il l’a reçu, avec les charrues, leur équipage et les outils agricoles saisonniers, ainsi que les biens que la terre a pu raisonnablement produire.
- Il est possible de donner des héritiers en mariage, à la condition que ce ne soit pas à une personne de condition sociale inférieure. Pour s’en assurer, leurs parents consanguins seront avisés du mariage avant sa célébration.
- La veuve prendra possession de sa part de l’héritage, sans qu’il lui soit causer de difficulté, dès le décès de son mari. Elle n’aura rien à donner pour récupérer sa dot, le ménage, ou les biens qu’elle et son mari possédaient conjointement au jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari pendant 40 jours suivant sa mort, période au cours de laquelle la dot lui sera remise.
- Aucune veuve ne sera obligée de se remarier, aussi longtemps qu’elle voudra vivre sans mari. Toutefois, elle doit nous garantir de ne pas se marier sans d’abord obtenir notre consentement si elle possède des terres que nous avons concédées, ou encore sans le consentement de quelque autre seigneur dont elle serait la tenancière.
- Ni nous ni nos officiers ne saisirons aucune terre ou loyer à titre de paiement pour une dette, lorsque le débiteur possède suffisamment de biens pour couvrir le montant de sa dette. Les personnes qui se sont portées caution pour garantir cette dette ne seront pas saisies tant que le débiteur lui-même sera en mesure de la rembourser. Mais si le débiteur, parce qu’il n’en a plus les moyens, devient incapable de le faire, ses cautions devront payer la dette à sa place. Les cautions qui le souhaitent pourront alors prendre possession des terres et retenir les loyers du débiteur jusqu’à concurrence de ce qu’ils ont versé, à moins que le débiteur ne puisse démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations envers elles en les remboursant.
- Si une personne a emprunté une somme d’argent à des juifs et qu’elle meurt avant que la dette ne soit remboursée, son héritier ne paiera aucun intérêt tant qu’il sera d’âge mineur, peu importe l’identité de son seigneur. Si une telle dette nous devenait due, nous n’exigerions rien d’autre que le remboursement du montant original du prêt.
- Si un homme meurt alors qu’il doit de l’argent à des juifs, son épouse aura néanmoins droit à sa dot sans avoir à y puiser pour payer cette dette. Si l’homme avait des enfants d’âge mineur, leurs soins seront assurés d’une manière convenable et appropriée en tenant compte des biens laissés en héritage. La dette sera payée à même ce qui reste, après en avoir soustrait les services féodaux dus au seigneur. On acquittera de la même manière les dettes envers d’autres personnes que des juifs.
- Aucun écuage ou aide ne doit être levé dans notre royaume sans le consentement du Conseil commun de notre royaume, sauf si c’est pour le paiement de notre rançon, pour faire chevalier notre fils aîné, ou pour marier une seule fois notre fille aînée. L’aide exigée à ces occasions devra être raisonnable. Qu’il en soit de même pour l’aide devant être versée par la cité de Londres.
- Et la cité de Londres devra jouir de toutes ses anciennes libertés et libres coutumes aussi bien sur terre que sur mer. Par ailleurs, nous déclarons et confirmons que les cités, bourgs, villes et ports de mer devront également jouir de toutes leurs libertés et libres coutumes.
- Afin d’obtenir le consentement du Conseil commun de notre royaume à la levée d’une aide - à l’exception des trois cas susdits -, ou d’un écuage, nous ferons convoquer individuellement pas écrit nos archevêques, nos évêques, nos abbés, nos comtes et autres haut barons du royaume. De plus, au moins 40 jours avant la rencontre, nous demanderons à nos shérifs et baillis de convoquer nos autres tenanciers en chef pour qu’ils se réunissent à une date et à un lieu précis. Toutes les lettres de convocation préciseront les motifs de la rencontre. La convocation ainsi faite, les questions soulevées seront débattues au jour dit par ceux qui seront présents, malgré que tous ceux qui ont été sommés ne se soient pas présentés.
- Dorénavant, nous n’autoriserons personne à lever une aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour le paiement de sa rançon, pour faire chevalier son fils aîné, ou pour marier une seule fois sa fille aînée. Seule une aide raisonnable pourra être exigée en ces occasions.
- Aucun homme ne sera obligé de fournir plus de services qu’il n’en doit pour un fief de chevalier ou pour toute autre libre tenure.
- Les plaids ordinaires seront jugés non pas là où va notre cour mais en un lieu fixe.
- Les assises de novel disseisin, de mort d’ancêtre et de darrein presentment, ne seront tenues que dans les cours de comté (shire) où le litige a pris naissance et de la manière suivante : nous, ou si nous sommes hors du royaume notre grand justicier, enverrons deux juges quatre fois l’an dans chaque comté. Avec quatre chevaliers de comté (knights of the shire) choisis par le comté, ils tiendront les dites assises dans le comté au jour et au lieu prévus.
- Et si les assises ne seront toujours pas terminées au jour prévu pour ce comté, les chevaliers et les propriétaires libres devront rester en nombre suffisant pour compléter le travail entrepris, jusqu’à la fin de tous les procès.
- Un homme libre ayant commis un délit mineur se verra imposer une amende proportionnelle à l’importance de son délit. Il en sera également ainsi pour un délit majeur, mais sans aller jusqu’à le priver de son gagne-pain. De la même manière, un marchand pourra conserver sa marchandise et un agriculteur ses outils agricoles s’ils comparaissent devant notre cour. Aucune amende ne sera imposée sans le témoignage sous serment d’hommes honnêtes et justes du voisinage.
- Les comtes et les barons ne seront mis à l’amende que par leurs pairs et seulement suivant l’importance de leur délit.
- Une amende imposée à un clerc doit être déterminée en respectant les mêmes critères, mais sans qu’il soit tenu compte de la valeur de ses bénéfices ecclésiastiques.
- Aucune ville ni aucun homme ne seront forcés de construire des ponts franchissant une voie d’eau, à l’exception de ceux qui en ont l’obligation en vertu des coutumes.
- Aucun shérif, connétable, coroner ou autre de nos baillis ne pourront entendre les poursuites judiciaires qui doivent être entendues par nos juges.
- Tous les comtés, centaines, wapentake, et autres circonscriptions continueront de payer le même loyer, sans augmentation, les terres de notre domaine exceptées.
- Si l’un de nos tenanciers en chef pour un fief laïc décède, alors que notre shérif ou un officier de la Couronne devait lui présenter nos lettres patentes l’assignant à comparaître pour une dette envers la Couronne, notre shérif ou notre huissier pourra légalement faire l’inventaire et saisir tous les biens meubles se trouvant sur ce fief jusqu’à concurrence de sa dette, après qu’ils aient été évalués par d’honnêtes hommes. Ce qui reste sera ensuite remis aux exécuteurs pour l’exécution de son testament. Et si rien ne nous est dû, tous les biens meubles seront distribués conformément aux vœux du défunt, en conservant une part raisonnable pour son épouse et ses enfants.
- Si un homme libre meurt sans testament, ses biens meubles seront distribués par son plus proche parent et ses amis, sous la surveillance de l’Église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses créanciers.
- Aucun connétable ou officier de la Couronne ne prendra de qui que ce soit du grain ou d’autres biens meubles sans les payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui fasse volontairement crédit.
- Aucun connétable n’obligera un chevalier à payer en argent pour le service féodal de garde du château, s’il souhaite remplir son obligation en nature en assurant cette garde en personne, ou lorsqu’il a une bonne raison pour s’en excuser, s’il le fait faire par un autre homme ayant les qualités voulues. Un chevalier qui sert dans notre armée sera dispensé de la garde du château pendant le temps de son service.
- Aucun de nos shérifs ou baillis ou quelque autre personne ne prendra les chevaux ni les chariots d’un homme libre à des fins de transport, sans la permission du propriétaire.
- Ni nous, ni nos baillis, ne prendront le bois d’autrui pour nos châteaux ou pour satisfaire quelque autre besoin sans la permission de celui à qui le bois appartient.
- Nous ne garderons pas plus d’un an et un jour les terres de ceux qui ont été condamné pour une félonie, période après laquelle elles seront remises en possession du seigneur du fief en cause.
- Tous les pièges à poissons (kidels) seront retirés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l’Angleterre, sauf sur les rivages côtiers.
- Le bref appelé praecipe ne sera plus émis pour quiconque en regard d’une terre si cela a pour effet de priver un homme libre de sa cour.
- Il n’y aura qu’une seule mesure pour le vin, la bière et le blé dans tout notre royaume, à savoir la pinte de Londres, et une seule largeur pour les draps teints, les roussets et les halbergets, à savoir deux aunes entre les lisières. Et il en sera pour le poids comme pour les mesures.
- Rien à l’avenir ne devra être payé ni exigé pour l’émission d’un bref d’enquête portant sur la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Ce bref sera gratuit et ne sera jamais refusé.
- Si un homme tient de nous une terre par bail ou en soccage, et tient également une terre d’une autre personne par service de chevalerie, nous ne mettrons pas en tutelle son héritier ni la terre qui lui a été concédée par cette autre personne en invoquant l’existence du bail ou du soccage, à moins que ce bail ne prévoit également un service de chevalerie. Nous ne mettrons pas en tutelle l’héritier d’un homme, ni la terre qu’il tient d’un autre, parce qu’il tient de nous un fief de sergenterie (petit domaine) en échange du service de couteaux, ou de flèches, ou d’autres menus services du même genre.
- Aucun bailli ne fera juger un homme sur la foi de son seul témoignage, sans produire de témoins fiables pour confirmer qu’il dit la vérité.
- Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou lésé de quelque manière que ce soit, pas plus que nous n’emploierons la force contre lui, ou enverrons d’autres pour le faire, sans un jugement légal de ses pairs ou selon les lois du pays.
- Nous ne vendrons, refuserons ou différerons le droit d’obtenir justice à personne.
- Tous les marchands pourront librement et en toute sûreté sortir d’Angleterre et entrer en Angleterre, y demeurer et y circuler librement, tant par les voies terrestres que maritimes, pour chater ou vendre sans maltôte, conformément aux anciennes et justes coutumes, excepté lorsque les marchands proviennent d’un pays en guerre contre nous. Si ces marchands se trouvent dans notre royaume au début de la guerre, ils seront détenus sans qu’il leur soit fait de mal et sans endommager leurs biens, jusqu’à ce que nous ou notre grand justicier connaissions le sort réservé à nos propres marchands dans le pays en guerre contre nous. Si nos marchands sont en sécurité, leurs marchands le seront également.
- Il sera dorénavant permis à toutes les personnes qui nous sont loyales de sortir de notre royaume et d’y revenir librement et en toute sécurité, tant par les voies terrestres que maritimes, excepté en temps de guerre et pour une courte période, dans l’intérêt de tout le royaume. Ceux qui auront été emprisonnés ou déclarés hors-la-loi en application des lois du royaume, ceux qui proviennent d’un pays en guerre contre nous, et les marchands dont le traitement est prévu plus haut, ne pourront invoquer ce droit.
- Si un homme détient des terres faisant partie d’un domaine tombé en déshérence tels que l’honneur de Wallinford, Nottingham, Boulogne, Lancastre, ou toute autre baronnie en déshérence qui est en notre possession, son héritier devra, au jour de la mort de son père, nous donner seulement le relief et les services dus au baron, comme si la baronnie s’était trouvée entre les mains d’un baron. Nous tiendrons donc la baronnie de la même manière que le baron la tenait.
- Les hommes qui habitent hors de notre forêt ne comparaîtront plus désormais devant nos juge de la forêt en réponse à une sommation générale, mais seulement s’ils sont directement accusés ou s’ils se sont portés caution pour une personne détenue en raison d’une infraction au droit de la forêt.
- Nous ne nommerons comme juges, connétables, shérifs, ou baillis, que des hommes qui connaissent le droit du royaume et qui sont bien disposés à l’observer.
- Tous les barons qui ont fondé des abbayes pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d’Angleterre ou peuvent faire la preuve d’une longue possession, auront la garde de ces abbayes lorsqu’elles deviendront vacantes, comme ils en ont le droit.
- Toutes les forêts créées pendant notre règne seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi également pour les berges que nous avons réservées pendant notre règne.
- Toutes les mauvaises coutumes régissant les forêts et les réserves de chasse, les forestiers et les gardes-chasse, les shérifs et leurs adjoints, ainsi que les berges et leurs gardiens, seront immédiatement examinés dans chaque comté par 12 chevaliers assermentés provenant de ce comté. Ces mauvaises coutumes seront complètement et définitivement abolies dans les 40 jours suivant leur enquête, à la condition que nous, ou notre grand justicier si nous sommes absents d’Angleterre, en soyons préalablement informés.
- Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été remis par les Anglais en gage de paix et de loyaux services.
- Nous congédierons de leur poste de bailli les parents de Gérard d’Athée. Ceux-ci ne pourront plus occuper d’Autres fonctions en Angleterre. Les personnes visées sont Engelart de Cigogné, Pierre, Guy, André de Chanceaux, Guy de Cigogné. Geoffroy de Martigny et ses frères, Philippe Marc et ses frères ainsi que son neveu Geoffroy, et toute leur clique.
- Dès le rétablissement de la paix, nous expulserons d’Angleterre tous les chevaliers, archers, sergents et soldats étrangers qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs armes, au préjudice du royaume.
- Si quiconque a été privé ou dépossédé de ses terres, de ses châteaux, de ses franchises ou de ses droits sans un jugement légal de ses pairs, nous les lui restituerons immédiatement. En cas de litige, la question sera tranchée par les 25 barons auxquels nous référons plus bas dans la clause visant à garantir la paix. Toutefois, pour les cas où c’est notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard qui aurait ainsi privé ou dépossédé un homme de son bien, et que nous en avons toujours la possession ou que celle-ci a été confiée à nos mandataires, nous allons surseoir pour la période normalement accordée aux croisés, à moins qu’une poursuite judiciaire ne soit en cours ou qu’une enquête n’ait été faite à notre demande, avant que nous ayons prix la croix. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice sans attendre.
- Nous allons également attendre avant de rendre justice dans les cas où des forêts plantées par notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard, doivent être défrichées ou demeurer telles quelles; nous ferons de même pour la garde des terres se trouvant dans le fief d’un autre, lorsque nous en avons eu jusqu’ici la possession à cause d’un fief que l’on tenait de nous par service de chevalerie, et pour les abbayes établies dans un autre fief que le nôtre, lorsque le seigneur de ce fief prétend y exercer un droit. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice à tous ceux qui se seront plaints.
- Nul ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d’un autre en raison de la dénonciation d’une femme, à moins que cet homme ne soit son mari.
- Toutes les amendes que nous avons reçues injustement en violation des lois du pays, comme toutes les amendes perçues injustement, seront restituées dans leur intégralité. En cas de désaccord, ces questions seront décidées par le jugement majoritaire des 25 barons auxquels nous référons plus bas dans la cluse visant à garantir la paix, en présence d’Étienne, l’archevêque de Cantorbéry, s’il peut venir, et d’autres personnes qu’il jugerait bon d’amener avec lui. Si l’archevêque ne peut être présent, les délibérations se poursuivront sans lui. Et si l’un ou l’autre des 25 barons était lui-même impliqué dans un litige de cette nature, il devra être excusé pour être remplacé par un autre choisi par les barons restants, mais seulement pour cette affaire.
- Si nous avons privé ou dépossédé quelque Gallois de ses terres, de ses libertés, ou d’un autre bien en Angleterre ou au pays de Galles, sans un jugement légal de ses pairs, ils devront lui être restitués sans attendre. Un litige à ce sujet devra être tranché dans les Marches par un jugement de ses pairs. La loi anglaise s’appliquera aux tenures se trouvant en Angleterre, la loi galloise aux tenures se trouvant au pays de Galles, et la loi des Marches aux tenures se trouvant dans les Marches.
- Lorsqu’un Gallois a été privé ou dépossédé de quoi que ce soit sans un jugement légal de ses pairs par notre père le roi Henri ou notre frère le roi Richard, et que nous en avons toujours la possession ou que celle-ci a été confiée à nos mandataires, nous allons sursoir pour la période normalement accordée aux croisés, à moins qu’une poursuite judiciaire ne soit en cours ou qu’une enquête n’ait été faite à notre demande, avant que nous ayons pris la croix. À notre retour de croisade, ou si nous abandonnons cette mission, nous ferons pleine justice sans attendre conformément aux lois du pays de Galles et des dites régions.
- Nous libérerons immédiatement le fils de Llevelyn, ainsi que tous les otages du pays de Galles. Nous leur retournerons les chartes qu’ils nous ont remises pour garantir la paix.
- Nous ferons de même en libérant les sœurs et les otages d’Alexandre, le roi d’Écosse, et en lui restituant ses libertés et ses droits, à moins que les chartes concédées par son père Guillaume, le précédent roi d’Écosse, ne prévoit autrement, une question qui sera tranchée par un jugement de ses pairs devant notre Cour.
- Toutes les coutumes et les libertés susdites que nous avons accordées doivent être observées dans notre royaume. Nous les observerons dans nos relations avec nos hommes, tout comme elles devront être observées par les clercs et les laïcs avec leurs propres hommes.
- Puisque nous avons accordé toutes les choses susdites pour Dieu, pour une meilleure organisation de notre royaume, et pour mettre fin aux dissentions entre nous et nos barons, et puisque nous souhaitons que tous puissent et jouir pleinement dans leur intégralité, avec la même force et pour toujours, nous accordons et con cédons aux barons les garanties suivantes :
Les barons pourront élire 25 hommes parmi leurs membres afin de défendre et de faire observer, en y mettant toutes leurs forces, la paix et les libertés qui leur ont été accordées et confirmées par la présente charte.
Si nous, notre grand justicier, notre bailli ou quelque autre de nos serviteurs faisons du tort à quiconque ou enfreignons l’un ou l’autre des articles de paix ou de cette garantie, et que quatre des 25 barons susmentionnés prennent connaissance de l’infraction, ces quatre barons viendront nous rencontrer, ou notre grand justicier si nous nous trouvons hors du royaume, pour nous en faire part et demander une réparation immédiate. Si nous, ou notre grand justicier lorsque nous sommes absents du royaume, n’accordons aucune réparation dans un délai de 40 jours à partir du jour où nous ou notre grand justicier avons été informé, les quatre barons porteront l’affaire devant le conseil des 25 barons réunis. Ces barons pourront alors, avec l’appui de la population, saisir nos biens et nous attaquer avec tous les moyens à leur disposition, en prenant nos châteaux, nos terres, nos possessions et quoi que ce soit d’autre qui nous appartient, à l’exception de notre personne, de la reine et de nos enfants, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu des garanties concernant la réparation demandée. Ayant obtenu ces garanties, ils devront nous témoigner à nouveau leur loyauté.
Quiconque le désire peut jurer d’obéir aux ordres des 25 barons afin d’accomplir ces actions, et se joindre à eux pour nous attaquer avec tous les moyens à leur disposition. Nous donnons publiquement et volontairement notre permission à tous ceux qui le désirent de prêter ce serment. Et nous n’interdiront jamais à quiconque de prêter ce même serment. En fait, nous ordonnerons à nos sujets qui refusent de le prêter de jurer d’obéir aux barons pour les aider comme susdit.
Si l’un des 25 barons mourrait ou quittait le pays, ou était empêché de quelque manière de remplir ses fonctions, ceux qui restent devront, à leur discrétion, choisir un autre baron pour le remplacer en l’assermentant de la même façon.
En cas de désaccord entre les 25 barons sur quelque sujet relevant de leur compétence, la décision majoritaire de ceux qui sont présents devra être considérée comme ayant la même valeur que si elle avait été rendue par tous, peu importe si les barons étaient tous présents ou si certains de ceux qui ont été convoqués ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents.
Les 25 barons devront jurer qu’ils observeront et feront observer fidèlement tous les articles ci-haut, et feront tout ce qu’ils peuvent pour obliger les autres à les observer.
Nous ne chercherons pas à obtenir de quiconque, directement ou par l’intermédiaire d’un autre, quelque chose qui pourrait abroger ou amoindrit la portée de ces concessions et libertés. S’il arrivait qu’une telle chose soit néanmoins obtenue, elle devra être considérée comme nulle et non avenue. Nous ne l’invoquerons jamais, que ce soit personnellement ou par personne interposée.
- Nous avons remis les peines et pardonné complètement à tous les hommes, comme nous avons oublié les ressentiments, les blessures et les rancunes qui ont surgi depuis le début du conflit entre nous et nos sujets clercs et laïcs. De plus, nous avons remis les peines et pardonné complètement, aux clercs comme aux laïcs, toutes leurs infractions commises en raison de ce conflit, depuis Pâques durant la seizième année de notre règne jusqu’à la conclusion de la paix.
Nous avons également émis des lettres patentes à l’intention du seigneur Étienne, archevêque de Cantorbéry, du seigneur Henri, archevêque de Dublin, des susdits évêques, et de maître Pandolphe, pour témoigner de cette garantie et des concessions susdites.
- En conséquence, nous souhaitons et ordonnons que l’Église d’Angleterre soit libre, et que les hommes de notre royaume et leurs héritiers jouissent pleinement et pour toujours de toutes les libertés, de tous les droits et de toutes les concessions susdites, en paix, librement et paisiblement, partout et en toute occasion, tant sous notre règne que sous celui de nos successeurs. Un serment a en outre été pris, par nous et par nos barons, que les conditions susdites seront observées avec bonne foi et sans mauvaise intentions.
Signé de notre main, en présence des susdits témoins et de plusieurs autres, dans le pré de Runnymède, entre Windsor et Staines, ce quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de notre règne.
**********************
DÉCLARATION DES DROITS (1689)
1 Will. & Mar., sess. 2, c. 2
(Notre traduction)
Attendu que les lords spirituels et temporels et les communes assemblés à Westminster, agissant consciemment et en toute liberté à titre de représentants légaux de tous les états constituant le peuple de ce royaume, ce treizième jour de février de l’année de Notre Seigneur 1688 (1689 d’après le calendrier actuel), ont présenté à Leurs Majestés, alors connus sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d’Orange, une certaine déclaration écrite composée par lesdits lords et communes selon les termes qui suivent, à savoir :
Considérant que l’ancien roi Jacques le Second, avec l’aide de divers conseillers maudits, juges et ministres à son emploi, a entrepris de subvertir et d’extirper la religion protestante, ainsi que les lois et libertés de ce royaume;
En s’appropriant et en exerçant un pouvoir qui lui permet de dispenser d’obéir aux lois, de suspendre les lois ou de ne pas appliquer les lois, sans le consentement du Parlement;
En incarcérant et en poursuivant en justice pour les accuser de crimes d’honnêtes prélats, parce qu’ils avaient refusé de reconnaître dans leur humble pétition l’existence de ce prétendu pouvoir;
En émettant et en exécutant un mandat afin d’ériger une cour appelée la Cour des commissaires pour les litiges religieux;
En percevant des impôts pour l’usage de la Couronne, durant une autre période et d’une autre manière que celles autorisées par le Parlement, en prétextant l’existence d’une prérogative;
En levant et en maintenant sur pied une armée dans ce royaume en temps de paix sans le consentement du Parlement, de même qu’en cantonnant les soldats en violation de la loi;
En désarmant de bons sujets protestants, alors qu’au même moment des papistes s’armaient et occupaient des emplois en violation de la loi;
En violant le droit à des élections libres pour le choix des députés siégeant au Parlement;
En poursuivant en justice devant la Cour du banc du Roi et par d’autres moyens arbitraires et illégaux des affaires et litiges qui relevaient de la juridiction exclusive du Parlement;
Et considérant que, pendant ces dernières années, des personnes non qualifiées et corrompues ont été convoquées pour servir sur des jurys, et plus particulièrement que des jurés ont siégé lors de procès pour haute trahison alors qu’ils n’étaient pas des propriétaires libres (freeholders);
Et que des cautions excessives ont été exigées de personnes incarcérées dans des affaires criminelles pour les empêcher de recouvrer leur liberté, comme la loi le permet;
Et que des amendes excessives ont été imposées;
Et que des peines cruelles et illégales ont été infligées;
Et que plusieurs promesses et cessions ont été faites concernant l’imposition d’amendes ou la confiscation de biens avant que les personnes accusées n’aient été condamnées ou reconnues coupables;
Et que toutes ces actions sont indéniablement en violation flagrante des lois et des statuts comme des libertés du royaume;
Et considérant que l’ancien roi Jacques le Second a abdiqué, en laissant son trône vacant, son altesse le prince d’Orange (que le Dieu Tout Puissant a désigné pour délivrer ce royaume de la papauté et d’un pouvoir arbitraire) a (sur l’avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs autres personnes des communes) fait parvenir des lettres aux lords spirituels et temporels de foi protestante, ainsi qu’à plusieurs comtés, cités, universités, bourgs et ports de mer, leur demandant de choisir des personnes pour les représenter au Parlement comme c’est leur droit, puis de se réunir et de siéger à Westminster ce 22e jour de janvier 1688 (1689 selon le calendrier actuel) afin de mettre en place un régime qui protègera leur religions, leurs lois et leurs libertés, après quoi des élections ont été tenues pour choisir les représentants des communes;
Et conformément aux lettres de convocation qu’ils ont reçues et à leurs élections respectives, lesdits lords spirituels et temporels et les communes, maintenant assemblés à titre de représentants libre de toute la nation, prenant en compte les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs cités plus haut, commencent (comme leurs ancêtres l’ont fait avant eux dans des cas semblables) par affirmer le bien-fondé de leurs anciens droits et libertés en déclarant :
- Que le prétendu pouvoir du roi de suspendre les lois ou l’application des lois sans l’accord du Parlement est illégal;
- Que le prétendu pouvoir du roi de dispenser d’obéir aux lois, tel qu’exercé récemment, est illégal;
- Que la création de la Cour des commissaires pour les litiges religieux et de toute autre institution de même nature est illégale et pernicieuse;
- Que la perception d’impôts pour l’usage de la Couronne sans l’accord du Parlement, ou d’une manière différente ou pour un temps plus long que ceux qui ont été autorisés par le Parlement, en invoquant une prétendue prérogative royale, est illégale;
- Que tout sujet possède le droit de pétitionner le Roi, et qu’en conséquence toute incarcération ou accusation par suite de l’exercice de ce droit est illégale;
- Que la levée ou le maintien sur pied d’une armée dans le royaume en temps de paix sans le consentement du Parlement viole la loi;
- Que les sujets protestants peuvent posséder des armes appropriées à leur condition pour se défendre comme la loi les y autorise;
- Que les élections des membres du Parlement doivent être libres;
- Que ni la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures au sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune cour ou quelque lieu autre que le Parlement lui-même;
- Que l’on ne doit pas exiger de caution (bail) excessive, ni imposer des amendes abusives, ni infliger des peines cruelles et inusitées;
- Que les jurés doivent être régulièrement sélectionnés à partir de listes officielles, et que ceux choisis dans les procès pour trahison doivent être des propriétaires libres (freeholders);
- Que toutes cessions et promesses d’amende et de confiscation de biens visant une personne sans un jugement reconnaissant sa culpabilité sont illégales et nulles;
- Et que pour porter remède à tous les griefs de la population, ainsi que pour modifier, consolider et sauvegarder les lois, des Parlement doivent être convoqués fréquemment.
Et ils (lords et communes) revendiquent, exigent et insistent sur tout ce qui vient d’être énoncé comme représentant leurs droits et libertés incontestés, et qu’aucun jugement, déclaration, manœuvre ou procédure ayant violé ces droits au préjudice du peuple doive, de quelque manière, porter à conséquence ou servir d’exemple.
Ils sont particulièrement encouragés dans la revendication de leurs droits par la déclaration de son altesse le prince d’Orange, déclaration qui, selon eux, constitue l’unique moyen d’obtenir justice en raison des recours et des réparations qu’on y prévoit.
Ayant par conséquent pleinement confiance que son altesse le prince d’Orange terminera l’œuvre de libération qu’il a entreprise, et empêchera la violation de leurs droits ici affirmés, comme de toute atteinte à leur religion, et à leurs autres droits et libertés;
II. Lesdits lords spirituels et temporels et communes assemblés à Westminster ont convenu de déclarer que Guillaume et Marie, prince et princesse d’Orange, sont roi et reine d’Angleterre, de France et d’Irlande, et des territoires qui en dépendent, avec les titres de roi et reine et la Couronne de ces royaumes et territoires, que ledit prince et ladite princesse conserveront durant toute leur vie et la vie de celui des deux qui survivra à l’autre, et que les pleins pouvoirs régaliens sont investis dans le seul prince d’Orange qui les exercera au nom du prince et de la princesse pendant leur vie commune, et qu’après leur décès le titre de roi ou reine et la Couronne desdits royaumes et territoires échoiront aux enfants de ladite princesse Marie, et à défaut d’enfant de la princesse ils reviendront à la princesse Anne du Danemark et à ses descendants, et à défaut d’enfant de cette princesse ils reviendront aux descendants du prince d’Orange. Et les lords spirituels et temporels et les communes prient pour que lesdits prince et princesse d’Orange acceptent cet ordre de succession.
III. Et que les serments mentionnés ici soient prêtés par toutes les personnes qui doivent légalement prêter les serments d’allégeance et de suprématie, en remplacement des anciens serments d’allégeance et de suprématie qui sont abrogés.
Je, A.B., promet et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Leurs Majestés le roi Guillaume et la reine Marie. Que Dieu me vienne en aide.
Je, A.B., jure de tout mon cœur que j’abhorre, déteste et abjure comme impie et hérétique cette doctrine et position damnée, que les princes excommuniés ou condamnés par le pape ou toute autre autorité vaticane peuvent être déposés ou assassinés par leurs sujets ou toute autre personne. Et je déclare qu’aucun prince étranger, personne, prélat, État ou potentat a eu ou devrait avoir quelque juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité, ecclésiastique ou spirituelle, à l’intérieur de ce royaume. Que Dieu me vienne en aide.
IV. En vertu de quoi Leurs dites Majestés ont accepté la Couronne et les titres de roi et reine des royaumes d’Angleterre, de France et d’Irlande, avec les territoires qui en dépendent, conformément à la résolution et au désir desdits lords et communes exprimés dans ladite déclaration.
V. Et, sur ce, Leurs Majestés se sont dites heureuses que lesdits lords spirituels et temporels et les communes, étant les deux chambres du Parlement, puissent continuer à siéger, et qu’avec l’accord de Leurs Majestés elles prendront des mesures efficaces pour l’établissement de la religion, l’adoption de lois et la protection des libertés de ce royaume, afin qu’elles ne soient plus en danger d’être subverties, ce à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les communes ont exprimé leur accord et ont entrepris d’agir en conséquence.
VI. Dans la poursuite de ces objectifs, qui consistent à ratifier, confirmer et établir la présente déclaration et les articles, clauses, matières et choses qu’elle contient pour qu’ils aient force de loi en vertu de l’autorité du Parlement, lesdits lords spirituels et temporels et les communes réunis en Parlement prient maintenant qu’il soit déclaré et décrété que tous et chacun des droits et libertés énoncés et revendiqués dans ladite déclaration sont les véritables, anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et qu’en conséquence ils doivent être appréciés, autorisés, proclamés, respectés, estimés et pris en compte; et que tous et chacun d’entre eux doivent être fermement et strictement maintenus et observés comme ils ont été énoncés dans ladite déclaration, et que tous les officiers et ministres, quels qu’ils soient, devront servir Leurs Majestés et leur successeurs en respectant ces droits et libertés pour toujours.
VII. Et lesdits lords spirituels et temporels et les communes, considérant qu’il a plu du Dieu Tout Puissant, dans sa merveilleuse providence et sa miséricorde bonté envers cette nations, d’avoir sauvegardé Leurs dites Royales Majestés afin qu’elles s’assoient sur le trône de leurs ancêtres et puissent ainsi régner sur nous, ce pour quoi les lords et les communes présentent à Dieu leurs plus humbles remerciements et louanges, pensent vraiment, fermement, assurément et avec sincérité de leurs cœurs, et par la présente reconnaissent, acceptent et déclarent que le roi Jacques le Second ayant abdiqué le gouvernement, et Leurs Majestés ayant accepté la Couronne et les titres de roi et reine comme susmentionné, Leurs dites Majestés sont devenues et doivent être reconnues en vertu des lois de ce royaume comme nos souverains liges, seigneur et dame, roi et reine d’Angleterre, de France et d’Irlande, et des territoires qui en dépendent, en qu’en leurs personnes ont été investis l’État, la Couronne et les droits sur ces royaumes avec tous les honneurs, titres, prérogatives, pouvoirs, juridictions et autorités qui y sont associés.
VIII. Et afin d’écarter les questions et de prévenir les désaccords dans ce royaume en raison de quelque prétendu titre à la Couronne, et pour assurer une succession sans heurt, sur laquelle dépendent entièrement l’unité, la paix, la tranquillité et la sécurité de cette nation, lesdits lords spirituels et temporels et les communes implorent Leurs Majestés qu’il soit promulgué, établi et déclaré, que la Couronne et le gouvernement desdits royaumes et territoires, avec tous et chacun des droits énumérés plus haut qui l’accompagnent, doivent appartenir et continuer d’appartenir à Leurs dites Majestés et au survivant d’entre elles durant toute leur vie, et que la totalité du pouvoir régalien et du gouvernement soit exercé par Sa Majesté au nom de Leurs deux Majestés durant leur vie commune; et qu’après leur décès ladite Couronne et lesdits droits doivent revenir aux enfants de Sa Majesté la reine Marie, et à défaut d’enfant de la reine ils reviendront à la princesse Anne du Danemark et à ses descendants; et à défaut d’enfant de la princesse Anne ils reviendront aux descendants de Sa Majesté le roi Guillaume; et, sur ce, lesdits lords spirituels et temporels, et les communes, au nom de tout le peuple, se soumettent humblement et fidèlement, avec leurs héritiers et postérité pour toujours, et promettent sincèrement qu’ils se tiendront prêts à soutenir et à défendre de toutes leurs forces lesdites Majestés, ainsi que l’application des règles sur la succession décrites ici, en engageant leur vie et leurs biens contre toutes les personnes qui voudraient y porter atteinte.
IX. Et considérant que l’expérience a démontré qu’il est incompatible avec la sécurité et le bien-être de ce royaume protestant d’être gouverné par un prince papiste, ou par quelque autre roi ou reine ayant épousé un papiste, lesdits lords spirituels et temporels et les communes prient également pour qu’ils soient prescrit que toute personne réconciliée ou qui se réconcilierait avec l’Église de Rome, ou communierait selon le rite de l’Église de Rome, ou prétendrait être de confession papiste, ou épouserait un papiste, devrait être exclue et être pour toujours incapable d’hériter, de posséder ou de jouir de la Couronne et du gouvernement de ce royaume, de celui d’Irlande, et des territoires qui en dépendent ou d’aucune partie de ceux-ci; et dans tous et chacun de ces cas les peuples de ces royaumes ne devraient pas être liés par quelque allégeance et seraient soustraient à leur devoir d’obéissance; et ladite Couronne et ledit gouvernement devraient échoir ou revenir à telle personne ou telles personnes de foi protestante, comme si la ou les personnes réconciliées avec l’Église de Rome, ou communiant selon le rite de l’Église de Rome, ou prétendant être de profession papiste ou épousant un papiste, étaient décédées de mort naturelle.
X. Et que chaque roi ou reine de ce royaume, qui en aucun temps viendrait à succéder à la Couronne impériale de ce royaume, devrait, le premier jour de son premier Parlement après son avènement, assis sur son trône à la Chambre des pairs en présence des lords et des communes assemblés, ou lors de son couronnement, avant qu’il ne récite son serment de couronnement (selon l’occasion qui se présente en premier), faire, souscrire et répéter à haute voix la déclaration prévue dans le statut adopté la trentième année du règne de Charles le Second intitulé, An Act for the more effectual preserving the King’s Person and Government by disabling Papists from sitting in either House of Parliament (Loi sur la mise à l’épreuve de 1678). Mais s’il devait arriver qu’un tel roi ou reine n’ait pas encore atteint l’âge de douze ans au jour de son avènement, alors le roi ou la reine devra faire, souscrire et répéter à haute voix la même déclaration le jour de son couronnement ou le premier jour de son premier Parlement (selon l’occasion qui se présente en premier), après que tel roi ou reine ait atteint l’âge de douze ans.
XI. Leurs Majestés sont satisfaites et heureuses que tout cela doive être déclaré, promulgué et établi par l’autorité du présent Parlement, puis maintenu et continué pour être la loi de ce royaume pour toujours; en conséquence, Leurs dites Majestés, sur l’avis et du consentement des lords spirituels et temporels et des communes réunis en Parlement, et par l’autorité de celui-ci, déclarent, promulguent et établissent ce qui précède.
XII. Et qu’il soit de plus déclaré et promulgué par l’autorité susmentionnée, que depuis et après la présente session du Parlement, aucune dispense par non obstante d’aucun statut ou partie de celui-ci ne doive être permis, et que cette dispense serait tenue pour nulle et sans effet, à moins qu’elle n’ait été autorisée dans un tel statut, et alors seulement dans de tels cas qui seront spécialement prévus dans un ou plusieurs projets de loi adoptés lors de la présente session du Parlement.
XIII. À la condition qu’aucune charte ou concession ou pardon accordé avant le troisième et le vingtième jour d’octobre de l’année de notre seigneur mille six cent quatre-vingt-neuf n’ait été de quelque façon contesté ou invalidé par la présente loi, ceux-ci demeureront en vigueur avec la même force et le même effet en droit que si cette loi n’avait jamais été adoptée.
LOI D'ÉTABLISSEMENT (1701)
12 & 13 Will. 3, c. 2
(Notre traduction)
Créez votre propre site internet avec Webador